Le Parti Communiste français - 4e partie : Face à la montée du fascisme en France
Submitted by Anonyme (non vérifié)1. « Que les bouches s'ouvrent »
La SFIC a réussi son pari : elle a réussi à se transformer en un parti de cadres qui dispose maintenant d’une audience certaine et également d’une forte expérience. Le Parti Communiste possède également un dispositif clandestin de planques, d’imprimeries, des moyens financiers à l’abri d’une saisie, avec des dirigeants inconnus des services de police.
Le système est efficace : à son arrestation en 1929, Maurice Thorez était dans l’illégalité depuis deux années déjà. Mais une telle pratique militaire ne va pas sans une grande pression à l’intérieur de ses structures, notamment face à l’énorme répression exercée par l’État.
 Celle-ci, pour l’année 1929, consiste notamment, si l’on ne compte pas les nombreuses attaques paramilitaires ou fascistes, 1127 poursuites, 597 condamnations totalisant 260 années de prison, amendes de plus d’un million de francs de l’époque. Les problèmes se cristallisent alors dans la plus grande crise que la SFIC vit depuis sa naissance. Profitant de la vague d’arrestations, Henri Barbé et Pierre Célor mettent véritablement la main sur la direction de l’organisation.
Celle-ci, pour l’année 1929, consiste notamment, si l’on ne compte pas les nombreuses attaques paramilitaires ou fascistes, 1127 poursuites, 597 condamnations totalisant 260 années de prison, amendes de plus d’un million de francs de l’époque. Les problèmes se cristallisent alors dans la plus grande crise que la SFIC vit depuis sa naissance. Profitant de la vague d’arrestations, Henri Barbé et Pierre Célor mettent véritablement la main sur la direction de l’organisation.
De décembre 1929 à juillet 1930, le Comité central de la SFIC ne se réunit même pas et les directives sont prises de manière administrative. Une ligne ultra sectaire prédomine avec, notamment, de retentissantes bagarres entre socialistes et communistes à Lens, Paris, Champigny. Le Parti se replie sur lui-même et les chiffres parlent d’eux-mêmes : celle-ci a 333 000 adhérents en 1921, 431 000 en 1927 mais retombe à 322 000 en 1931. L’Humanité perd 30 000 lecteurs entre 1929 et 1930, tombant à 150 000 ; la SFIC perd, elle, de nombreux adhérents, tombant à 38 000 au début de 1930 puis entre 25 000 et 30 000 membres en 1931.
Cette tendance n’est pas propre à la SFIC, elle est en fait internationale et l’Internationale Communiste lui donne le nom de « trotskysme ». 1929 a en effet été « l’année du grand tournant » en Russie et, depuis, sont combattues les tendances dites de « gauche » qui, selon Staline et, avec lui, la majorité de l’Internationale Communiste ainsi que du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchévik), forment une alliance objective avec la contre-révolution mondiale.
Cette période est marquée par un saut qualitatif dans l’Internationale Communiste, qualifiée de « stalinisation » par le courant trotskyste et de « passage au totalitarisme » par les historiens comme ceux du « Livre noir du communisme ».
Les Partis Communistes deviennent en effet des organisations militarisées et le centralisme démocratique est mis au centre du processus. La direction n’est plus simplement censée refléter les positions de la base, mais aller de l’avant ; les cadres sont alors triés sur le volet et le poste de secrétaire général acquière une nouvelle signification.
 En France, c’est le jeune ouvrier du Pas-de-Calais Maurice Thorez qui devient secrétaire général du Parti Communiste en 1930, à 30 ans. Celui-ci obtient un large succès aux élections du poste de député de Belleville, avec 4256 voix contre 1673 à la SFIO qui a mené une vigoureuse campagne anticommuniste et 3445 voix à la droite. Battu au second tour avec 4911 voix contre 5404, Thorez s’impose comme une véritable figure combative.
En France, c’est le jeune ouvrier du Pas-de-Calais Maurice Thorez qui devient secrétaire général du Parti Communiste en 1930, à 30 ans. Celui-ci obtient un large succès aux élections du poste de député de Belleville, avec 4256 voix contre 1673 à la SFIO qui a mené une vigoureuse campagne anticommuniste et 3445 voix à la droite. Battu au second tour avec 4911 voix contre 5404, Thorez s’impose comme une véritable figure combative.
Se généralise également dans la SFIC la pratique de « l’autobiographie » : chaque militant doit établir son parcours personnel, une critique essentielle pour une organisation de combat mais au véritable coeur de la critique du « stalinisme ». La direction exige des comptes de la base, comme en témoigne également le principe de Lettre aux ouvriers socialistes que chaque cellule d’entreprise doit écrire, en analysant précisément la situation de l’entreprise, le rapport de forces entre socialistes et communistes, les revendications pouvant mobiliser les masses.
Et finalement Henri Barbé et Pierre Célor sont démis de leurs responsabilités, accusés d’avoir formé un « groupe » afin de maintenir la domination de leur ligne. Henri Barbé ira fonder l’organisation fasciste « parti populaire français » en 1934 et sous l’occupation rejoindra les collabos du « Rassemblement National Populaire », pour écrire après la guerre dans la revue anticommuniste Est-Ouest et devenir un intellectuel catholique conservateur. Pierre Célor deviendra pareillement un catholique traditionaliste écrivant dans « Est-Ouest » après avoir rejoint le « parti populaire français » pendant l’occupation allemande.
Maurice Thorez débloque alors totalement la situation, avec une série d’articles qui en août et septembre 1931 façonne une nouvelle identité : « Pas de mannequins», « Que les bouches s’ouvrent », « Enfin on va discuter », « Jetons la pagaïe. » Une nouvelle rubrique s’ouvre dans l’Humanité : « Sous les feux de la critique ».
Pour contrer le sectarisme et replacer la tactique « classe contre classe » dans le droit chemin, d’intenses campagnes sont menées afin de gagner les couches populaires du Parti socialiste. Celui-ci n’est plus considéré comme un bloc réactionnaire homogène à l’instar de l’époque de la domination idéologique du « groupe Barbé-Célor ».
Au contraire, on en revient à la ligne du front unique par la tactique « classe contre classe. » Thorez est l’artisan essentiel du retour à cette position, qu’il avait notamment présentée dans La tactique du front unique (1930) : « La politique socialiste est déterminée par les éléments petits-bourgeois qui dirigent effectivement le Parti socialiste, là même où les sections groupent une majorité d’ouvriers. Cette politique recherche et réalise la collaboration socialiste à toutes les entreprises décisives de la bourgeoisie impérialiste. »
 Ce véritable redressement de la SFIC va jouer un rôle énorme vu le contexte du moment. La crise de 1929 bouleverse en effet l’économie des pays capitalistes et bouleverse encore davantage l’équilibre déjà précaire de la société française. De 1929 à 1934 la masse des salaires diminue d’un tiers. Les cours de la viande, du blé et du vin s’effondrent de 50% à la production et les petits exploitants s’effondrent dans les campagnes.
Ce véritable redressement de la SFIC va jouer un rôle énorme vu le contexte du moment. La crise de 1929 bouleverse en effet l’économie des pays capitalistes et bouleverse encore davantage l’équilibre déjà précaire de la société française. De 1929 à 1934 la masse des salaires diminue d’un tiers. Les cours de la viande, du blé et du vin s’effondrent de 50% à la production et les petits exploitants s’effondrent dans les campagnes.
Dès 1932, le nombre de faillites est multiplié par deux. Sur une base de 100 en 1929, la production industrielle est de 76 en 1932. Dans ce contexte, les communistes s’attendent à une poussée de la lutte de classe, mais également à un renforcement du fascisme : « La nouvelle aggravation, résultant de la crise économique, des principales contradictions du capitalisme, qui eut tout d’abord sa répercussion sur les points les plus faibles, le mécontentement croissant des grandes masses, l’influence grandissante du communisme, le prestige accru du pays de la dictature prolétarienne, tout cela conduit la bourgeoisie à utiliser toujours plus ouvertement l’appareil de la violence de sa dictature, d’une part, et amène, d’autre part, à une poussée révolutionnaire croissante... » (Thèse de la onzième assemblée plénière du comité exécutif de l’Internationale Communiste, avril 1931).
Thorez est alors l’homme de la situation vu son interprétation correcte du front unique à la base. Le septième Congrès du Parti Communiste (11-19 mars 1932) lance ainsi un Manifeste aux ouvriers, aux paysans, à tous les travailleurs ! : « Pour cette lutte quotidienne acharnée, le Parti Communiste appelle tous les ouvriers, tous les travailleurs à s’unir dans des Comités de lutte, dans des Comités du Bloc Ouvrier et Paysan, à entrer nombreux dans ses rangs et dans les syndicats unitaires. Il tend fraternellement la main aux ouvriers socialistes et les appelle à lutter en commun avec les ouvriers communistes contre la bourgeoisie dont la politique anti-ouvrière est soutenue par le Parti socialiste. »
La situation en 1932 marque indéniablement une large amélioration : la SFIC a 34 580 adhérents, contre 30 743 en 1931. Ceux-ci sont organisés dans 1419 cellules locales et 474 cellules d’entreprises, dont 563 pour le Nord et 292 pour la région parisienne. A côté de ses bastions, on trouve toutefois des régions industrielles comme la Garonne où il n’y a que sept cellules d’entreprises, ou encore les régions de l’Est et de la Basse-Seine, où il n’y en a aucune. Et aux élections législatives des 1er et 8 mai 1932, le scrutin d’arrondissement majoritaire dessert gravement le Parti Communiste, qui avec 784 844 voix en a 280 000 de moins qu’en 1928.
Thorez assoit sa direction en l’emportant dans une circonscription comprenant Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly et Thouais. Mais l’obstacle principale reste la SFIO, qui paralyse les masses et soutient de juin 1932 à février 1934 les gouvernements radicaux qui font payer la crise à la classe ouvrière, aux fonctionnaires dont le traitement est diminué...
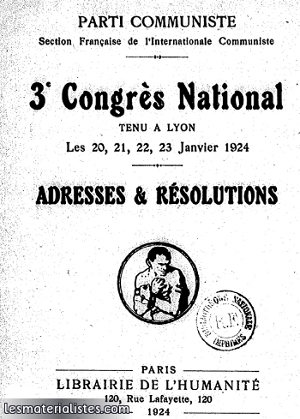 Le Parti Communiste décide alors de générer différents organismes. Dès 1930 une note du Bureau Politique du Parti Communiste destinée aux « intéressés » explique :
Le Parti Communiste décide alors de générer différents organismes. Dès 1930 une note du Bureau Politique du Parti Communiste destinée aux « intéressés » explique :
« La tentative que nous faisons est inédite en France. Il s’agit de grouper et d’organiser au sein du Parti les chercheurs et les écrivains marxistes, d’en former de nouveaux, de créer une base à la science marxiste. »
Le mouvement se lance, il donnera naissance à la Commission scientifique du Cercle de la Russie neuve, à l’Académie matérialiste en juillet 1933, qui deviendra le Groupe d’Etudes Matérialistes, l’Université Ouvrière dirigée par Georges Politzer.
Il y a pareillement la naissance en 1931 de la Fédération du Théâtre Ouvrier Français, dont fera partie le « Groupe Octobre » dont le principal acteur était Jacques Prévert ou encore la « Phalange théâtre » appelé également « Phalange Bellevilloise », dont la pièce « Bougres de Nha-Qué » dénonçant la colonisation en Indochine fut interdite en 1933. Les groupes de théâtre ont une énorme signification pour l’agit-prop communiste ; la SFIC profite en fait des riches expériences du Parti Communiste d’Allemagne.
Le 25 octobre 1932, les deux organisations font un communiqué commun et le 31 octobre le secrétaire général du Parti Communiste d’Allemagne, Ernst Thälmann, est applaudi par 10 000 personnes. En janvier 1933, à la veille de la prise du pouvoir par les nazis, Maurice Thorez tient un discours à Berlin sur la tombe de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg.
Existera également par la suite un Comité Thälmann, fondé à Paris en mars 1934, qui dès sa première année publie 20 000 brochures, 10 000 partitions du Chant de Thälmann, et produit 30 000 insignes, 32 000 cartes postales, trois publications d’un tirage total de 15 000 exemplaires, 260 000 tracts, 15 600 affiches... Ses meetings rassembleront 100 000 personnes tout au long de l’année 1935, il organisera un contre-tribunal avec 300 juristes, lâchera des centaines de ballons sur l’Allemagne, avec inscrits dessus « Liberté pour Thälmann » en allemand...
Cette solidarité internationaliste joue un rôle essentiel dans la culture communiste, qui informe de manière ininterrompue sur la guerre impérialiste, notamment contre la Chine. La lutte contre la guerre impérialiste est un leitmotiv de la propagande de la SFIC. Une ligue anti-impérialiste avait déjà été fondée en 1927 et un appel à la convocation d’un congrès mondial contre la guerre, est publié le 22 mai 1932 par Henri Barbusse et Romain Rolland. Des manifestations ont lieu en juillet et à Paris se tient un Congrès ouvrier et paysan contre la guerre, présidé par Pierre Sémard, avec 2000 délégués et 1000 invités des entreprises, dont des travailleurs socialistes.
 Du 27 au 29 août se tient alors à Amsterdam le Congrès mondial contre la guerre, avec 38 nationalités représentées et des conférences particulières organisées pour différentes catégories (femmes, jeunes, ouvriers des industries de guerre et de transport, enseignants, anciens combattants, écrivains, médecins). Le 11 novembre, 40 000 manifestants se retrouvent contre la guerre à Vincennes en banlieue parisienne.
Du 27 au 29 août se tient alors à Amsterdam le Congrès mondial contre la guerre, avec 38 nationalités représentées et des conférences particulières organisées pour différentes catégories (femmes, jeunes, ouvriers des industries de guerre et de transport, enseignants, anciens combattants, écrivains, médecins). Le 11 novembre, 40 000 manifestants se retrouvent contre la guerre à Vincennes en banlieue parisienne.
Au début de 1933, on compte 400 comités ; trois fédérations socialistes, des Côtes-du-Nord, de l’Ariège et des Landes, ainsi que 141 sections socialistes y participent. Début juin, à l’initiative de l’Internationale Syndicale Rouge, a lieu à la salle Pleyel à Paris le Congrès ouvrier européen antifasciste. Finalement le Congrès de Pleyel et celui d’Amsterdam fusionnent pour donner le Comité mondial contre la guerre et le fascisme, dit « Amsterdam-Pleyel » et présidé par Barbusse. Celui-ci est alors la grande figure intellectuelle du Parti Communiste. Barbusse animait déjà l’Association républicaine des Anciens Combattants (ARAC) ainsi que le mouvement Clarté, du nom de son second roman de guerre, qui regroupe des intellectuels progressistes en France et à l’étranger, puis l’hebdomadaire Monde en juin 1928 (qui durera jusqu’en 1935).Très proche des dirigeants soviétiques, il est pressé par ceux-ci d’organiser les intellectuels, ce qui aboutit à la naissance de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), section française de l’Union internationale des écrivains révolutionnaires.
Sa fondation est annoncée au septième congrès du Parti Communiste, Paul Vaillant-Couturier y déclarant : « Acceptez notre plume si peu qu’elle vaille. Placez-la tout à côté de votre marteau et de votre faucille et soyez assurés que le jour où posant vos outils vous prendrez vos fusils, nous jetterons notre plume et courrons avec vous défendre cette barricade que nous aurons contribué à édifier ensemble. » Le programme de l’AEAR, c’est celui du « front culturel rouge », qui a comme but de « grouper à la fois des intellectuels petits-bourgeois qui veulent se mettre au service de la classe ouvrière et les éléments ouvriers assoiffés de culture et d’expression artistique ou littéraire de leur vie. Il les groupe sur la base du matérialisme dialectique. »
 L’AEAR éditera la revue Commune, qui publiera des auteurs et informera des positions soviétiques sur la littérature. Il ne faut pas oublier dans ce cadre la « fête de l’Huma », devenue une tradition depuis 1930 où elle s’est tenue au parc Sacco et Vanzetti à Bezons. Mais la ligne de Barbusse – faire participer les sociaux-démocrates à Monde – heurte très largement la direction du Parti Communiste, amenant de larges frictions avant que l’Internationale Communiste – dont Barbusse était une importante figure – ne chapeaute le tout, au profit de Barbusse.
L’AEAR éditera la revue Commune, qui publiera des auteurs et informera des positions soviétiques sur la littérature. Il ne faut pas oublier dans ce cadre la « fête de l’Huma », devenue une tradition depuis 1930 où elle s’est tenue au parc Sacco et Vanzetti à Bezons. Mais la ligne de Barbusse – faire participer les sociaux-démocrates à Monde – heurte très largement la direction du Parti Communiste, amenant de larges frictions avant que l’Internationale Communiste – dont Barbusse était une importante figure – ne chapeaute le tout, au profit de Barbusse.
Le point culminant de ce mouvement sera le congrès international des écrivains à la salle de la Mutualité à Paris en juin 1935. Y participent des écrivains antifascistes de 38 pays, avec une centaine d’intervenants et 230 délégués. On y retrouve André Gide, Romain Rolland, Julien Benda, Robert Musil, Aldous Huxley, Ilya Ehrenbourg, André Malraux, Max Brod, Klaus Mann, Johannes Becher, Alexeï Tolstoï, Waldo Frank, Henri Barbusse, Alfred Kantorowicz, Gaetano Salvemini, Lion Feuchwanger, Heinrich Mann, Tristan Tzara, Ernst Bloch, Louis Aragon, Gustav Regler, Sophia Wadia, Jean Guéhenno, Boris Pasternak, Isaak Babel, René Crevel, Georges Dimitrov, Forster, Georges Friedmann, Ivan Luppol et, bien entendu Bertolt Brecht, qui expliquera que « La barbarie ne provient pas de la barbarie, mais des affaires qu’on ne peut plus faire sans elle. »
Le Congrès a une grande signification dans la lutte antifasciste, puisqu’il donne la parole aux écrivains exilés, à la littérature clandestine, Jan Petersen venant même d’Allemagne muni d’une fausse barbe et de lunettes noires où il menait clandestinement la lutte, en tant que responsable de l’Union des écrivains prolétariens d’Allemagne. Le congrès amène la fondation de l’Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, qui organisera une conférence des écrivains à Londres en 1936 avec un projet de « nouvelle encyclopédie », puis un autre congrès en juillet 1937 à Valence, puis Madrid, Barcelone et Paris, pour la défense de la culture alors que la République espagnole est aux prises alors avec les hordes fascistes.
Une dernière conférence aura lieu à Paris en 1938. Le Congrès amène également la rupture définitive avec les surréalistes, dont le chef de file Breton fait tout pour saboter le congrès, arguant que le terme de « culture » ne veut rien dire. Il préfigure également les progrès du front unique antifasciste, que malheureusement Henri Barbusse ne verra pas, puisqu’il meurt le le 30 août 1935. Cinq cent mille personnes participent à ses obsèques au Père-Lachaise.
2. Le front antifasciste
Le fascisme était depuis des années déjà l’un des thèmes centraux de la SFIC, et il n’y a rien d’étonnant à ce que les progrès du fascisme en France aient été compris, avec une attention d’autant plus particulière après la victoire nazie en Allemagne. La SFIC s’engage dans un combat culturel, s’attachant à « étudier et déceler les particularités » de la situation en France, « afin de pouvoir combattre efficacement les voies du fascisme en France. » (Maurice Thorez, La situation actuelle en France les tâches du Parti Communiste, décembre 1933). La SFIC profite également d’un large avantage sur le Parti Communiste d’Allemagne, pays où avait eu lieu de multiples insurrections communistes, écrasées entre autres par la social-démocratie. Pareillement, en Autriche les socialistes laisseront vaincre le putsch fasciste en 1934 malgré leur supériorité numérique et militaire, plutôt que de s’allier aux communistes.
 Tel n’est pas le cas en France, ni dans la république espagnole, où la base socialiste est moins sous le contrôle de directions socialistes qui « en retenant les ouvriers de l’action révolutionnaire contre l’offensive du capital et contre le fascisme croissant, jouent le rôle d’un bouclier derrière lequel les fascistes ont la possibilité d’organiser leurs forces et fraient la voie à la dictature fasciste. » (Résolution de la douzième assemblée plénière du comité exécutif de l’Internationale Communiste)
Tel n’est pas le cas en France, ni dans la république espagnole, où la base socialiste est moins sous le contrôle de directions socialistes qui « en retenant les ouvriers de l’action révolutionnaire contre l’offensive du capital et contre le fascisme croissant, jouent le rôle d’un bouclier derrière lequel les fascistes ont la possibilité d’organiser leurs forces et fraient la voie à la dictature fasciste. » (Résolution de la douzième assemblée plénière du comité exécutif de l’Internationale Communiste)
L’Internationale socialiste avait ainsi rejeté l’appel fait par l’Internationale Communiste « pour la lutte commune des travailleurs socialistes et communistes », fait en mars 1933 au moment de la victoire nazie. Pareillement, la SFIO, rejettera, Léon Blum s’en chargeant le 8 mars via un article dans Le Populaire, l’appel de la SFIC fait le 6 mars aux travailleurs socialistes et à la commission administrative permanente de la SFIO pour une lutte commune et l’engagement de cesser toutes critiques contre les organisations socialistes participantes.
La SFIC va donc se retrouver seule en première ligne face au fascisme. Un fascisme français qui, aux yeux de l’écrasante majorité des historiens français du début du 21ème siècle, n’aurait jamais existé. En pratique, c’est pourtant bien plutôt le contraire qui est vrai, les fascistes italiens ou même allemands ayant massivement puisé dans les théoriciens français, autant pour le racisme que pour le culte national-syndicaliste de la violence.
Les troupes fascistes sont très nombreuses et disposent de multiples organisations : Solidarité française et ses chemises bleues, l’Action Française et ses camelots du roi (60 000 membres), les Jeunesses Patriotes (65 000 membres en 1926, 100 000 en 1934) composées d’équipes de cogneurs, la Ligue des Patriotes, les Croix de Feu (60 000 membres à la fin 1933, 150 000 en 1934, 400 000 en 1935)...
Les fascistes ont l’habitude du coup de poing, comme le montre le « cortège national de Jeanne d’Arc » d’avril 1925 qui a lieu malgré l’interdiction et fait 118 policiers et 150 camelots blessés, 220 étant arrêtés. Ils pratiquent très largement la démagogie « anticapitaliste » et mènent des actions « populaires » : assistance sociale, entraide matérielle, soupes populaires, maisons de convalescence, foyers de jeune, colonies de vacances, chorales, groupes de théâtre...
 C’est dans cette atmosphère pesante que la SFIC dirige la lutte, la vague de grèves reprenant vigueur, notamment celle des usines Citroën qui dure de la fin mars au 9 mai, avec un comité de grève de 120 représentants des travailleurs. De nombreuses marches de la faim sont organisées par des chômeurs, avec notamment la grande marche des chômeurs de Saint-Nazaire sur Nantes et celle de ceux du Nord sur Paris.
C’est dans cette atmosphère pesante que la SFIC dirige la lutte, la vague de grèves reprenant vigueur, notamment celle des usines Citroën qui dure de la fin mars au 9 mai, avec un comité de grève de 120 représentants des travailleurs. De nombreuses marches de la faim sont organisées par des chômeurs, avec notamment la grande marche des chômeurs de Saint-Nazaire sur Nantes et celle de ceux du Nord sur Paris.
Les travailleurs socialistes se rapprochent parfois des communistes, notamment avec la Fédération socialiste des Vosges qui signe un manifeste critiquant le refus de l’unité de la social-démocratie en Allemagne et en France, ou encore dans le cadre de la grande campagne internationale de soutien au communiste bulgare Dimitrov, accusé par les nazis de l’incendie du Reichstag, et qui sera finalement acquitté.
Une figure du rapprochement entre socialistes et communistes est Jean Zyromsky, fondateur du comité d’action socialiste pour l’Espagne, pays où il ira onze fois entre 1936 et 1939 ; il deviendra lui-même communiste en 1945. A l’été 1933, la tendance représentée par Zyromsky au sein des socialistes a 300 mandats sur 3500 et s’oppose directement au courant dit « néo-socialiste », qui considère que les classes moyennes remplacent la classe ouvrière comme protagoniste révolutionnaire. Cette tendance finira dans le camp du fascisme.
C’est avec une large compréhension des contradictions au sein des socialistes que la SFIC lance son « Appel du comité central aux ouvriers socialistes », dans l’Humanité du 12 novembre 1933 : « Tous ensemble du même côté de la barricade, pour défendre notre salaire, pour la diminution de la journée de travail, pour l’allocation de chômage, pour de véritables assurances sociales, contre le fascisme et la guerre impérialiste, pour la libération de notre classe. »
L’occasion d’éprouver cette tendance à l’unité va alors arriver à l’« affaire Stavisky », le suicide du « beau Sacha » - le Canard enchaîné de l’époque titra « Stavisky s’est suicidé d’une balle tirée à 3 mètres. Voilà ce que c’est que d’avoir le bras long » - révélant un énorme scandale financier et donnant un prétexte aux ligues fascistes pour un passage à l’action, surtout que le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, réputé pour son indulgence pour l’extrême-droite, est limogé. Le 6 février 1934 les ligues se lancent à l’assaut du parlement protégé par la police sur le pont de la Concorde ; les affrontements font 17 morts et 2309 blessés.
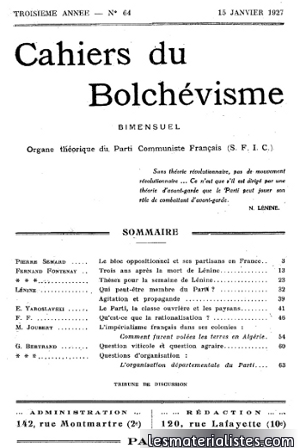 L’impression sur la gauche est énorme. Les socialistes lancent le jour même le mot d’ordre « Mobilisation du Parti ! Tout le pouvoir aux travailleurs ! » (Le Populaire, 6 février 1934). Le 7 février au matin ils décident d’une manifestation pour le lendemain, l’annulant l’après-midi même après une entrevue avec le président Doumergue où celui-ci a expliqué qu’il ne l’autoriserait pas.
L’impression sur la gauche est énorme. Les socialistes lancent le jour même le mot d’ordre « Mobilisation du Parti ! Tout le pouvoir aux travailleurs ! » (Le Populaire, 6 février 1934). Le 7 février au matin ils décident d’une manifestation pour le lendemain, l’annulant l’après-midi même après une entrevue avec le président Doumergue où celui-ci a expliqué qu’il ne l’autoriserait pas.
Ce sont les communistes qui vont assumer le combat, seuls, mais rejoints par la base socialiste. Le soir du 6 février, Maurice Thorez lançait déjà à la Chambre des députés venant d’être assiégé un appel « à tous les prolétaires et à nos frères les ouvriers socialistes pour qu’ils viennent dans la rue chasser les bandes fascistes. » L’appel lancé dans l’Humanité du 8 février 1934 est explicite : « Travailleurs communistes, socialistes, unitaires, confédérés, sans-parti, rassemblez-vous dans vos usines, dans vos localités, venez ensemble à la manifestation ! A l’exemple des syndicats unitaires qui proposent la préparation immédiate d’une grève de 24 heures, réalisez dans toutes les usines, bureaux, dépôts, chantiers, votre front unique d’action ! Organisez la grève politique de masse ! (...) Travailleurs socialistes , votre salut comme le nôtre, comme celui de toute la classe ouvrière, est dans notre action commune. Celle-ci peut et doit se réaliser sur les mots d’ordre de classe de la manifestation de vendredi. »
Malgré les fascistes et les rafles préventives de la police, on se bat toute la soirée du 9 février, de la place de la République à la gare de l’Est. 50 000 travailleurs manifestent, souvent rejoint par des socialistes qui abandonnent leurs permanences où la direction avait pourtant exigé qu’ils restent. Les affrontements se prolongent dans la nuit, avec un bilan terrible et toujours ignoré des livres d’histoire : 6 morts, 60 blessés par les balles de la police et 1000 par les matraques et les mousquetons.
L’impact est si grand dans la classe ouvrière que la CGT qui refusait tout contact avec les communistes est obligée d’appeler à rejoindre la grève du 12 février, à laquelle participent finalement 4 500 000 travailleurs. Des milliers de manifestations ont lieu dans tout le pays. Le 17 février, 200 000 travailleurs participent aux obsèques de ceux tombés le 9. Les affrontements avec les fascistes sont ininterrompus jusqu’en juin ; 11 antifascistes tomberont encore.
La tension est perceptible : le 20 avril 40 000 travailleurs et fonctionnaires manifestent à Paris et des dizaines de milliers dans le reste du pays, puis 30 000 à Paris le 1er mai malgré les provocations policières qui amènent même à des affrontements dans les cités populaires d’Alfortville et du XIIIème arrondissement de Paris. Et si les socialistes refusent la proposition du mouvement Amsterdam-Pleyel concernant la lutte commune contre le fascisme, une forte minorité se dégage, avec 1301 mandats contre 2324, en faveur de « l’unité d’action sur des bases révolutionnaires avec les communistes. »
La SFIC tient alors sa conférence nationale à Ivry, du 23 au 26 juin 1934, avec comme thème à l’ordre du jour l’organisation du front unique de lutte antifasciste, au moment où s’expriment dans la CGT de larges mouvements de base allant dans le sens de l’union.
La résolution de la conférence affirme ainsi : « Le Parti Communiste travaille sincèrement à l’organisation de front unique de la lutte antifasciste. Il réprouve ceux qui considèrent le front unique comme une manoeuvre. Il veut réellement le front unique pour défendre les revendications des masses laborieuses et pour barrer la route au fascisme et à la guerre. Des hommes comme Treint, pour qui la tactique du front unique consistait à « plumer la volaille », ont été exclus du Parti Communiste pour une pareille orientation et ont trouvé un refuge auprès du contre-révolutionnaire Trotsky avant de passer à la social-démocratie. Le scissionniste Doriot prend la même voie lorsqu’il considère le front unique comme une manœuvre, lorsqu’il escompte un refus du Parti Socialiste qu’il espère utiliser pour « plumer la volaille ». »

La stratégie est expliquée de cette manière : « Les fascistes luttent contre la « démocratie » bourgeoise pour sa destruction. Les communistes, eux, luttent contre toutes les formes de la « dictature bourgeoise », même lorsque cette dictature revêt la forme de la démocratie bourgeoise. Mais les communistes ne se désintéressent jamais de la forme que revêt le régime politique de la bourgeoisie.
Ils démasquent, d’une manière concrète, le processus de la dégénérescence réactionnaire de la démocratie bourgeoise frayant la voie au fascisme. Mais ils ont défendu, défendent et défendront toutes les libertés démocratiques conquises par les masses elles-mêmes, et en premier lieu tous les droits de la classe ouvrière.
Ce qui constitue la différence de principe entre les communistes et les socialistes dans cette question, c’est le fait que les socialistes, sous prétexte de défense de la démocratie et de la République, aboutissent à la défense de la dictature de classe de la bourgeoisie. Les communistes défendent les libertés démocratiques conquises par les masses afin de mieux rassembler et organiser ces dernières contre le capital et la dictature de la bourgeoisie. »
Il est également décidé de renoncer à toutes attaques ou critiques contre les organisations socialistes participantes dans la propagande orale ou écrite de l’Humanité, des Cahiers du bolchévisme et de la presse écrite de province. Au discours de clôture Maurice Thorez déclare : « A tout prix nous voulons l’action. A tout prix nous voulons l’unité d’action. »
Mais au-delà de l’unité d’action, un autre aspect se révèle alors dans les positions de Maurice Thorez. Le rapport à la conférence disait ainsi : « Pour vaincre, le mouvement antifasciste doit avoir une base ouvrière solidement enracinée dans l’usine ; la classe ouvrière doit donner l’exemple de la lutte revendicative et parvenir de la sorte à entraîner toutes les autres couches sociales frappées par le capital, car sans les classes moyennes, nous ne saurions vaincre le fascisme. »
C’est-à-dire que Thorez décide d’utiliser une technique politique, celle de retourner la culture démocratique issue de 1789 contre la bourgeoisie, c’est-à-dire de retourner contre la bourgeoisie de l’époque de l’impérialisme sa propre culture de l’époque démocratique. Alors que, auparavant, les références idéologiques à la révolution bourgeoise de 1789 étaient rejetées comme impropres à l’idéologie prolétarienne, désormais pour des raisons tactiques elles deviennent nécessaires.
A partir de la conférence, le mouvement pour le front unique est irrésistible. Les Jeunesses Communistes et les Jeunesses Socialistes signent un accord sur le plan national, tandis que des initiatives communes ont lieu fédération par fédération pour la SFIC et la SFIO. Ainsi a lieu le 3 juillet un grand meeting de 25,000 travailleurs à Paris à l’appel des sections de chaque parti pour la région Paris-ville. Les mêmes initiatives se développent à Lyon, Marseille...
Et l’Humanité peut affirmer le 10 juillet 1934 : « Chaque jour, un nouveau maillon s’ajoute à la chaîne du front unique. » Date symbolique de la nouvelle ligne, les délégations de la SFIC et de la SFIO se voient le 14 juillet, le conseil national de la SFIO acceptant le lendemain les propositions d’action unie contre le fascisme et la guerre par 3741 voix contre 336 et 67 abstentions. Selon le pacte d’unité d’action socialiste-communiste, qui paraîtra dans l’Humanité du 22 juillet 1934, les deux organisations s’engagent « à organiser en commun et à participer avec tous leurs moyens (organisations, presse, militants, élus, etc.) à une campagne dans tout le pays, et ayant pour but : a) mobiliser toute la population laborieuse contre les organisations fascistes, pour leur désarmement et leur dissolution ; b) pour la défense des libertés démocratiques, pour la représentation proportionnelle et la dissolution de la Chambre [des députés] ; c) contre les préparatifs de guerre ; d) contre les décrets-lois ; e) contre la terreur fasciste en Allemagne et en Autriche, pour la libération de Thaelmann [dirigeant communiste allemand emprisonné] et de Karl Seitz [dirigeant socialiste autrichien emprisonné] et de tous les antifascistes emprisonnés. »
Le pacte précise également, ce qui est un succès clair pour les communistes par rapport à la position initiale de la social-démocratie : « Cette campagne sera menée au moyen de meetings communs dans le plus grand nombre de localités et d’entreprises, au moyen de manifestations et de contre-manifestations de masse dans la rue, en assurant l’auto-défense des réunions ouvrières, des manifestations, des organisations et de leurs militants... »
3. Document : « Un monde nouveau vu à travers un homme »
Henri Barbusse a synthétisé sa connaissance de l’Union Soviétique, où il avait d’ailleurs des relations personnelles avec de nombreux responsables, dans un document paru en 1935 et intitulé « Staline, un monde nouveau vu à travers un homme. » Ici un extrait du dernier chapitre, « Un homme à la barre », qui montre la conception qui existait alors par rapport à Staline en tant que dirigeant de l’URSS mais également du mouvement communiste international.
« Nous croyons à notre Parti, disait Lénine. Nous voyons en lui l’esprit, l’honneur et la confiance, de notre époque. ». « N’est pas de ce parti qui veut, dit Staline. Il n’est pas donné à chacun d’en affronter les labeurs et les tourments. » Si Staline a foi dans la masse, la réciproque est vraie. C’est un véritable culte que la Russie Nouvelle a pour Staline, mais un culte fait de confiance, et jailli tout entier d’en bas.
L’homme dont la silhouette sur les affiches rouges, se détache, encastrée dans celles de Karl Marx et de Lénine, est celui qui s’intéresse à tout et à tous, qui a fait ce qui est et qui fera ce qui sera. Il a sauvé. Il sauvera. Nous savons bien que selon les paroles mêmes de Staline, « les temps sont révolus où les grands hommes étaient les principaux créateurs de l’histoire ». Mais s’il faut nier le rôle exclusif exercé sur les événements par le « héros », tel que le pose Carlyle, il ne faut pas contester son rôle relatif. Là aussi, il faut penser que ce qui est pareil, s’obéit.
Le grand homme est celui qui, prévoyant le cours des choses, le devance au lieu de le suivre et, préventivement, agit contre quelque chose, ou agit pour. Le héros n’invente pas la terre inconnue, mais il la découvre. Il sait susciter les vastes mouvements de masses — et pourtant ils sont spontanés —, tellement il en connaît les causes. La dialectique, bien appliquée, tire d’un homme ce qu’il contient — d’un événement aussi. Dans toutes les grandes circonstances, il faut un grand homme, comme une machine centralisatrice. Lénine et Staline n’ont pas créé l’histoire — mais ils l’ont rationalisée. Ils ont rapproché l’avenir.
Nous sommes faits pour faire produire ici-bas le plus de progrès possibles à l’esprit humain, car, en définitive, c’est cela que, pardessus tout, nous sommes les dépositaires : l’esprit. La loyauté de notre passage sur la terre, c’est d’éviter d’entreprendre l’impossible, mais d’aller aussi loin qu’on a de forces, dans la réalisation pratique. Il ne faut pas faire croire aux hommes qu’on les empêchera de mourir. Il faut vouloir les faire vivre pleinement et dignement. Il ne faut pas se jeter corps et âme sur les maux incurables, qui sont de la nature humaine, mais sur les maux guérissables, qui sont d’ordre social. On ne s’élèvera au-dessus de la terre que par des moyens terrestres.
Quand on passe, pendant la nuit, sur la Place Rouge, dans ce vaste décor qui semble se dédoubler : ce qui est de maintenant, c’est-à-dire de la nation de bien des gens du globe, et ce qui est d’avant 1917 (ce qui est antédiluvien) —, il vous semble que celui qui est allongé dans le tombeau central de la place nocturne et déserte, soit le seul qui ne dorme pas au monde, et qu’il veille sur ce qui rayonne tout autour de lui, de villes et de campagnes. C’est le vrai guide — celui dont les ouvriers riaient de constater qu’il était tellement à la fois le maître et le camarade, c’est le frère paternel qui s’est réellement penché sur tous. Vous qui ne le connaissiez pas, il vous connaissait d’avance, et s’occupait de vous. Qui que vous soyez, vous avez besoin de ce bienfaiteur.
Qui que vous soyez, la meilleure partie de votre destinée, elle est dans les mains de cet autre homme, qui veille aussi sur tous, et qui travaille —, l’homme à la tête de savant, à la figure d’ouvrier, et à l’habit de simple soldat.
