Aristote et la philosophie première – 1re partie : l'ouvrage «La métaphysique»
Submitted by Anonyme (non vérifié)La métaphysique est une compilation de textes attribués à Aristote.
La métaphysique est une compilation de textes attribués à Aristote.
Le titre de l'oeuvre désigne soit « après la physique », soit « au-delà de la physique ».
Aristote pose déjà le principe de la connaissance atteignant l’universel, par l’intermédiaire de la sensibilité accumulée.
« La métaphysique » n'appelle pas simplement à connaître les choses et leur fonctionnement, mais également à saisir leur nature et le caractère naturel de celle-ci.
Lénine a bien vu qu'il existe un parcours allant d'Aristote à Hegel.
De quoi parle Aristote dans « La métaphysique » ? L’œuvre consiste en fait en toute une série de réflexions sur les modalités propres à la mise en mouvement depuis le début de la chaîne.
out changement change quelque chose, par quelque chose, et en quelque chose.
La conception d'Aristote, c'est que l'être de chaque chose, c'est son accomplissement.
La substance immobile, c'est le moteur premier, qui meut mais n'est lui-même pas mu, qui s'accomplit lui-même et porte le principe universel du mouvement comme accomplissement. S'intéresser à cette substance mobile, c'est comprendre comment les choses peuvent exister.
Il faut bien voir une chose très particulière : d'un côté, Aristote dit que la substance la plus authentique n'a pas de matière, de l'autre que l'accomplissement ne se déroule que dans la matière.
Dans le livre XII, Lambda (Λ), il dit de manière formelle que :
« Aussi, Platon ne se trompe-t-il pas quand il dit qu’il y a [pure hypothèse, qu'Aristote réfute] autant d’Idées qu’il y a de choses dans la nature, si, toutefois, il y a des Idées différentes pour des choses telles que le feu, la chair, la tête, etc.
Le processus est le suivant : vue de la réalité => réalité composée de choses qu'on peut décrire => l'essentiel de ces choses est ce qui compte le plus => l'essentiel de ces choses existe en raison d'une cause => cette cause porte l'accomplissement de ce qui est causé => le fait d'aller de la cause au causé est porté par Dieu qu'on peut résumer par la formule cause=causé, modèle complet d'accomplissement.
Aristote a été réellement compris par la falsafa arabo-persane, avec Alfarabi, Avicenne, Averroès.
Il est frappant de voir qu'à de nombreuses dans « La métaphysique », Aristote souligne plusieurs une erreur, en disant qu'elle reviendrait à se perdre dans l'infini. L'appréhension de l'infini est systématique chez Aristote, et c'est paradoxal, car pour lui l'univers a éternellement existé, parallèlement au moteur premier.
L’ interprétation du chapitre XV du Capital a une valeur décisive : selon la manière qu’on a de le comprendre, on a une vision particulière du capitalisme. Selon qu’on considère que la crise de ce dernier soit inévitable ou non, qu’elle prenne telle ou telle forme, on a des conclusions politiques fondamentalement différentes, s’appuyant de fait sur une compréhension radicalement différente du marxisme.
Au début du chapitre XV, Karl Marx réaffirme le principe de baisse tendancielle du taux de profit. Pour faire court, rappelons ici simplement que les capitalistes introduisent toujours plus de machines dans la production. Ils pensent ainsi rogner sur les dépenses de salaires, mais comme la vraie richesse vient de l’exploitation des ouvriers, ils scient la branche de l’arbre sur laquelle ils sont assis.
Immédiatement après les deux phrases sur le taux de profit, Karl Marx ajoute une phrase capitale :
« Ce qui d’un autre côté accélère à son tour l’accumulation, quant à la masse, bien que le taux de l’accumulation baisse avec le taux du profit. »
Le chapitre XV implique tellement de choses qu’en 3-4 pages, on a déjà la base de la conception de Rosa Luxembourg et celle d’Eduard Bernstein.
Pourtant, il reste encore à voir comment on en arrive à la crise du capitalisme : pour l’instant, on a seulement somme toute des déséquilibres (d’où Eduard Bernstein), ou bien une réduction ininterrompue du nombre de capitalistes (d’où Rosa Luxembourg).
Karl Marx, pour commencer, constate la chose suivante dans la seconde partie du chapitre XV. Les capitalistes peuvent soit mettre de côté des ouvriers, soit renforcer leur exploitation. Dans le premier cas, le taux de profit baisse, dans le second il augmente.
Or, même en augmentant le taux d’exploitation des ouvriers restants, on ne rattrapera pas le niveau d’exploitation acquis lorsqu’il y avait plus d’ouvriers. La baisse tendancielle du taux de profit semble inéluctable.
Voici un long passage dans lequel Karl Marx explique la nature de « crise » propre au capitalisme. Il faut ici bien faire attention : ce n’est pas une définition terminée, il reste une sous-partie, on n’en est ici qu’à la fin de la seconde sous-partie.
Il ne faut jamais perdre de vue que la question de la nature de la crise n’exige pas simplement une « logique » adéquate ; c’est indéniablement avant tout une question politique.
C’est la lecture politique de la réalité qui va prédéterminer la manière de saisir la crise du capitalisme et ses modalités. Cette question a pour cette raison été celle des grands débats dans l’Internationale Communiste dans les années 1920.
La sous-partie « Excédent de capital accompagné d’une population excédentaire » est aussi longue que les deux précédentes prises ensemble ; elle dispose qui plus est d’un addenda tout aussi long, qui fournit cependant des éléments secondaires, des précisions.
Elle est le prolongement direct de ce qu’a dit Karl Marx auparavant et présente les traits généraux de ce qu’est la crise du mode de production capitaliste au sens strict.
Immédiatement après avoir précisé dans quelle mesure la surproduction de capital n’est pas une « surproduction absolue tout court », Karl Marx précise dans quel cas elle serait une surproduction des moyens de production, une surproduction absolue.
Il faut comprendre la chose ainsi selon lui :
Jean-Sébastien Bach arrive à un moment historique où son activité peut être le produit de deux pôles contradictoires. Il y a, d'un côté, une véritable base luthérienne sur le plan musical.
Eugen Varga, au lendemain de la guerre, était un cadre considéré comme ayant de la valeur dans le contexte d'évaluations économiques. Il fut à ce titre du voyage de la centaine de conseillers accompagnant Molotov, en juin 1947 à Paris, pour discuter avec la France et la Grande-Bretagne au sujet de la question des aides.
Quelles étaient les thèses formulées dans Les changements dans l'économie du capitalisme comme résultat de la seconde guerre mondiale ?
Eugen Varga publia le premier chapitre de l'ouvrage dans la revue de l'Institut, en juillet 1944. Puis, quatre autres chapitres furent publiés par la suite, jusqu'en septembre 1945.
L'impact de l'ouvrage d'Eugen Varga fut tel qu'il fut décidé en mars 1947 d'organiser une discussion à ce sujet. Eugen Varga publia le même mois un article sur les « démocraties de nouveau type », affirmant que leurs Etats n'étaient ni capitalistes, ni socialistes, mais une forme radicalement nouvelle.
L'année 1947 fut celle où les partisans d'Eugen Varga furent contrés ; l'année 1948 fut celle de l'analyse du vargisme, Eugen Varga étant condamné comme relevant de « l'idéologie bourgeoise-réformiste ».
En apparence, le vargisme émerge donc en 1945, s'affirme ouvertement en 1946-1947, étant réfuté en 1947, puis vaincu en 1948. Dans les faits, Eugen Varga ne fut pas en mesure de publier d'ouvrage en 1951 et 1952, et pratiquement aucun article en 1948, 1949, 1950 et 1953, lui qui auparavant réalisait une avalanche d'ouvrages et d'analyses.
Le premier novembre 1951, 400 économistes se réunissent dans le bâtiment du Comité Central du PCUS(b), afin de travailler sur un manuel d'économie politique considéré comme nécessaire à établir, sous la supervision de Konstantin Ostrovitianov. À cette occasion, un rapport fut notamment établi sur la question de la possibilité et du caractère inévitable des guerres inter-impérialistes dans la période actuelle. Le point de vue d'Eugen Varga fut noté.
Eugen Varga feignit de saluer l'ouvrage de Staline et ses enseignements, lors d'un discours à l'Institut d'économie. Il n'en était rien en réalité et il s'empressera, dès qu'il le pourra, d'attaquer publiquement les chapitres cinq et six, qu'il prétendait reconnaître encore, donc, en 1952 :
Le concept du capitalisme monopoliste d’État formulé en Union Soviétique est une définition qui ne se veut pas moins qu'une nouvelle définition du capitalisme. Il y a le capitalisme, l'impérialisme, et il est censé y avoir un nouveau stade, caractérisé par une fusion entre les monopoles et l’État.
Il y a là une double remise en cause de l’idéologie communiste : dans l'affirmation de l’indépendance de l’État par rapport aux classes d’un côté, dans l'affirmation de la fusion entre cette entité « indépendante » et une classe de l’autre.
En 1963, Eugen Varga publia les Essais sur l’économie politique du capitalisme. Il y développe certaines questions du capitalisme monopoliste d’État, et notamment le fait que selon lui celui-ci soit un prolongement de l'impérialisme.
Il y aurait le capitalisme, l'impérialisme, puis le capitalisme monopoliste d’État :
« La transition finale au capitalisme monopoliste d’État commença seulement durant la Première Guerre mondiale (…).
Les Essais sur l’économie politique du capitalisme forment un ouvrage important, car il s'agissait d'une puissante contribution à l’idéologie révisionniste ayant alors triomphé en URSS. Eugen Varga agit ici comme l’un des passeurs, comme l’une des figures historiques contribuant à accorder la légitimité satisfaisante à la nouvelle idéologie.
Dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme, Eugen Varga rétablit bien entendu également ouvertement par ailleurs sa théorie comme quoi l’État en pleine guerre est capable de « planifier », même s’il précise que ce n’est pas dans un sens soviétique. Il la généralise en affirmant que l’Inde a également un plan désormais où l’État est capable d’avoir un réel effet sur l’économie :
Dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme, Eugen Varga affirme de manière ouverte son soutien au parlementarisme. C'est là tout à fait conforme, dans sa substance même, à la démarche de Nikita Khrouchtchev, mais c'est surtout la conclusion logique du capitalisme monopoliste d’État.
Eugen Varga formule également dans les Essais sur l’économie politique du capitalisme une thèse absolument essentielle au révisionnisme de Khrouchtchev. Il remet ouvertement en cause la thèse selon laquelle les luttes de libération nationale auraient besoin d'être dirigées par la classe ouvrière guidée par son Parti Communiste. Cette thèse serait « contraire aux faits ».
Eugen Varga fut porté aux nues par le révisionnisme, et cela dès qu'il y eut la marge de manœuvre pour le faire. Il reçut l'ordre de Lénine dès 1954, à l'occasion de ses 75 ans. Il reçut également ce qui s'appelait encore le prix Staline, ce qui est très ironique dans la mesure où célébrer Eugen Varga un an après la mort de Staline, c'était ouvertement attaquer ce dernier.
Le dossier sur Eugen Varga publié par Les matérialistes est une contribution à la fois significative et majeure au mouvement communiste internationale.
Eugen Varga est une figure importante du Mouvement Communiste International, en tant qu'économiste extrêmement actif et prolifique. Basculant à droite, il devint le théoricien de la ligne qui sera celle de Nikita Khrouchtchev.
 Eugen Varga est né le 6 novembre 1879 à Nagytétény, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Budapest, la capitale de la Hongrie, dans ce qui était alors l'Autriche-Hongrie. Son père était instituteur, il perdit sa mère très jeune en raison de la tuberculose.
Eugen Varga est né le 6 novembre 1879 à Nagytétény, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Budapest, la capitale de la Hongrie, dans ce qui était alors l'Autriche-Hongrie. Son père était instituteur, il perdit sa mère très jeune en raison de la tuberculose.
Eugen Varga est historiquement lié à une philosophie de type moderniste, tout à fait représentative du milieu des jeunes intellectuels artistes hongrois et tchèques du début du siècle. L'opposition à l'Autriche combinait une orientation favorable au socialisme, mais aussi une dynamique portée, en connaissance de cause ou non, par la bourgeoisie nationale.
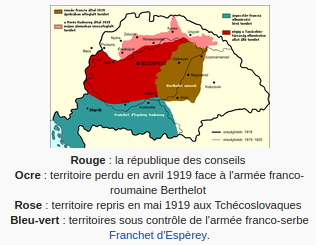 Lors de la révolution, les communistes de Hongrie furent immédiatement pris à la gorge. La production industrielle était tombée à 5 % de celle d'avant-guerre, les troupes tchèques et roumaines occupaient les charbonnages. En refusant le traité de Versailles, le nouveau régime était de facto en guerre, avec une opposition armée supervisée et épaulée par l'impérialisme français.
Lors de la révolution, les communistes de Hongrie furent immédiatement pris à la gorge. La production industrielle était tombée à 5 % de celle d'avant-guerre, les troupes tchèques et roumaines occupaient les charbonnages. En refusant le traité de Versailles, le nouveau régime était de facto en guerre, avec une opposition armée supervisée et épaulée par l'impérialisme français.
Eugen Varga écrivit également au sujet de la révolution hongroise L'organisation économique de la république hongroise des conseils, ainsi que La question agraire dans la révolution prolétarienne hongroise. Il le fit cependant en Russie, où il dût émigrer.

L'Institut qu'Eugen Varga rejoignit existait depuis peu de temps ; il était le fruit d'une intense activité intellectuelle, notamment autour de Theodore Rothstein.
Eugen Varga écrivit en 1921 des études particulières comme La situation économique de l'Europe continentale et La situation politique et sociale de l'empire britannique, mais surtout il réalisa en quatre semaines, en mai, une petite brochure d'une soixantaine de pages intitulée La crise de l'économie mondiale capitaliste.
La crise de l'économie mondiale capitaliste fut une œuvre ayant un vrai retentissement, de par son lien avec le congrès de l'Internationale Communiste en 1921. Le point de vue d'Eugen Varga tournait dans cette période autour d'un axe très précis : le décrochage complet des pays d'Europe centrale, c'est-à-dire notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne.
Eugen Varga, après avoir donc dressé une vue d'ensemble de la situation dans La crise de l'économie mondiale capitaliste en 1921, conclut cet ouvrage sur la thèse suivante. Les sociaux-démocrates ont selon lui tort de penser que le capitalisme est en train de redémarrer ; ils sont aveuglés par le démarrage de 1918-1921 qui ne s'appuie que sur les espaces ouverts par la fin de la guerre.
Dans La période du déclin du capitalisme, Eugen Varga visa à faire le portrait général du schéma caractérisant la crise capitaliste en cours. Son objectif était d'autant plus complexe que, comme il le reconnaît lui-même alors, le capitalisme ne se redresse pas, malgré une amélioration certaine de l’économie des États-Unis, de l'Angleterre, du Japon et de la France.
Eugen Varga synthétise concrètement sa conception en s'appuyant sur le principe du déséquilibre.
Auparavant, de par la hausse de la productivité et la croissance du marché mondial, les déséquilibres existant de par la nature chaotique de la production capitaliste finissaient immanquablement par se résorber d'une manière ou d'une autre.
Eugen Varga aborde la France dans La période du déclin du capitalisme en expliquant sa situation assez paradoxale. Voici ce qu'il en dit, annonçant de manière tout à fait juste, en 1922, l'effondrement de 1940.
« Les rapports économiques de la France sont plus avantageux que ceux de l'Angleterre dans la mesure où elle dispose d'une plus grande base agricole, et qu'elle peut s'auto-approvisionner en denrées lors d'une récolte normale.
En mai 1924, Eugen Varga reprit le cours de son analyse dans Montée ou déclin du capitalisme. C'était là un tournant pour lui, car sa méthode touchait ici sa limite. Eugen Varga était obligé de constater que la situation est très complexe, trop complexe ; il ne parvenait plus à en faire une description générale en s'appuyant sur des statistiques, comme auparavant.
Il était obligé de reconnaître qu'il était dépassé :
Les trois brochures eurent des réceptions qu'il faut prendre en compte, sans les surestimer. Si La crise de l'économie mondiale capitaliste fut largement lu, il n'en fut cependant nullement question lors du troisième congrès, Eugen Varga lui-même n'intervenant pas.
Eugen Varga fut beaucoup plus présent lors du cinquième congrès. C'est lui qui fit le long exposé sur La situation économique mondiale, où il exposa la ligne de l'Internationale Communiste selon laquelle on est bien dans le déclin du capitalisme, mais que ce déclin a des cycles et que les gauchistes ont tort de voir les choses de manière unilatérale et de croire à un effondrement capitaliste à très court terme.
Il dut pour cela faire face à une critique de Radek :
Une fois lancée dans les années 1920 dans ses analyses, Eugen Varga ne s'arrêta plus et s'orienta toujours davantage vers deux questions : la crise d'un côté, les monopoles de l'autre. Il va affiner toujours plus ses positions.
Eugen Varga avait déjà connu plusieurs critiques. Le 25 octobre 1924 la Pravda publia notamment un article de Vladimir Milioutine, le directeur de l'institut agraire de l'Académie communiste à Moscou, « Le révisionnisme agraire ». Il s'agissait d'une critique en règle de l'ouvrage publié par Eugen Varga, Contributions à la question agraire, contenant des articles et conférences réalisés en Russie, ainsi qu'un chapitre de son ouvrage de 1919, au sujet de la répartition des terres en Hongrie et de la réforme nécessaire.
Le problème dans la démarche d’Eugen Varga, c’est que sa conception ramène immanquablement à celle de Rosa Luxembourg. Cette dernière, reprenant Le capital, dit que Karl Marx n’a pas résolu le problème du démarrage de l’accumulation capitaliste. Elle théorise qu’un tel démarrage ne peut avoir lieu que par l’intégration de zones non capitalistes dans le processus.
Voici comment Eugen Varga expose sa thèse sur le chômage organique, en 1928.
« Le chômage en masse chronique au cours de la période d'après-guerre est un fait bien connu.
Nous étions disposés à ne le considérer que comme la conséquence des troubles profonds apportés dans l'équilibre de l'économie mondiale (industrialisation des pays d'outre-mer, appauvrissement de l'Europe, crise agraire).
Certes, tous ces facteurs constituent des causes partielles du chômage.
Une fois qu'il a évacué l'aspect de l'accumulation capitaliste non monopoliste, Eugen Varga limite toute la perspective au capital monopoliste. Le mode de production capitaliste ne consiste alors plus en l'accumulation du capital, mais en un système monopoliste parasitaire.
Là où Karl Marx est dialectique, Eugen Varga est mécanique. Il ne comprend pas le mouvement contradictoire du capital, en « ligne-spirale » comme le dit Karl Marx.
L’origine du problème d'Eugen Varga est qu’il a une lecture purement spatiale de la production, et qu’il oublie le temps. Il perd donc le principe du saut qualitatif, car l'espace en contradiction avec lui-même produit le temps, comme expression du mouvement.
La critique qu'a subi Eugen Varga au sixième congrès de l'Internationale Communiste va se prolonger et va connaître un moment décisif lors de la Xe session du Comité Exécutif de l'Internationale Communiste, du 3 au 19 juillet 1929.
En 1938, Eugen Varga publia Deux systèmes : économie socialiste et économie capitaliste. Et à ce titre, on y trouve une sorte de rectification, d'autocritique par rapport aux critiques faites lors du VIe Congrès et au XIe plénum de l'Internationale Communiste.
Eugen Varga, à partir de sa mise à l'écart relative dans les années 1930, se pliait malgré tout aux exigences du Parti.
Essayons de résumer, dès le départ, la démarche de Hegel, qui est difficile à saisir de par son haut niveau de problématisation. Cela est nécessaire pour comprendre son approche, qui consiste à affirmer que le fini s'auto-transforme, et par conséquent porte en lui la notion d'infini.
Hegel se situe dans le prolongement d'Emmanuel Kant ; son mérite historique, avec cette notion d'infini qu'il apporte, est d'affirmer l'espace, là où Emmanuel Kant avait déjà affirmé le temps.
La grande référence mise en avant par Hegel dans La science de la logique est la lettre dite « sur l'infini », écrite par Spinoza à Louis Meyer, le 20 avril 1663. Hegel fait de nombreuses références à Spinoza et son objectif est clairement d'approfondir le système de celui-ci, de lui fournir ce qu'il considère être comme manquant. Hegel se place en disciple et en continuateur de Spinoza.
Voici ce que dit Spinoza dans la lettre, au sujet de l'infini, dans un document d'une densité exceptionnelle
La lettre de Spinoza est extrêmement intelligente et représente l'un des plus hauts points de la conscience matérialiste humaine, à l'époque déjà cela va de soi, mais y compris aujourd'hui. Elle pose la nature infinie de la réalité, qu'une approche en termes finis ne peut pas saisir.
La connaissance est donc un processus, mais quelle est la nature de ce processus dans son fondement même ?
Lénine a su retrouver dans La science de la logique le noyau matérialiste présentant le caractère dialectique du mouvement ; il a bataillé pour retrouver les éléments adéquats. Voici comment, dans ses notes, il exprime notamment sa joie lorsqu'il est en mesure de le faire :
L'approche de Hegel préfigure le matérialisme dialectique. Il dit ainsi, de manière juste :
On comprend la situation dans laquelle se sont retrouvées Karl Marx et Friedrich Engels. D'un côté, Hegel rejetait de manière adéquate les mathématiques comme forme figée, de l'autre Hegel basculait dans une logique des choses autonome des choses elles-mêmes.
Au-delà de la critique des mathématiques pour sa nature formaliste - objectiviste et de la physique moderne pour ses conceptions idéalistes la bloquant dans son développement, Lénine puise également la dialectique de la nature dans Hegel, avec Hegel et contre Hegel.
Hegel, en ne faisant pas de la matière la base du processus dialectique, est obligé de basculer dans une série d'erreurs idéalistes, qui justement feront que Karl Marx dira de cela qu'il s'agit de tout remettre sur ses pieds.
Hegel repart donc de là où il était arrivé, par impossibilité de se rapporter à la matière en tant que telle ; il passe des centaines de pages à formuler une sorte de subjectivisme affirmant saisir les modalités dialectiques de l'existence. Les errements dans La science de la logique rendent son étude fastidieuse, malgré les éléments essentiels qu'on y trouve.
Le mysticisme a besoin d'un Dieu et chez Hegel, cela va être l'infini. Il devait immanquablement en arriver là, pour compenser l'absence de matière. Ce qu'est la matière pour le matérialisme dialectique consiste en l'infini pour la logique dialectique hégélienne, là est la différence entre le matérialisme marxiste et l'idéalisme hégélien.
On voit aisément dans quel terrible imbroglio se retrouve Hegel. Pour lui, de manière juste, une chose, prise en elle-même, est en effet la négation du fait d'être en rapport avec autre chose, et inversement dans son rapport avec autre chose, la chose est alors négation d'être simplement elle-même, les choses extérieures faisant intervenir un rapport de négation de la négation.
Concernant les mathématiques elles-mêmes, Ernst Kolman et Sonia Yanovskaya ont publié un long article au sujet de ce thème, dans la revue philosophique du PCUS(b), Sous la bannière du marxisme, en 1931.
Il ne suffit pas de prendre conscience de la réalité sociale, il faut également faire le choix de ne pas céder à la corruption, faire le choix de participer à la transformation du monde, se positionner de manière adéquate dans le rapport entre révolution et contre-révolution.
Ouvriers,
C'est un fait très remarquable que la misère des masses travailleuses n'a pas diminué de 1848 à 1864, et pourtant cette période défie toute comparaison pour le développement de l'industrie et l'extension du commerce. En 1850, un organe modéré de la bourgeoisie anglaise, très bien informé d'ordinaire, prédisait que si l'exportation et l'importation de l'Angleterre s'élevaient de 50 %, le paupérisme tomberait à zéro.
[Rédigés par Karl Marx.]
Considérant :
Le Parti Socialiste SFIO ne s'est pas unifié en faisant un saut qualitatif. Ce n'est pas un parti de type social-démocrate ; il n'a pas d'orientation déterminée.
Le Parti Socialiste SFIO est né sur un certain terrain, où il se renforce, mais il ne parvient pas à capitaliser sa présence ; il ne parvient à faire un saut qualitatif jusqu'à une présence historique dans l'histoire du pays.
Sa vie et sa mort sont un exemple qu’aucun combattant pour la liberté ne pourra oublier.
Le chant révolutionnaire « L'Internationale », hymne communiste international, date de la fin du 19e siècle, à l'époque où fut fondée l'Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.), rassemblement des premières forces révolutionnaires mondiales.
Une fois dans la Ligue des justes, Marx et Engels ont une influence considérable en supprimant les conceptions petites-bourgeoises.
Prolétaires de tous les pays unissez-vous !
Article 1. - Le but de la Ligue est le renversement de la bourgeoisie, la domination du prolétariat, l'abolition de la vieille société bourgeoise, fondée sur les antagonismes de classe, et l'instauration d'une société nouvelle, sans classes et sans propriété privée.
L'événement qui amena la fondation de l'Association Internationale des Travailleurs fut la rencontre entre d'un côté l'activité de Karl Marx épaulé par Friedrich Engels, de l'autre le développement du mouvement ouvrier anglais et français, qui tissèrent des liens.
Avant l'Association Internationale des Travailleurs, les travailleurs avancés culturellement dans la cause ouvrière étaient dispersés et sur le plan idéologique, leurs conceptions était instables, oscillantes, partant tendanciellement soit dans le réformisme, soit dans le radicalisme.
L'opposition entre Tolain et Marx reflète dans l'A.I.T. toute une approche quant à la question révolutionnaire. Il y a d'un côté la tendance voyant les choses de manière historique, recherchant par conséquent à élaborer un savoir scientifique. De l'autre, il y a les gens qui sont ouvriéristes, s'intéressent aux revendications immédiates, tendent au pragmatisme, nient l'importance de la théorie ni de la question précise de la prise du pouvoir.
Le structuraliste se prétendant marxiste le plus connu est Louis Althusser.
Le structuralisme s'est d'autant plus développé qu'il profitait des intellectuels bourgeois faisant carrière et à qui on donnait du prestige s'ils fournissaient une conception à la fois utile pour les connaissances, mais surtout sans encadrement historique, matériel. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'appui unilatéral de Claude Lévi-Strauss à Georges Dumézil.
Dans Le Cru et le Cuit, Clause Lévi-Strauss affirme :
« Nous ne prétendons pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes, et à leur insu. »
C'est ensuite l'école dite de Prague qui prolongea la lecture de Ferdinand de Saussure, avec notamment Roman Jakobson et Nicolas Troubetskoï, par une série de travaux entre 1929 et 1939, dans le pays de l'est européen le plus développé sur le plan du capitalisme.
La notion d'ensemble n'est pas la seule idée associée au concept de « structure ». Il y a également l'idée d'une forme d'évolution particulière. Tout comme une langue connaîtrait une évolution linéaire, la « structure » connaît une évolution du même type.
L'idée est la suivante : la langue évolue jusqu'à ce que des différences très marquées soient visibles à l'échelle des siècles, alors qu'en même temps chaque génération comprenait pourtant la précédente. Il en irait de même pour la structure.
Le terme de structure tel qu'il est employé par le structuralisme s'appuie sur une conception formulée par Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale, en 1916, publié à partir de notes de ses élèves.
Le précis d'histoire du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchévik) est le document le plus important produit par l'Union Soviétique de la période socialiste.
La Russie tsariste était entrée plus tard que les autres pays dans la voie du développement capitaliste. Jusqu’aux années 60 du siècle dernier, il n’y avait en Russie que très peu de fabriques et d’usines.
À la fin du XIXe siècle avait éclaté en Europe une crise industrielle, qui s’étendit bientôt à la Russie.
Dans les années de crise de 1900 à 1903, près de 3.000 entreprises grandes et petites fermèrent leurs portes.
On jeta à la rue plus de 100.000 ouvriers. Les salaires des ouvriers restés dans les entreprises étaient en forte baisse.
Dès la fin du XIXe siècle, les États impérialistes avaient engagé une lutte intense pour la domination de l’océan Pacifique et le partage de la Chine. La Russie tsariste, elle aussi, participait à cette lutte.
La IIe Douma d’État avait été dissoute par le gouvernement tsariste le 3 juin 1907.
À la suite du XIVe congrès, le Parti déploya la lutte pour l’application de l’orientation générale du pouvoir soviétique vers l’industrialisation socialiste du pays.
Quels sont les enseignements essentiels à tirer de l’œuvre historique accomplie par le Parti bolchévik ?
De 1931 à 1940 exista en URSS un Institut pan-union de statistiques picturales de la construction et de l'économie soviétiques, connu sous le nom d'Izostat. Cet organisme d’État avait comme but d'informer les masses soviétiques du développement du pays, au moyen d'images particulièrement travaillées.
Au début 1940, l'Izostat se transforma en Gosplanizdat, c'est-à-dire la maison d'édition d'État pour l'information économique, de planification et statistique du Comité de planification d'état de l'URSS, qui imprimait des livres, des manuels, des brochures, des rapports et d'autres documents sur des sujets économiques et statistiques.
Fils d'un important économiste autrichien, Otto Neurath avait étudié les mathématiques, les sciences naturelles et la philosophie à Vienne, avant de partir faire ses études à Berlin, sur les conseils de l'important sociologue allemand Ferdinand Tönnies. Il obtint ses diplômes pour des études sur l'histoire économique de l'antiquité, l'ouvrage de Cicéron De Officiis, ainsi que sur l'économie non-monétaire en Égypte.
Le moment-clef qui fit qu'Otto Neurath fut réellement en mesure d'avancer et d'intéresser l'Union Soviétique alors en construction fut l'ouverture par celui-ci à Vienne d'un musée de la société et de l'économie, où il monta des équipes formant des pictogrammes.
Otto Neurath appela le système d'images qu'il avait mis en place ISOTYPE, acronyme d'International System of Typographic Picture Education (Système International d'Education par l'Image Typographique) ; le graphiste Gerd Arntz joua un rôle important.
Otto Neurath voyait l'ISOTYPE comme contribution à l'unification de l'humanité, par l'intermédiaire d'un langage universel ; que sa ligne de réduction de l'information à une image ait pu si plaire à des gens liés historiquement au futurisme en dit long sur la nature subjectiviste de la quête d'un tel langage. En arrière-plan, on trouve le Cercle de Vienne.
Pierre Drieu La Rochelle représente l'obsession de la décadence telle que ressentie par un petit-bourgeois intellectuel, qui fut également un bourgeois rentier : deux aspects de sa vie privée que Pierre Drieu La Rochelle ne fut jamais en mesure de concevoir correctement.
Pierre Drieu La Rochelle dénonce Balzac et la raison sociale, mais son seul réel roman, Rêveuse bourgeoisie, se situe entièrement dans cette tradition. Il dénonce le raffinement pittoresque, mais c'est précisément le point faible de sa très grande nouvelle Le feu follet, qui décrit un dandy héroïnomane se précipitant dans le suicide.
Friedrich Engels avait noté que Balzac, un romantique, un réactionnaire, décrivait la réalité tellement méticuleusement, tellement fidèlement, qu'il bascule dans le réalisme.
On a la même chose avec Rêveuse bourgeoisie, publié en 1937, véritable expression de la contradiction au cœur de la quête d'un « socialisme fasciste » par Pierre Drieu La Rochelle.
Pourquoi Le feu follet, publié en 1931, n'a-t-il pas été considéré en France comme relevant fondamentalement de l'approche soulevée par le matérialisme dialectique ?
Si Pierre Drieu La Rochelle avait lu Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky, les auteurs principaux de la social-démocratie, ou encore Lénine et Staline, il aurait bien vu qu'il était parlé de différentes classes, de différenciation à l'intérieur de celles-ci, même si le moteur d'un mode de production dépend d'une opposition dialectique entre deux classes.
Pierre Drieu La Rochelle est un disciple de Georges Sorel et il tente comme lui, désespérement, de maintenir la fiction de la permanence de l'individu à travers les changements sociaux. L'individu n'est pas ici naturel, et donc une composante d'un mode de production, mais une existence autonome existant de manière relative seulement dans une société donnée.
Le point de vue de Pierre Drieu La Rochelle allait dans le sens de l'unification des classes sociales, pour le maintien, la stabilité de l'ensemble social, permettant au petit-bourgeois de maintenir sa condition sociale.
Pierre Drieu La Rochelle bascule d'autant plus aisément dans l'agressivité du mythe mobilisateur de Georges Sorel que, philosophiquement, il est lui-même également un disciple de Nietzsche. Tout comme chez Sorel, on retrouve la quête de la transcendance par le « surhomme » formulée par Nietzsche.
Ce qui est le plus fou, c'est que Pierre Drieu La Rochelle ne départira jamais de cette posture romantique de type symboliste, surréaliste, décadentiste.
On est donc, avec le jeune Pierre Drieu La Rochelle, au croisement du symbolisme, du décadentisme (et donc surréaliste) et du futurisme.
La quête romantique de la fusion ultime passe nécessairement, chez Pierre Drieu La Rochelle comme tous les romantiques, par la question du corps.
Une preuve du romantisme fasciste de Pierre Drieu La Rochelle est son refus de la guerre. La petite-bourgeoisie a en effet besoin de stabilité, pas d'une guerre où elle serait inévitablement affaiblie, manipulée. Mais c'est également l'expression d'une volonté de dépassement.
Dans l'immédiate après-guerre, avant de devenir un théoricien d'un prétendu Socialisme fasciste, Pierre Drieu La Rochelle se fait le grand partisan de la formation d'un bloc continental européen.
L'essai Le jeune européen est une tentative de formulation romantique d'un dépassement de sa situation personnelle historique pour aboutir, à travers l'ultra-subjectivisme, à la production d'un idéalisme « pur ».
Comment Pierre Drieu La Rochelle, avec son romantisme, caractérise-t-il la société? Dans Le jeune européen, Pierre Drieu La Rochelle exprime en fait une panique petite-bourgeoise devant le monde moderne, qui se résume pour lui en deux aspects : le machinisme d'un côté, l'égalitarisme de l'autre.
La preuve que Pierre Drieu La Rochelle est un romantique, c'est qu'il n'appuie pas sa critique sur une conception raciste ou nationaliste, mais en fait le besoin de l'humanité dans son essence même.
Pierre Drieu La Rochelle formule une définition du fascisme sur le plan des idées qui sera la même pour laquelle, cinquante ans après, l'historien israélien Zeev Sternhell sera décrié par les universitaires français.
Le 6 février était un coup de force de forces d'extrême-droite, seulement Pierre Drieu La Rochelle, et avec lui la mouvance de La Lutte des Jeunes, entend expliquer l'échec de celui-ci par le manque de dimension « socialiste ».
« Le prolétariat, est-ce que je le connais ? Je ne connais pas les ouvriers, pas plus que les paysans. Mais y a-t-il là quelque chose de spécifique à connaître ? Je ne le saurai jamais. Est-ce qu'il y a des classes ? Je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je le crois pas ? Parce que je suis un petit bourgeois. Je tiens à toutes les classes et à aucune. Je les déteste et les apprécie toutes. »
L'antisémitisme de Pierre Drieu La Rochelle n'est au départ qu'un préjugé de petit-bourgeois et de bourgeois, pour se transformer de plus en plus en paranoïa exterminatrice
L'antisémitisme était d'autant plus nécessaire à la démagogie de Pierre Drieu La Rochelle, à sa fantasmagorie, qu'il savait pertinemment que sa vision du monde ne tenait pas debout. Il était à la fois rattrapé par la petite-bourgeoisie – converger, oui, mais sans la fusion – et par son romantisme.
Il est fascinant de voir que cette fuite en avant de Pierre Drieu La Rochelle avait été en partie devinée et annoncée dans un article de l'Humanité de janvier 1923, dans un article intitulé « Jeunes hommes d'aujourd'hui ».
Initialement, Pierre Drieu La Rochelle fréquente en effet un milieu intellectuel bourgeois et son grand ami est Louis Aragon. Les soirées et la fréquentation des prostituées accompagnent une posture rebelle d'esprit grand bourgeois au-dessus des normes.
Gilles, très long roman, très largement autobiographique, décrit les aventures décadentes, nihilistes, opportunistes d'une figure tourmentée finalement plus vide qu'autre chose, malgré des tentatives expressionnistes à prétention existentialistes.
Il est évident que dans le roman Aurélien de Louis Aragon, le personnage éponyme est Pierre Drieu La Rochelle.
La carrière politique de Pierre Drieu La Rochelle après 1934 s'avéra un fiasco complet.
D'un côté, on a un État capitaliste devenu impérialiste et cherchant à agrandir son territoire dans la zone méditerranéenne, s'appuyant sur l'implantation historique d'une vaste population, avec aussi une conception du maintien de l'ordre extrêmement pragmatique et calculatrice.
De l'autre, on a une petite-bourgeoisie urbanisée prenant la tête de masses paysannes entièrement dominées par le féodalisme, afin de former un nouvel État pour pouvoir se transformer en bourgeoisie bureaucratique.
Les trois départements français d'Algérie – Alger, Constantine, Oran - furent fondés dès 1848, alors qu'un processus de colonisation s'organisait, au moyen d'une population européenne encouragée par la France à s'installer.
Le fondamentalisme a adopté une partie des revendications communistes et de manière générale le discours anti-colonial, qu'auparavant il était absolument impossible de formuler, en raison de sa base religieuse.
Le contexte de la seconde guerre mondiale modifia entièrement la situation en Algérie et la figure clef fut alors Ferhat Abbas.
Le fondamentalisme obtient son marqueur historique en 1945.
Le Front de Libération Nationale (FLN) avait commee seul dénominateur commun le mot d'ordre « allumer la mèche ».
L'État a historiquement été débordé par la militarisation à outrance de la guerre d'Algérie.
Il est ainsi possible de résumer la démarche de Georges Sorel par cet extrait des Réflexions sur la violence :
Chez Georges Sorel, la classe ouvrière transporterait l’Esprit de la révolution. C’est un vecteur, un outil. La classe ouvrière ne fait que porter l’idée.
Georges Sorel met en avant le mythe, c'est-à-dire une image nette permettant de transcender les combattants et d'unifier les efforts individuels.
Il est nécessaire, pour Georges Sorel, de procéder à l'héroïsation de l'individu pour qu'il soit prêt à la bataille. Il ne faut pas des cadres se sacrifiant pour le Parti, mais des individus affrontant la réalité pour eux-mêmes, dans le syndicat.
Georges Sorel, dans ses écrits, ne cesse de dénoncer Friedrich Engels et Karl Kautsky, les deux successeurs de Karl Marx, reconnus tels par la social-démocratie internationale. Il se pose en opposition complète au principe de rationalité et de conscience mis en avant par la social-démocratie, qui veut une classe ouvrière organisée, avec un parti d’avant-garde.
Chez Georges Sorel, la bourgeoisie est une classe non pas qui exploite comme chez Karl Marx, avec la question du taux de profit, etc., mais simplement une classe qui, en quelque sorte, règne. La bourgeoisie, devenue abrutie à force de domination, laisserait donc la place aux gestionnaires.
A la critique de la corruption s'associe un anarchisme petit-bourgeois viscéral, typique du proudhonisme.
Georges Sorel reste un auteur marginal ; il n’a été qu’un outil historique de l’affirmation de la « révolution fasciste » comme thèse politique. Mais il exprime également un véritable travers français, mêlant incompréhension du marxisme, l'éloge de la spontanéité et du coup de force par le mépris de l’intellect, la fascination pour l’union des contraires.
Il y a cinquante ans était constitué le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France (PCMLF), lors d'un congrès dans les Bouches-du-Rhône à Puyricard.
Malgré l'apparence de radicalité, SHAC n'était rien d'autre qu'un mouvement moraliste agressif entièrement réformiste, totalement dénué de proposition révolutionnaire.
L'ALF était né comme rupture révolutionnaire, en-dehors du consensus dominant et de l'encadrement des syndicats et du parti travailliste. Cependant, étant une forme de lutte de classes, liée à la contradictions villes-campagnes, il fallait inéluctablement qu'il y ait un conflit avec ce consensus et cet encadrement.
Sans cela, il y aurait un mur. Ce mur, Ronnie Lee ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir, espérant que la question animale reste parallèle à la société. Ce fut le rôle historique de Barry Horne de tenter de faire sauter le verrou...
Lorsque Arkangel apparut, Ronnie Lee comptait donc établir une ligne multi-directionnelle, dont l'ALF serait une composante. Ce positionnement ne fut pas accepté par le noyau dur des activistes les plus impliqués dans le mouvement.
Dans un article pour Arkangel, Libération animale, mais pas trop ?, Ronnie Lee expose son point de vue, visant à amener une radicalisation de l'ensemble du mouvement pour les animaux, par l'intermédiaire de la charge morale posée par l'ALF. Sa ligne se fonde sur le principe d'un repli de l'humanité, une ligne très marquée par les théories élaborées alors aux Etats-Unis dans la mouvance d'Earth First!, avec une utopie décentralisatrice.
Ronnie Lee ne dérogera plus à cette ligne, prônant une sorte d'évolutionnisme allant dans le sens d'un vaste recul à une forme relativement primitive de société...
Toute la seconde moitié des années 1980 est marqué par l'alternance de sabotages de base (serrures remplies de colles, dégradations aux bombes de peinture, bris de vitrines, etc.) et actions plus marquantes sur le plan technique (incendies, actions de l'ARM, etc.).
L'ALF britannique vivait par et pour l'offensive, les succès grisant son positionnement et ne permettant pas un recul théorique, rendu impossible de toutes façons par l'absence de concepts idéologiques et culturels suffisamment développés. C'était là la grandeur morale de l'ALF britannique que d'en arriver jusque-là, mais également une faiblesse terrible.
En 1983, l'ALF mena notamment une quarantaine d'actions et provoqua des centaines de milliers d'euros aux laboratoires Mimms dans le Hertfordshire, plus d'un million d'euros de dégâts au Park Davis Laboratorium de Cambridge. Elle libéra 15 chiens de l'université de Cambridge, dont on s'aperçut qu'ils avaient été issus de vols dans les rues. 5 600 animaux furent libérés cette année-là.
L'ALF britannique commença également à véritablement essaimer sur le plan international, avec notamment cinq raids menés par les défenseurs autonomes des animaux en Allemagne, ou encore les 1,4 million d'euros causé dans une attaque contre un laboratoire à Utrecht aux Pays-Bas. Une militante alla également aux Etats-Unis pour former des activistes et la première action fut la libération de 24 chats à la Howard University de Washington, dont certains étaient déjà estropiés...
Les années 1980 sont celles d'une montée en puissance générale de l'ALF britannique. Il n'y eut pas tant des actions qui firent boule de neige qu'une crise très profonde dans la société britannique, l'ALF cristallisant la dimension révolutionnaire de par sa charge morale.
L'exigence morale individuelle était le coeur de l'initiative portée par l'ALF. La libération d'animaux se présentait ainsi comme la plus haute forme d'antagonisme, car exprimant la plus haute forme de moralité possible.
Un porte-parole de l'ALF expliqua, au tout début des années 1980 que :
« Personne n'irait loin dans l'ALF à moins d'être végétarien ou végan. Les membres de l'ALF agissent comme la conscience de la nation – nos objectifs de base sont de sauver des animaux et de causer autant d'embarras que possible, notamment financiers, aux gens impliqués dans l'exploitation animale, jusqu'à ce que la loi prenne le relais. »...
 L'ALF se posait initialement comme affirmation morale. Lors d'une intervention clandestine dans un laboratoire, une importante somme d'argent fut trouvée, mais elle ne fut pas emportée. Les billets furent déchirés, afin de souligner la supériorité morale de l'action.
L'ALF se posait initialement comme affirmation morale. Lors d'une intervention clandestine dans un laboratoire, une importante somme d'argent fut trouvée, mais elle ne fut pas emportée. Les billets furent déchirés, afin de souligner la supériorité morale de l'action.
La bataille du chien marron marqua la fin d'un positionnement antagoniste en Angleterre. Il faudra attendre les années 1960 et 1970 pour voir apparaître une contestation réelle et générale de la vie quotidienne. L'aspect le plus connu culturellement consiste en le foisonnement des mouvements de jeunesse (notamment rockers, mods, skinheads et bien sûr punks), cependant l'aspect le plus authentiquement relié aux luttes de classe fut l'émergence de l'ALF, du Front de Libération Animale.
Les mouvements de jeunesse se plaçaient en marge ou en parallèle des luttes de classe, restant dans l'esprit étroit de la reconnaissance sociale de classe au sein de la société capitaliste. C'est pourquoi le mouvement skinhead, initialement liée à la classe ouvrière et au rocksteady, au reggae, bascula en mouvement identitaire raciste de type plébéien...
C'est en Grande-Bretagne que se fondit la première association moderne de protection des animaux, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) en juin 1824. La SPCA s'engage sur le terrain des conditions des animaux dans les fermes et la production, mais mena également campagne contre la vivisection, ainsi que les sports impliquant la violence jusqu'au sang et la peine de mort.
L'Animal Liberation Front est un mouvement de masse qui a émergé en Angleterre dans les années 1970. Il s'agit du produit de la lutte des classes, dans les conditions propres à ce pays alors.
L'antagonisme y était particulièrement asséché : le mouvement ouvrier avait basculé dans le réformisme ouvert des syndicats, les trade-unions, ainsi que du parti travailliste, le Labour Party ; à aucun moment les communistes n'ont su développer une ligne de masses, en raison de leur incompréhension fondamentale tant de la réalité de leur pays que du matérialisme dialectique...
Zénon d'Élée est un philosophe grec ayant vécu de 490 à 430 avant Jésus-Christ, qui est fameux pour la formulation de différents « paradoxes » au sujet de l'espace et du temps.
Ces paradoxes, très connus notamment dans les mathématiques, ont été prétextes à des remarques très régulières, le plus souvent erronées car perdant de vue ou ne connaissant pas l'arrière-plan de la démarche de Zénon.
Le collectif ne se pose pas comme organisme dirigeant, mais comme noyau agent
Notre problème n'est pas de concurrencer les syndicats, partis, partis, groupes, pour « diriger les masses », mais d'exercer une action dialectique qui contribue à la croissance politique des masses, au développement de l'autonomie, à la transformation de luttes sociales spécifiques et sectorielles en lutte sociale généralisée.
Nous nous positionnons donc comme un outil théorico-pratique au sein du mouvement général du prolétariat qui - bien que sous des formes embryonnaires et encore très limitées - tend à une transformation globale de la société...
Le mouvement des masses en Europe et en Italie a atteint un tournant décisif. Son développement spontané et impétueux a été arrêté par la manœuvre en tenaille de répression policière et de répression syndicale-partidaire. Ce qui s'est passé en France, en Allemagne et en Italie, à différents moments et de différentes manières, n'est pas un « cas défavorable », mais est le résultat de la logique même de la lutte des classes.
Il est nécessaire de comprendre clairement les termes du problème..
Les syndicats et les partis ont proclamé que c'est le moment des luttes sociales. Les poussées du mouvement de masse et la nécessité pour les organisations révisionnistes de passer à une étape supplémentaire de montée au pouvoir coïncident.
La plus grande erreur qu'il serait possible de faire ici est de penser que la Réforme a triomphé, que la guerre des paysans n'a été qu'un épisode sans importance. Bien au contraire, cette guerre a révélé l'insuffisante maturité de l'affirmation de la nation allemande par Martin Luther.
Dans les faits, le pays est resté religieusement divisé. Les protestants de type luthérien n'ont jamais formé qu'une courte majorité par rapport aux catholiques.
Voici ce que cela donne pour l'année 1555. Les zones catholiques sont en bleu, en bleu clair lorsqu'il s'agit d'une simple majorité. Les luthériens sont en rose, en rose clair lorsqu'il s'agit d'une simple majorité. En jaune clair, on trouve les partisans de Calvin et de Zwingli, c'est-à-dire la Réforme protestante, en jaune foncé les restes de la révolte hussite et taborite...
Marx écrit dans Les luttes de classe en France de 1848 à 1850 : « A l'exception de quelques chapitres, chaque section importante des annales de la révolution de 1848 à 1849 porte le titre de : « « Défaite de la révolution ! »
Mais dans ces défaites, ce ne fut pas la révolution qui succomba. Ce furent les traditionnels appendices pré-révolutionnaires, résultats des rapports sociaux qui ne s'étaient pas encore aiguisés jusqu'à devenir des contradictions de classes violentes : personnes, illusions, idées, projets dont le parti révolutionnaire n'était pas dégagé avant la révolution de Février et dont il ne pouvait être affranchi par la victoire de Février, mais seulement par une suite de défaites...
La fin des luttes contractuelles, la crise du mouvement étudiant, le déchaînement de la répression ont provoqué le relâchement, la confusion, la fuite en avant ou le retrait. C'est la conséquence du refus de regarder en face la réalité, d'échapper à la fois à la stérilité d'un activisme de plus en plus contradictoire avec les objectifs qu'on se propose, et à la sclérose idéologique qui persiste à chercher (dans le passé ou dans des situations très différentes des nôtres) des schémas d'action que nous devons dériver de la réalité qui se trouve sous notre nez.
La discussion qui s'est développée au sein du Collectif politique métropolitain, qui est résumée ici dans ses lignes essentielles, avait comme thème central le problème de l'organisation dans la métropole...
Le choix d'opposition aux paysans amenait une conséquence fondamentale dans la théologie de Martin Luther : elle fermait la possibilité d'aller vers le Saint-Esprit, de l'écouter et de l'exprimer.
C'était la ligne de Thomas Müntzer, qui y voyait un moyen pour le peuple, l'homme du commun, d'enfin s'exprimer et d'aller vers la démocratie.
Il y a donc un déplacement historique de la position de Martin Luther, d'une opposition à l’Église catholique au nom d'une libre expression en se fondant sur l'Evangile, à un piétisme intériorisé reconnaissant une vie intérieure, mais pas d'expression extérieure...
Martin Luther avait été heureux du compromis de la « Ligue souabe » représentant la haute noblesse avec les armées paysannes dites du Lac et de l’Allgäu. Mais c'était une exception et il se voyait dans l'obligation de prendre parti pour l'un des deux camps.
Son option principalement nationale lui fit prendre le parti des Princes électeurs, alors qu'il aurait préféré rester à l'écart, considérant que son positionnement religieux allait révolutionner de l'intérieur une Allemagne nouvelle...
Le problème historique du positionnement de Martin Luther, c'est que la paysannerie était déjà en mouvement et qu'avec une figure comme Thomas Müntzer capable de synthétiser ses exigences historiques, même à travers la théologie, le mouvement prenait une tournure insurrectionnelle.
L'une des prémisses les plus connues fut, dans le Wurtemberg en 1514, le soulèvement de l'Arme Konrad, le « pauvre Konrad », organisation clandestine de défense des simples gens, avait déjà été écrasé par le sang, 1700 paysans se faisant torturer et assassiner, Reinhard Gaisser émergenant comme figure révolutionnaire au cours de ce processus.
On avait affaire là à une tendance historique, une révolte anti-féodale qui ne pouvait pas temporiser avec les calculs de Martin Luther d'une réforme traversant les institutions...
La majorité de la population, toutefois, reste à l'écart des villes. En quoi consiste, à l'époque, la paysannerie ? Voici ce que nous en dit Friedrich Engels :
« Au-dessous de toutes ces classes, à l'exception de la dernière, se trouvait la grande masse exploitée de la nation : les paysans.
C'est sur eux que pesait toute la structure des couches sociales: princes, fonctionnaires, nobles, curés, patriciens et bourgeois. »...
Où Thomas Müntzer trouvait-il une telle force pour oser affirmer un tel universalisme ? Cela tient aux contradictions sociales dans les pays allemands d'alors.
Martin Luther l'avait bien compris ; il avait écrit une Lettre aux princes de Saxe sur l'esprit de rébellions ; à ses yeux, il fallait totalement isoler Thomas Müntzer, qui risquait pour lui de ruiner la Réforme en scindant les forces qui y sont favorables.
A l'opposé, Thomas Müntzer représentait justement des forces voyant comme inacceptables leur situation, où leur propre contestation se voyait happée par les Princes électeurs...
Après avoir dû fuir Allstedt, Thomas Müntzer finit par s'installer à Mühlhausen en Oberfranken. Cette ville avait 7 000 habitants et qui plus est 19 villages y étant rattachés ; son importance était alors plus grande que Dresde ou Leipzig.
A Mülhausen, l'ancien moine Henri Pfeiffer avait organisé un soulèvement populaire...
On peut se demander pourquoi Thomas Müntzer osa faire un sermon aux princes électeurs. La raison est toute simple : c'est un universaliste, qui prend la religion comme le vecteur moral de tout un chacun.
Etant véritablement démocrate, il ne cesse de vouloir s'appuyer sur « l'homme commun », mais cela signifiait également prêcher pour que les puissants eux-mêmes capitulent...
En 1961, Maurice Thorez publiait un ouvrage intitulé « La paupérisation des travailleurs français », la couverture se voyant barré d'une inscription où on lisait : « une tragique réalité ». Cet ouvrage est à la fois le produit du révisionnisme d'après 1945 et la base théorique pour toute la réflexion révisionniste dans la seconde partie du 20e siècle.
20. Briser l'anneau-Italie de la chaîne impérialiste !
Assumer la position du non-alignement !
Pratiquer la collaboration de tous les peuples sur une base paritaire !
Développer l'internationalisme prolétarien !
19. Frapper au centre !
Encercler les encercleurs !
Il faut affronter le processus de militarisation de l'usine, du territoire et de toute la vie sociale, les reliant aux restructurations anti-prolétariennes de l'économie et de l’État, également afin de démonter l'image perverse diffusée par la propagande du régime qui attribue au « terrorisme » la fonction de cause.
17. Désarticuler et détruire les appareils du contrôle social total !
Dans la phase de transition, désarticuler et saboter le processus d'intégration dans un système cohérent, totalitaire et totalisant de contrôle entre la direction technico-politique de l'Exécutif et le système afférent différencié des réseaux spéciaux, exige une ligne de mouvement articulé sur quatre points essentiels.
On ne serait sous-estimer la quête existentielle de Martin Luther, mésestimer l'enjeu humain que sa démarche représente. Il ne s'agit pas de quelqu'un réfutant simplement une quête d'argent de la part d'une Eglise bureaucratisée et peuplée d'opportunistes ; il s'agit de vivre en tant qu'humain et pour cela d'acquérir un fondement solide à sa propre existence.
Envoyé à Rome à la fin de 1510, Martin Luther n'y resta que moins d'un mois ; de manière significative, cela ne déclencha pas de révolte contre l’Église romaine et sa corruption, comme on aurait pu s'y attendre en suivant une interprétation erronée...
Martin Luther est né le 10 novembre 1483 en Saxe, à Eisleben, dans une famille de paysans, qu'il décrivit de manière suivante :
« Je suis un fils de paysan ; mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père étaient d'authentiques paysans. »
En fait, le père tenta de s'élever socialement en devenant mineur, à Mansfeld, avant de devenir bourgeois, ce qu'était déjà sa mère par sa famille. Le père devint même magistrat de Mansfeld...
La stratégie anti-prolétarienne condensée dans le « Plan Triennal » est élaboré et dirigé en des espaces bien précis et se transmet à travers une chaîne articulée qui pénètre l'usine et investit chaque aspect de la vie des prolétaires.
Ces espaces, véritables réseaux nerveux du pouvoir exécutif, doivent devenir des objectifs privilégiés de l'initiative révolutionnaire.
En attaquant leurs dirigeants, en balayant la mini-patrouille des « cerveaux » qui mettent au point la ligne anti-ouvrière, décourageant avec dureté les collaborateurs qui se camouflent dans les universités de la péninsule, il est possible d'amplifier au maximum les contradictions internes du front bourgeois et de mettre en échec un des instruments les plus délicats de la domination impérialiste...
Eyn deutsch Theologia assume donc une forme très poussée de panthéisme ; tout être humain porte une dignité fondamentale. On lit, dans une approche qui est précisément celle de « maître » Eckhart :
« Quand on dit que quelque chose est ou se produit contre Dieu, l’afflige et le peine, on doit savoir qu’aucune créature, en tant qu’elle est, vit, a savoir, force, capacité et autres choses semblables, ne l’afflige ou le peine ; rien de tout cela n’est contre Dieu.
Que l’esprit malin ou l’homme soit, vive et autres choses semblables, tout cela est bien et est de Dieu, car tout cela est Dieu par son essence et son origine...
La répression du Vatican mit de côté la perspective développée par « maître » Eckhart sur un plan général, mais il existait dans les pays allemands des gens considérant que cette perspective était la bonne.
La voie mystique ouverte par Eckhart fut en mesure de temporairement se maintenir en Allemagne, correspondant tant aux mentalités des pays allemands qu’aux intérêts de nombreuses forces sociales.
Une perspective plus intimiste accompagnait inévitablement le développement des villes, alors que l’Église était en même temps romaine et présentait une nature toujours étrangère avec l'émergence du sentiment national...
Le 7 novembre 2017, nous célébrons les cent ans de la révolution d'Octobre qui, en 1917, a conduit la Russie au socialisme, à travers une insurrection armée suivie d'une guerre civile entre les armées rouge et blanche. Nous disons que ce chemin est encore valide aujourd'hui ; dans chaque pays capitaliste, un soulèvement révolutionnaire doit être dirigé par le parti révolutionnaire d'avant-garde, mobilisant les masses afin qu'elles prennent le pouvoir en détruisant l'ancien État d'une manière nécessairement violente.
L'insurrection, c'est-à-dire la prise du pouvoir central, est la tâche révolutionnaire des vrais communistes ; le but n'est pas de réformer ou d'améliorer le capitalisme, mais de le renverser. L’ancien État ne peut pas être modifié, il doit être détruit et remplacé par le pouvoir des soviets, l’État socialiste...
Le monde a radicalement changé dans sa forme depuis la révolution d'Octobre 1917, mais il n'a pas changé de nature. Il est vrai que depuis cent ans, les forces productives se sont considérablement agrandies, faisant que la rupture révolutionnaire exige une dimension subjective prononcée.
Le capitalisme développé corrompt, déforme, fragmente les esprits, abîme les sensibilités, anéantit l'esprit du changement réel, authentique, comme toute affirmation morale.
Il a les moyens d'engloutir les gens dans des errements sans fin, des fétichismes aberrants, des illusions cyniques. Du culte de la petite propriété à la télé-réalité, de l'art contemporain aux modes vestimentaires, le capitalisme sait comment occuper les mentalités, fausser les rêves, assassiner la profondeur des sentiments, la densité de la sensibilité...
Cette nouvelle phase de l'organisation sociale capitaliste tend à réaliser une vieille utopie de la bourgeoisie : la possibilité de planifier le comportement des prolétaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine, au moment de la production comme dans celui de la consommation et dans toutes les expressions de la vie sociale et des rapports humains.
Dans la phase actuelle de développement, la vieille combinaison de réforme et de répression, composée à l'intérieur de la démocratie formelle bourgeoise, ne suffit plus.
La centralisation du pouvoir nécessaire à la gestion du capitalisme avancé réduit toujours davantage les espaces de pouvoir réel à « concéder » aux cadres dirigeants subordonnés, le dynamisme vertical élimine les couches intermédiaires et le choc de classe tend à se produire sur un mode net et radical entre une bourgeoisie qui a épuisé toute possibilité d'expression sociale globale (c'est-à-dire ne plus plus se présenter comme « porteuse » des idéaux démocratiques, nationaux, de valeurs éthiques ou culturelles) et un prolétariat urbain qui s'étend à la majorité de la population active...
Les maoïstes apparus dans les années 1960 en Europe occidentale et aux États-Unis ont une ligne unanime : les syndicats sont devenus une composante institutionnelle de la neutralisation de la lutte des classes.
Les syndicats ont comme tâche d'être des points d'ancrages du capitalisme au sein du prolétariat ; c'est un outil de corruption et d'amélioration de l'organisation de la production.
Les syndicats accompagnent la déformation, l'abrutissement, l'aliénation des masses dans le cadre d'un capitalisme qui parvient à se développer (avant une future crise générale)...
L’Église catholique réfute de manière ferme « Maître » Eckhart, par la Bulle In agro dominico du pape Jean XXII, daté du 27 mars 1329 qui expliqua en quoi ses thèses étaient erronées ou hérétiques.
Eckhart, quant à lui, mourut avant la publication de la Bulle. Ce que l’Église catholique lui reprochait, c'est de nier tellement la matière que sa spiritualité atteignait un même degré d'universalisme que le matérialisme.
Pour comprendre la démarche de Martin Luther (ainsi que de Thomas Müntzer, autre figure historique de la vague protestante allemande), il faut avoir conscience qu’il existait alors tout un arrière-plan idéologique et culturel propre aux pays allemands.
Tout un courant mystique s’était développé, dont la figure la plus connue est « Maître » Eckhart (1260-1328) ; il est historiquement parlé du « mysticisme rhénan » et Strasbourg en fut l’un de ses centres.
Devenu maître en théologie à l’Université de Paris, alors la plus prestigieuse, Eckhardt développa des thèses extrêmement approfondies, qui lui valurent maille à partir avec l’Inquisition et furent repoussées en partie, tout en ayant malgré tout un impact profond en Allemagne et aux Pays-Bas...
Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, Martin Luther placardait sur la porte de l'église de Wittenberg une affiche comportant 95 thèses. Contrairement à une opinion largement répandue, Martin Luther ne se contentait pas d'y dénoncer les « indulgences », c'est-à-dire les « pardons » des péchés accordés alors par milliers par l’Église catholique romaine contre rémunération.
Ce qu'il visait avec ses « quatre-vingt-quinze thèses théologiques sur la puissance des indulgences », c'est le fait même que l’Église catholique romaine existe, avec le Pape à sa tête, en tant que force centralisée décidant de ce qui est légal ou non sur le plan religieux et intervenant dans la société pour décider de ce qui est juste ou pas...
Il est frappant de voir que l’histoire de la bataille anti-révisionniste aux États-Unis est strictement parallèle à celle en Allemagne. Comme dans ce dernier pays, on a une organisation étudiante socialiste qui regroupe la contestation, avec par ailleurs le même acronyme : SDS, pour « Students for a Democratic Society », Etudiants pour une société démocratique. Le SDS sert alors de détonateur.
L’origine du SDS est la Intercollegiate Socialist Society, né à l’initiative d’Upton Sinclair en 1905, comme branche étudiante non officielle du Parti Socialiste d’Amérique.
Cette première structure devint en 1921 la League for Industrial Democracy, la Ligue pour la Démocratie Industrielle, avant de se radicaliser et de s’unifier avec les étudiants communistes dans un front dénommé American Student Union, le Syndicat étudiant américain...
L'occupation de Libération par la mouvance autonome, conseilliste, rupturiste, spontanéiste ne produisit donc rien, à part l'éloignement définitif du quotidien qui, de toutes façons, était née de la capitulation de la Gauche Prolétarienne et ne pratiquait qu'une constestation libérale-libertaire.

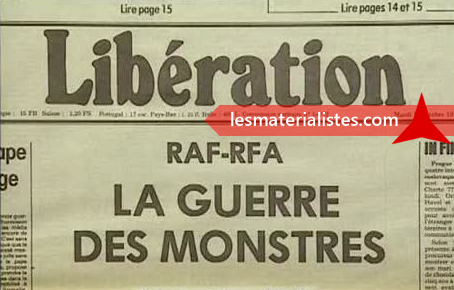 Le choix était simple : il correspondait à une dénonciation par les gens se voulant alternatifs et non communistes, sans être institutionnels (des gens pareils culturellement mais acceptant une neutralité et un certain rapport avec les institutions).
Le choix était simple : il correspondait à une dénonciation par les gens se voulant alternatifs et non communistes, sans être institutionnels (des gens pareils culturellement mais acceptant une neutralité et un certain rapport avec les institutions).
L'existence de la Fraction Armée Rouge a posé un énorme problème à l'extrême-gauche française. Elle rappelait en effet les thèses qu'elle-même avait formulé ou dont elle était proche au tout début des années 1970, avant finalement de s'insérer dans les institutions.
Les rares secteurs refusant une telle insertion avaient également plongé dans l'anarchisme ou plus exactement le spontanéisme et l'ultra-gauche conseilliste ; pour cette raison, l'idéologie communiste maintenue de la RAF leur semblait quelque chose d'étonnant, de perturbant, voire de franchement dérangeant...
Le positivisme ne devait pas être un outil que pour la bourgeoisie : il devait servir également à mobiliser le prolétariat derrière la bourgeoisie. Il s'agissait impérativement d'encadrer intellectuellement et moralement le prolétariat naissant. Voici un exemple de comment Auguste Comte explique l'importance de parer à la menace communiste, dans son Discours sur l'ensemble du positivisme :
« Pour rendre justice au communisme, on doit surtout y apprécier les nobles sentiments qui le caractérisent, et non les vaines théories qui leur servent d'organes provisoires, dans un milieu où ils ne peuvent encore se formuler autrement. En s'attachant à une telle utopie, nos prolétaires, très peu métaphysiques, sont loin d'accorder à ces doctrines autant d'importance que les lettrés.
Aussitôt qu'ils connaîtront une meilleure expression de leurs vœux légitimes, ils n'hésiteront pas à préférer des notions claires et réelles, susceptibles d'une efficacité paisible et durable, à de vagues et confuses chimères, dont leur instinct sentira bientôt la tendance anarchique. »...
Il est très intéressant de voir comment Auguste Comte voit l'individu. En effet, il accepte tout à fait la séparation du corps et de l'esprit. Reprenant sans le dire l'exemple de « l'homme volant » d'Avicenne, repris pareillement sans le dire par Descartes, Auguste Comte fait une hypothèse fantasmagorique.
Il imagine un être humain sans besoins physiques aucun. À quoi ressemblerait alors cet être humain en quelque sorte pur, c'est-à-dire ici totalement spiritualisé?
La vision d'Auguste Comte, combinant individualisme et socialisation, correspond exactement à l'idéologie nationale-républicaine de la IIIe République, qui s'installera en 1870. A l'époque d'Auguste Comte, la bourgeoisie n'avait pas encore les moyens d'imposer sa vision de la morale et des mœurs ; cela sera le cas après 1870.
Auguste Comte a toujours souligné, comme ici dans le Discours sur l’esprit positif, que le positivisme est une morale, une manière d'appréhender la réalité. C'est une vision du monde, satisfaisant à des exigences.
Auguste Comte souligne bien que l'ancien système ne marche plus, qu'il en faut donc un nouveau…
Le positivisme a comme avantage de combiner le relativisme et le culte de l'expérience. C'est, si l'on veut, la différence entre Honoré de Balzac et Émile Zola. Le réalisme de Honoré de Balzac se veut exhaustif et avec une vision du monde tout à fait déterminée ; Honoré de Balzac émet des avis réguliers, il soupèse les aspects, leur accorde une valeur de manière complète.
Le positivisme est donc l'idéologie de la bourgeoisie qui a littéralement balancé par-dessus bord toute science « fermée », complète, totale. C'est une relecture complète de l'idéologie bourgeoise, une sorte de synthèse expurgée de l'idéologie bourgeoise.
C'était une entreprise de démolition apparaissant comme une construction et présentée telle quelle, ce qui fait réagir Karl Marx de la manière suivante, dans une lettre à Friedrich Engels en juillet 1866 : « Dans mes loisirs j'étudie Comte, parce que les Anglais et les Français font du tapage autour de ce type. Ce qui les marque en cela, c'est l'encyclopédique, la synthèse. Mais c'est pathétique par rapport à Hegel (bien que Comte en tant que mathématicien et physicien de profession soit supérieur à celui-ci, c'est-à-dire supérieur dans le détail, Hegel lui-même étant ici infiniment plus grand dans l'ensemble) »...
Auguste Comte exprime donc un besoin historique, celui d'annoncer une nouvelle mentalité. Il lève le drapeau de la fin de la superstition, ce qui équivaut pour lui à annoncer le triomphe de l'ère industrielle, de la conception terre à terre de l'industriel.
Comme il le dit dans son Discours sur l'esprit positif, les superstitions sont condamnées à graduellement disparaître, cédant la place à l'approche nouvelle : « A mesure que les lois physiques ont été connues, l’empire des volontés surnaturelles s’est trouvé de plus en plus restreint, étant toujours consacré surtout aux phénomènes dont les lois restaient ignorées. »...
Né à Montpellier le 19 janvier 1798, Auguste Comte fut admis à Polytechnique à quinze ans, qu'il ne put rejoindre qu'une année plus tard seulement en raison de son jeune âge. Les élèves s'y révoltèrent contre un professeur et furent expulsés ; Auguste Comte vécut alors de cours de mathématiques à Paris, avant de devenir un proche du réformateur social Saint-Simon de 1817 à 1825.
La révolution française, après avoir initialement triomphé, s'enlisa et connut la forme impériale sous la direction de Napoléon Bonaparte, à quoi se succéda la Restauration.
Face à l'aristocratie revenue, il fallait pour la bourgeoisie relancer sa bataille idéologique et culturelle. Mais tout comme l'aristocratie revenue au pouvoir avait modifié sa nature, la bourgeoisie n'était déjà plus la même.
Elle avait connu de grands progrès, elle avait saisi sa force et, surtout, elle découvrait qu'elle avait donné naissance à une force hostile elle-même grandissante : le prolétariat. Les années 1815-1848 furent ainsi marquées par l'apparition des socialistes utopiques...
C'est le réalité qui détermine la conscience et celle-ci doit saisir le principe de la synthèse pour parvenir à comprendre le mouvement de la matière dans l'espace-temps.
Nous soulignons à ce titre, parce que les communistes ont une vision plus approfondie aujourd'hui qu'auparavant, la signification qu'il y a à reconnaître la dignité de la matière vivante.
Ernesto « Che » Guevara est mort le 9 octobre 1967, exécuté quelques jours après avoir été capturé par l'Armée bolivienne. C'était là l'aboutissement de tout un parcours et de toute une série de choix idéologiques. Ernesto « Che » Guevara est, en effet, argentin ; ayant rejoint Cuba pour y participer avec Fidel Castro à la guérilla, il a par la suite fait de cette « révolution » – en fait un changement de régime seulement – un modèle idéologique.
Il s'agit d'une ligne subjective visant à lancer de l'extérieur un processus révolutionnaire, sans Parti mais avec simplement avec un noyau d'avant-garde ; c'est le principe du « foyer révolutionnaire », le « foco »...
En Allemagne de l'Ouest, l'interdiction du Parti Communiste d'Allemagne, la relance économique sous supervision américaine, l'influence néfaste de l'Allemagne de l'Est ayant basculé dans le révisionnisme et l'apparition d'un Parti Communiste allemand (DKP) pro-soviétique avaient provoqué un effondrement d'un mouvement communiste qui, de toutes manières, avait été pratiquement anéanti par le régime national-socialiste.
Aucune relance ne fut possible avant le développement du SDS – Sozialistischer Deutscher Studentenbund (Union socialiste des étudiants allemands) – qui à la suite de son rapide effondrement laissa la place à une immense vague anti-révisionniste. Le SDS était né en 1946 en étant proche des socialistes, mais il s'en éloigna rapidement, devenant le fer de lance d'une opposition de type gauchiste dans les années 1960...
Pseudo-Denys l'Aréopagite, en niant la dialectique au profit de l'unité suprême tout en reconnaissant la réalité matérielle, n'est pas loin du panthéisme. Cependant, en niant le mouvement, il ne peut pas y aboutir, basculant de ce fait dans une religiosité où c'est Dieu qui met en mouvement.
Ce mouvement est insuffisant, car la vie matérielle est nécessairement « pleine de mutabilité et d'angoisses » ; la hiérarchie permet de donner du sens et de faire en sorte « de nous unir à Dieu autant qu'il est possible »...
Lorsque Jean-Luc Mélenchon a pris l'avion pour aller à La Réunion la semaine dernière, il était en classe affaires. Quant à Mathilde Panot et Danièle Obono, élues au Parlement pour la France Insoumise comme lui, elles étaient dans le même avion, mais en classe économique.
La question de l'âge ne compte pas ici : d'abord parce que par camaraderie quand on est dans le même avion on cherche à être ensemble. Ensuite, parce que Jean-Luc Mélenchon est coutumier du fait puisqu'il déclarait en 2013 ne voyager qu'en classe affaire, lui qui a d'ailleurs un patrimoine d'un million d'euros en ayant quasiment toute sa vie uniquement fait de la politique...
La dimension panthéiste du christianisme représente l'expression de sa base dynamique, correspondant à la modification profonde de la réalité et au besoin de cette modification. Karl Marx a explicité de manière tout à fait claire le double aspect de la religion, qui est à la fois consolation et protestation, en plus d'être, en tant qu'idéologie, un reflet.
Cependant, la dimension dynamique est nécessairement atténuée, freinée, paralysée par la conception du monde qui attribue aux cieux une valeur supérieure à la réalité terrestre...
Le grand souci de l'approche de Pseudo-Denys l'Aréopagite, par rapport à la nature même de la religion, est que le principe d'incarnation utilisée afin de christianiser le néo-platonisme aboutit, de manière inévitable à une divinisation de l'être humain.
D'un côté, cette divinisation est reportée à la fin des temps, à la résurrection...
Pour mieux saisir la démarche de Pseudo-Denys l’Aréopagite, si capitale pour le christianisme, revenons sur les points essentiels. Le premier est que selon lui, il faut une hiérarchie spirituelle sur Terre imitant ce qu'il y a dans les cieux.
De la même manière que depuis Dieu, l'illumination tombe en cascade sur les anges selon leur hiérarchie, l’Église fait ruisseler sur Terre le message divin...
Le problème de l'approche de Pseudo-Denys l’Aréopagite est qu'il est obligé de pratiquer la fuite en avant, afin de maintenir l'équilibre entre un Dieu inaccessible et indéfinissable (comme chez Plotin) et une religiosité mystique (comme chez Proclus). Il est obligé, par conséquent, de renforcer le principe de l'incarnation.
Ainsi, la combinaison de l'esprit initiatique et de la théologie négative aboutit à une démarche insistant grandement sur la symbolique. Il s'agit en effet d'imiter les formes divines...
Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittemberg, sous la présidence du Révérend Père Martin LUTHER, ermite augustin, maître es Arts, docteur et lecteur de la Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui, de vouloir bien le faire par lettres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
- En disant : Faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence.
Le souci de la dimension initiatique est qu'il est nécessaire de la justifier, surtout que le message de Jésus est universel. Comment combiner un message universel avec une démarche hiérarchisée et sélective, non universaliste ?
Pseudo-Denys l’Aréopagite se voit obliger de justifier le clergé en se fondant sur le principe de Proclus : l'illumination ne touche pas tout le monde pareillement, il faut une purification qui est un cheminement avec plusieurs étapes, selon les « forces » spirituelles qu'on est capable de mettre en branle...
Pseudo-Denys l’Aréopagite est donc quelqu'un qui puise dans le néo-platonisme, mais il résout le conflit entre la conception d'un Un divin isolé (comme chez Plotin) et celle d'un monde d'en bas rempli d'entités magiques issus du Un divin (comme chez Proclus).
Il résout cette opposition entre en haut et en bas au moyen de l'incarnation, Jésus étant à la fois Dieu et homme, dans une même unité. Jésus permet donc un « appel d'air », faisant entrevoir comment accéder au divin depuis le monde matériel...
Si le christianisme apporte l'individualité, il est frappant que le protestantisme ne se développe que seize siècles après Jésus. Auparavant, on a le christianisme hiérarchisé, avec un clergé s'opposant aux laïcs.
Il y a deux raisons à cela. La première, matérielle, est que le système esclavagiste ne s'est effondré que par à-coups, que l'individu n'émergera au sens strict que par le capitalisme. Le statut de serf, intermédiaire entre l'esclave et l'individu autonome, va exister pour toute une période historique, celle de la féodalité...
Le Corpus Dionysiacum représente un ensemble de très haut niveau, formant le cœur même de ce que va être le christianisme. Lorsque Martin Luther remettra en cause l’Église catholique romaine au XVIe siècle, il se verra ainsi dans l'obligation de rejeter Pseudo-Denys l'Aréopagite.
Mais pourquoi avoir repris le nom de Denys l'Aréopagite, mentionné par Paul ? En fait, ce choix est d'une importance capitale...
L'histoire des écrits du Pseudo-Denys l'Aréopagite et de qui il est réellement est particulièrement tourmentée. D'ailleurs, l'Église orthodoxe réfute encore l'idée que Denys l'Aréopagite et Pseudo-Denys l'Aréopagite seraient deux personnes différentes ; en France, on a même temporairement également assimilé Denys l'Aréopagite, le Pseudo-Denys l'Aréopagite et Saint-Denis.
Cet aspect problématique est d'autant plus frappant que, dans ses écrits, Pseudo-Denys l'Aréopagite souligne grandement la nécessité de maintenir secret les enseignements les plus importants, voire même le cœur de la doctrine chrétienne...
Augustin, Pseudo-Denys l'Aréopagite et Boèce sont trois penseurs ayant joué un rôle historique capital, dans la mesure où ils ont été ceux qui, aux IVe - Ve - VIe siècles, ont réussi à faire du christianisme une idéologie cohérente et systématique.
Ils ont ici répondu à un besoin historique très particulier, permettant au christianisme de ne pas en rester au niveau d’une conception religieuse parmi d’autres, avec des sectes vivant à l’écart du monde de manière unilatérale...
Nous allons bientôt célébrer les cent ans de la révolution russe, la fameuse insurrection d'Octobre 1917 menée par les bolcheviks, ouvrant la voie à une guerre civile de plusieurs années entre l'Armée rouge et l'Armée blanche.
La révolution russe sera un thème qui sera abordé par de nombreux médias et également par les regroupements révolutionnaires en France, par la gauche en général. Elle sera présentée comme une tentative utopique ayant échoué, d'une manière ou d'une autre...
Augustin, avec son approche conceptuelle du césaro-papisme et du péché comme base de l'expérience réelle de l'Humanité depuis Adam, avec sa conception idéaliste du rapport entre l'Un et le Multiple, détermina pour plusieurs siècles le christianisme. Sa fusion du manichéisme et du néo-platonisme, de l'incarnation et de l'Évangile, l'a véritablement porté par ailleurs, étant à la croisée de toute une production d'une très riche intensité.
C'est la base d'une production extrêmement prolixe historiquement, avec ses polémiques, ses conseils techniques, ses nombreux ouvrages idéologiques.
Il est significatif que le mysticisme d'Augustin puise dans la clef véritable de l'idéalisme religieux, à savoir le culte des nombres. C'est la conséquence obligatoire de la conception idéaliste du rapport entre l'Un et le Multiple.
Puisque Dieu est 1, la réalité qui est multiple s'appuie sur ce 1. Les nombres, invisibles à la matière, aux corps, composeraient l'univers, aussi faut-il se tourner vers le concept de Dieu...
Le souci de l'exigence du combat du bien contre le mal, c'est que chez Augustin, ce qui compte c'est la dimension mystique ; l'idéalisme amène l'anéantissement de la matière au profit du Un divin. À ce niveau, l'œuvre véritablement massive d'Augustin en termes de quantité est parsemée de réflexions sur l'unité divine, en laquelle il faut se fondre.
C'est l'expression du néo-platonisme dans le catholicisme, au moyen d'une rencontre du manichéisme opposant le bien et le mal avec le principe de l'incarnation d'un Dieu absolu...
Pourquoi Augustin maintient-il la figure des démons ? La raison est évidente : dans une société humaine encore largement désorganisée, il faut bien expliquer que des choses mauvaises se produisent, et cela d'autant plus après l'incarnation divine du Christ.
Il s'agit d'un renouvellement du manichéisme, dans le cadre de la logique de l'incarnation, de la reconnaissance d'un Dieu uni-total...
Il n’en reste pas moins que, malgré sa prise de distance avec Platon qui est pourtant largement valorisé, il était nécessaire à Augustin de procéder à la liquidation du néo-platonisme. Il écrit pour ce faire de très nombreux chapitres dans La Cité de Dieu contre les païens, afin de dénoncer la démonologie du néo-platonisme (qu’il assimile par ailleurs au platonisme en tant que tel).
En effet, en l’absence d’incarnation divine d’un Dieu unique isolé, le néo-platonisme a dû concevoir toute une série d’étapes intermédiaires peuplés de dieux et de démons...
Il est évident qu’il était compliqué pour Augustin d’affirmer à ce point la valeur du platonisme, un courant païen, aussi a-t-il dû justifier « comment Platon a pu autant approcher de la doctrine chrétienne » qui est, faut-il le rappeler, une révélation.
Il précise par conséquent à ce sujet : « Parmi ceux qui nous sont unis dans la grâce de Jésus-Christ, quelques-uns s’étonnent d’entendre attribuer à Platon ces idées sur la Divinité, qu’ils trouvent singulièrement conformes à la véritable religion. »...
Là où Augustin tombe véritablement le masque de sa démarche de sa synthèse platonisme - manichéisme - christianisme, c'est avec son éloge de Platon, un païen pourtant. On a ici quelque chose de tout à fait similaire à ce que fit Pseudo-Denys l'Aréopagite, bien que celui-ci ait une approche différente, puisque purement néo-platonicienne à l'initial.
Dans La Cité de Dieu contre les païens, Augustin fait ainsi une présentation approfondie de la philosophie, y compris des pré-socratiques, c’est-à-dire les philosophes comme Pythagore et Thalès, qui devancent Socrate, Platon et Aristote...
On ne saurait sous-estimer l'acharnement complet d'Augustin pour disqualifier la réalité matérielle. Aux yeux de celui-ci, la réalité humaine n'est que péché, le monde n'est lui-même que le lieu du péché.
C'est le véritable fond de la démarche d'Augustin...
Le soutien à participation au régime impérial, le refus des courants populaires (comme le donatisme) et d'une religion rationaliste (comme le pélagianisme l'exigeait), tout cela imposait à Augustin de renforcer toujours plus une vision du monde où l'Humanité a un statut inférieur, relevant de quelque chose de mauvais.
C'était nécessaire, afin d'empêcher justement que prime une perspective rationaliste de la religion. Augustin se tourne de manière violente vers une intériorisation de la religion, dans une démarche résolument anti-rationaliste...
De multiples oppositions sont nées au cours de l'affirmation de cette sorte de césaro-papisme, d'intégration de la religion dans le système de domination impériale restructurée.
Augustin va appuyer de toutes ses forces l'écrasement dans la violence des chrétiens donatistes, expliquant même que face à « la barbare et violente hérésie des Donatistes, toute indulgence pourrait paraître plus cruelle que leur cruauté même ». Ce donatisme était, de fait, l'expression d'une grande radicalité...
Augustin, né en 354, émerge comme figure historique dans la continuité du tournant de Constantin. De fait, à la mort de Théodose, en 395, l'Empire se divisa avec ses fils en Empire romain d'occident et Empire romain d'orient, et cela définitivement contrairement aux apparences alors. Le processus d'effondrement continua, et en 410 les Goths pillèrent Rome.
Augustin, qui avait déjà fait la louange, le panégyrique, de Valentinien II dans les années 380, prit donc l'occasion de la chute de la ville de Rome pour rédiger, de 413 à 427, les 22 livres de La Cité de Dieu contre les païens. On y trouve une conception qui rejoint ce qui sera qualifiée bien plus tard de « césaro-papisme ».
Il faut saisir ici le contexte historique, pour comprendre la portée politique du fanatisme d'Augustin, qui formule en fait une nouvelle idéologie pour un nouveau régime, né des décombres de l'Empire romain.
Augustin est né en 354 et à cette époque, le régime impérial n'en finit pas de s'effondrer. Il est cependant déjà largement christianisé...
La grande actualité pour Augustin, c'est l'effondrement de Rome. Lui-même de culture romaine, pétri de rhétorique et de littérature latine, il a notamment voyagé à Carthage, puis Milan. Et il constate la fin de l'empire, qu'il analyse profondément dans La Cité de Dieu contre les païens, ainsi que dans De la ruine de Rome. Il oppose la puissance de Rome à celle du message du Christ ; l'effondrement de Rome est la preuve de la vanité de ce qui est terrestre...
Augustin est l'une des plus grandes figures du christianisme ; aux côtés d'Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, il est l'un des quatre Pères de l'Église catholique romaine ; avec Thomas d'Aquin, il forme le binôme suprême de l'idéologie catholique.
Né en 354 et mort en 430 en Algérie actuelle, vivant dans une société prolongeant directement les conquêtes romaines et lui-même étant d'origine berbère, latine et phénicienne, Augustin a suivi les modes intellectuelles propre à la culture romaine d'alors. Il s'est d'abord rapproché des philosophes (c'est-à-dire du platonisme), puis des manichéens, avant d'embrasser le christianisme, dont il est devenu par la suite l'idéologie...
14. La rapidité avec laquelle évolue le processus de crise – restructuration – internationalisation et la résistance offensive et tenace du prolétariat métropolitain oblige la bourgeoisie à lancer dans cette conjoncture une attaque à vaste échelle, à tous les niveaux de vie des masses.
Dans ce contexte, la lutte pour la défense des Intérêts Immédiats devient également toujours plus antagoniste avec les besoins de valorisation du capital et assume de fait toujours plus le caractère d’une confrontation de pouvoir...
L'effondrement du Parti Ouvrier Français était dans sa matrice même : sans base idéologique et culturelle, rien n'était possible. Karl Marx et Friedrich Engels espéraient que le Parti Ouvrier Français soit le début de quelque chose : ses acteurs le voyaient comme une fin en soi.
Or, de par la réalité historique, il fallait bien que le Parti Ouvrier Français aient une stratégie et une tactique. De par les réalités historiques françaises par ailleurs, il fallait se positionner par rapport à la question municipale...
Comment le Parti Ouvrier Français s'effondra-t-il par conséquent si rapidement ? C'est qu'il lui fallait bien, une fois avoir grandi, faire de la politique.
Sur le plan de la combativité, il fut aux premières loges, avec la grève des mineurs du Pas-de-Calais en 1889, la grève de Carmaux en 1892. Le Parti Ouvrier Français organisa même le soutien national à la grande grève des mineurs de Decazeville en 1886, Friedrich Engels se chargeant du soutien international...
Karl Marx et Friedrich Engels plaçaient donc leurs espoirs dans Jules Guesde, Paul Lafargue et le Parti Ouvrier Français. Ils suivaient avec attention le développement de ce qu'ils valorisaient.
Ils furent déçus et même affligés. Les qualités qui permettaient que quelque chose s'élance en France se transformaient immanquablement en leur contraire, en raison d'un pragmatisme dénué de sens politique, d'une ligne de rentre-dedans sans nuances ni contours.
La scission de 1882 avec les possibilistes avait été la première preuve de manque de sens politique. Friedrich Engels, dans une lettre à August Bebel, le 21 juin 1882, constatait ainsi : « À Paris, c'est la scission dans le parti ouvrier. Les gens de L'Égalité - nos meilleurs éléments, Guesde, Deville, Lafargue, etc. - ont été, sans autre forme de procès, mis dehors au dernier congrès. »...
Le Parti Ouvrier Français possédait une vraie dynamique historique. Aline Valette fut la première femme à parvenir à la direction d'une organisation socialiste, en l'occurrence le Parti Ouvrier Français. Elle fonda par la suite un journal qui ne dura pas, L'Harmonie sociale et fut l'organisatrice d'une Fédération nationale des sociétés féministes.
Jules Guesde lui-même prit position en faveur des femmes, alors que le mouvement ouvrier français de l'époque considérait que sa nature consistait à être ménagère. Dans La femme et son droit au travail, publié dans Le Socialiste du 9 octobre 1898, il se positionna clairement : « Assurer à la femme comme à l'homme le développement intégral et la libre application de ses facultés. Assurer d'autre part aux travailleurs sans distinction de sexe, le produit intégral de leur travail. Là est toute la solution – et elle n'est que là. »...
13. Attaque sélective et anéantissement.
Dans cette conjoncture de transition, toute stratégie spécifique de désarticulation implique nécessairement une Logique Sélective dans les attaques, une « main de chirurgien », et cela pour le simple fait que c'est la voie magistrale pour la maximisation des résultats politiques.
Il est facile de comprendre que tous les personnels ou espaces n'ont pas la même importance stratégique pour l’État impérialiste, que toutes les attaques pensables – possibles n'approfondissent et 'étendent pas de la même manière les contradictions internes à l'ennemi...
Le Parti Ouvrier Français connut une certaine montée en puissance sur le plan de l'organisation, grâce à d'un côté un engagement militant en faveur du collectivisme, de l'autre l'ouverture d'une perspective marxiste. Initialement appelé Fédération de parti des travailleurs socialistes en France lors de sa fondation au congrès de Marseille d'octobre 1879, il s'appuyait sur un découpage en six régions : Nord, Est, Centre, Ouest, Midi, Algérie.
En fait, malgré la prétention centraliste, les régions étaient autonomes et en fait cela était même le cas des groupes locaux. Ceux-ci étaient libres de se fédérer ou bien d'être simplement en contact avec la direction. Chaque année, suivant le principe instauré au congrès national de Lille en octobre 1890, le Conseil National était organisé par une différente région...
Le programme possède donc, indéniablement, une perspective marxiste. Ce qui caractérise la ligne de Jules Guesde, c'est la volonté d'aller de l'avant dans le collectivisme, ce qui équivaut à une réfutation directe de l'anarchisme. Dans le Programme agricole du Parti Ouvrier Français, on lit ainsi :
« Le Parti ouvrier, qui, à l'inverse des anarchistes, n'attend pas de la misère étendue et intensifiée la transformation de l'ordre social et ne voit de libération pour le travail et pour la société que dans l'organisation et les efforts combinas des travailleurs des campagnes et des villes s'emparant du gouvernement et faisant la loi, a adopté le programme agricole suivant, destiné à coaliser dans la même lutte contre l'ennemi commun, la féodalité terrienne, tous les éléments de la production agricole, toutes les activités qui, à des titres divers, mettent en valeur le sol national. »...
Jules Guesde et ses partisans furent donc les partisans acharnés du collectivisme, cherchant à le diffuser dans le prolétariat en présentant la révolution comme nécessité absolue. C'est cela qui permit la rencontre avec le marxisme.
Aux congrès socialistes nationaux qui commencèrent à s'organiser, la thèse collectiviste fut initialement refusée, à Paris en 1876 et à Lyon en 1878, avant finalement de triompher à Marseille en 1879. L'objectif socialiste consista alors en l'appropriation collective de tous les instruments de travail et de toutes les forces de production...
Puisque la bourgeoisie avait failli et que le collectivisme apparaissait comme nécessaire, alors il n'est, en quelque sorte, nul besoin de tactique ou de stratégie.
Jules Guesde va être celui qui va amener la naissance du Parti Ouvrier Français, historiquement la première organisation qui, en France, se revendique de Karl Marx et revendique « l'expropriation politique et économique de la classe capitaliste et la socialisation des moyens de production »...
Que signifie le collectivisme mis en avant par Jules Guesde, à la toute fin des années 1870 ? Voici comment il le définit, dans Collectivisme et Révolution, datant de 1879 :
« C’est la socialisation , ou encore, dans l’état actuel de l’Europe, la nationalisation du capital immobilier et mobilier, depuis le sol jusqu’à la machine, mis désormais directement à la disposition des groupes producteurs.
Plus de capitalistes, plus de patrons achetant et trouvant à acheter pour un morceau de pain la force de travail de millions d’hommes réduits au rôle de machines, produisant tout et manquant de tout : ou mieux, un seul patron, un seul capitaliste : Tout le monde ! mais tout le monde travaillant, obligé de travailler et maître de la totalité des valeurs sorties de ses mains...
La Commune de Paris fut, en 1871, le moment du grand tournant dans l'histoire de France ; elle marqua la naissance du mouvement ouvrier révolutionnaire en toute indépendance. Pour la première fois, la classe ouvrière s’était élancée de manière seule, sans se soumettre ou s’allier à la bourgeoisie dans une lutte anti-féodale.
Cependant, la classe ouvrière était embryonnaire, alliée à la plèbe ; l’échec de la Commune de Paris provoqua ainsi un cataclysme politique. 1871 fut une année d’une grande importance pour l’histoire du mouvement ouvrier à l’échelle mondiale ; le prix à payer en France fut toutefois un recul significatif, à tous les niveaux...
Dans la Résolution de la direction stratégique des Brigades Rouges de février 1978, il est déclaré que :
« Le principe tactique de la guérilla dans cette conjoncture est la désarticulation des forces de l'ennemi.
Désarticuler les forces de l'ennemi signifie porter une attaque dont l'objectif principal est encore celui de mener la propagande pour la lutte armée et sa nécessité, mais avec le principe tactique de la phase suivante commençant déjà – la destruction des forces de l'ennemi...
Proclus (412-185), connu en France sous le nom de Proclos, termine historiquement le cycle du néo-platonisme. Surnommé « le Diadoque » (c'est-à-dire en grec le successeur) dans le cadre de sa direction de l'école néo-platonicienne d'Athènes, il vient à l'origine d'une riche famille de Xanthe, en actuelle Turquie. Il définit sa tradition ainsi :
« Pythagore le premier avait appris d'Algaophamos les initiations relatives aux dieux, Platon a ensuite reçu des écrits pythagoriciens et orphiques la science toute parfaite qui les concerne. »
Il est le point culminant du néo-platonisme, aboutissant lui-même fort logiquement à une célébration de la magie, de rites mystiques...
Ce qui est frappant dans l'approche de Jamblique, c'est qu'il s'agit de sauver son âme. C'est tout à fait la même approche que celle du christianisme et en cela, c'est une rupture avec l'extase individuelle de Plotin qui, naturellement, se rapproche bien plus des expériences des premiers chrétiens, des ermites.
Ce qui est fascinant, c'est que se révèle ici l'importance capitale pour le christianisme de la trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car ce que dit Jamblique au sujet du Démiurge, c'est que celui-ci façonne la réalité, en reprenant les éléments donnés par le Père...
8.Les organismes révolutionnaires de masse, parce qu'ils sont la manifestation du pouvoir prolétarien, expriment une légalité en tant que tel, qui se place directement face à la « légalité démocratique ».
Dans un tel état de choses, la « défense de la légalité bourgeoise » vient à être définitivement exclu de la perspective du prolétariat métropolitain...
Contrairement à Plotin dont le néo-platonisme se cantonnait dans l'absolu, Jamblique reconnaît le particulier. Il ne s'adresse pas seulement aux plus sages qui ont déjà une connexion au divin, mais à tout un chacun.
Ce qui fait l'intérêt de la position de Jamblique, c'est alors bien entendu que chaque individu, ayant une âme, doit mener sa propre quête de Dieu.
Son âme a une nature définie, une valeur de très grande importance : elle est le « moyen terme » entre l'éternel et le non-éternel, le raisonnable et le non-raisonnable, ce qui est statique et ce qui est en mouvement, entre le non-généré et le généré, bref entre Dieu et la matière...
Si Plotin penche unilatéralement pour l'esprit se séparant du corps et d'un monde « inférieur », la formation divine de ce dernier fait que Jamblique considère qu'en découvrir les secrets permet de retrouver le divin.
Jamblique a une approche plus chrétienne, comme on peut le voir, car Plotin affirmait que l'âme individuelle conservait toujours un lien inébranlable avec l'Un, dont elle était issue ; au sens strict, l'âme ne s'alliait selon Plotin jamais vraiment au corps...
Jamblique est le premier à véritablement faire du néo-platonisme une magie philosophique. Plotin, lui, revendiquait une philosophie qui, parce qu'elle était idéaliste, avait une dimension magique.
Cependant, Plotin faisait pencher sa construction intellectuelle vers l'Un, coupant court à toute activité autre que la fusion extatique vers l'un. Son modèle est celui du yogi indien, pas du mage perse.
Jamblique inverse la tendance et cela d'autant plus qu'il doit faire face à la concurrence du christianisme. Cependant, il y a l'arrière-plan toute une polémique sur la nature du monde matériel...
Tous les néo-platoniciens, après Plotin, basculèrent dans un mysticisme païen outrancier, auquel Plotin était lié mais en tentant d'en synthétiser une forme nouvelle. Rien de cela à sa suite, où le culte des dieux et la magie seront des vecteurs essentiels de la sagesse mystique.
Qu'est-ce qui distingue alors le néo-platonisme du christianisme ? Eh bien, l'origine grecque, et sans doute l'origine hindoue, c'est-à-dire dans les deux cas, une conception socio-cosmique du monde, où l'ordre social est le produit de la réalité divine et où la réincarnation est la clef de voûte de l'équilibre.
Le néo-platonisme est la conception la plus développée du paganisme antique ; il n'est plus païen au sens strict, car il a unifié l'Univers et ne s'attarde plus sur les éléments naturels, tel que le soleil, la lune, les arbres, etc. Cependant, il existe comme dans le paganisme un ordre interne à l'Univers, ce que Charles Baudelaire a célébré dans ses poèmes des Fleurs du Mal avec le principe des « correspondances ». Ce qui correspond se répond, ayant une sympathie naturelle...
Il va de soi que le néo-platonisme ressemble outrageusement au christianisme apparu juste avant lui ; en fait, les deux courants se sont nourris l'un l'autre. On ne peut nullement comprendre le christianisme, surtout le catholicisme, sans connaître Plotin et ses thèses qui forment le squelette même du mysticisme anti-matérialiste, où il s'agit de se tourner uniquement vers ce qui n'est pas matière.
Voici ce que dit Plotin par exemple sur le rapport entre l'Un, l'intelligence et l'âme (ici désigné par l'intellect) – on croirait lire une explication du rapport entre « le Père, le Fils et le Saint-Esprit » :
« L'Intelligence est belle sans doute; elle est la plus belle des choses, puisqu'elle est éclairée d'une pure lumière, qu'elle brille d'un pur éclat, qu'elle contient les êtres intelligibles, dont notre monde, malgré sa beauté, n'est qu'une ombre et qu'une image...»
Plotin appelle à l'extase dans la compréhension de la nature de Dieu ; pour parvenir à cette extase, il faut que l'âme cesse de se mêler au corps. Il y a donc une bataille et le néo-platonisme de Plotin fournit les arguments théoriques les plus « purs » de chaque religion : il y a une séparation entre le corps et l'esprit, il y a une bataille entre eux.
La religion est le levier pour comprendre comment se focaliser sur l'âme et parvenir à rejeter un corps à dévaloriser...
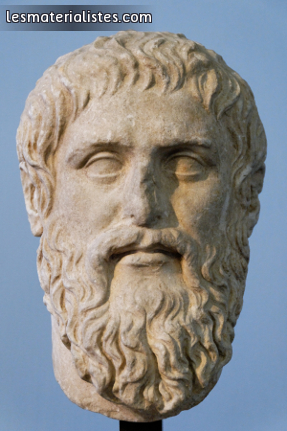 Ce qui caractérise la position de Plotin, c'est qu'il fournit une théorie religieuse présentée de manière philosophique.
Ce qui caractérise la position de Plotin, c'est qu'il fournit une théorie religieuse présentée de manière philosophique.
C'est là exactement le même schéma que celui fournit par Platon dans l'allégorie de la caverne : le monde matériel n'est qu'un pâle reflet d'un monde idéal, qui lui-même a comme source le « Un » absolu, source de tout et seule réalité authentique.
L'idée de Plotin était simple, mais géniale. Puisque Aristote niait le monde « d'en haut », la seule réponse possible était d'accepter cela, mais en niant pour autant le monde d'en bas. Ne reste alors qu'un seul monde, qui n'est plus matériel et qu'il reste alors à définir.
Né en 205 à Lycopolis, ville d'Egypte sous contrôle romain, Plotin étudia à Alexandrie avant de devenir, à Rome, la principale figure du courant néo-platonicien émergeant alors.
Le terme de néo-platonicien fut conçu au XIXe siècle, Plotin et les néo-platoniciens se considérant simplement comme platoniciens ; cependant, leur méthode apportait une perspective uniquement mystique exigeant une identification précise.
Le néo-platonisme liquide, en effet, toutes les réflexions platoniciennes, pour n'en conserver que l'idéalisme tourné, non pas dans un sens politique comme avec la République de Platon, modèle de société de castes, mais dans un sens mystique...
Les néoplatoniciens n'ont jamais fait que redire ce que Platon avait dit (dans le Timée, entre autres). On sait peu de choses sur les platoniciens suivant l'effondrement d'Athènes, mais il est certain que les néoplatoniciens ne sont ici nullement originaux et n'ont jamais prétendu modifier ou renouveler Platon.
Ce qui justifie d'une certaine manière le terme, c'est qu'ils intègrent dans leur philosophie ce qu'ils pensent être la philosophie d'Aristote, pourtant opposée à celle de Platon. Il ya là un moment complexe, éminemment dialectique...
Le principe du dualisme est que le monde matériel est insuffisant et qu'il faut se tourner vers le spirituel. L'âme des individus, c'est en fait une petite étincelle de l'âme du monde, du Dieu vivant. La matière est un degré inférieur de réalité, la seule réalité authentique étant le monde spirituel.
L'âme est donc ce qui compte réellement et il s'agit d'abandonner les préoccupations matérielles. Plus on est un corps, moins on est une âme. Ce qui fait dire à Timée, dans l'œuvre éponyme de Platon : « A cause de tous ces accidents, aujourd'hui et depuis les premiers temps, l'âme commence par être sans intelligence, quand elle vient d'être unie à un corps mortel ...»
Le « Timée » n'aurait pas eu l'effet idéologique qu'il a eu s'il ne consistait qu'en un simple dualisme opposant le matériel et l'immatériel. On y trouve une « explication » particulièrement développée des niveaux d'interaction entre l'immatériel et le spirituel.
Cette explication est la seule qui « tienne debout » sur le plan intellectuel, à défaut d'être juste ; elle sera reprise par toutes les religions. Le néo-platonisme consiste précisément en l'approfondissement de cette explication...
Le « Timée » est l'œuvre de Platon dont le succès fut le plus retentissant après l'effondrement d'Athènes ; durant l'obscur Moyen-Âge européen, il sera l'unique œuvre connue réellement qui soit issue de l'antiquité gréco-romaine, et son influence sera énorme.
La raison en est que c'est une œuvre profondément mystique. Normalement, Platon œuvre à régénérer Athènes, et ce sur une base élitiste au possible ; son mysticisme est secondaire, visant à justifier l'élitisme. La disparition de cet élitisme, dû à l'effondrement du mode de production esclavagiste, a amené la récupération de son idéalisme...
Lorsque Platon et Aristote firent irruption sur la scène de l'Histoire, la cité-État d'Athènes était déjà profondément affaiblie. Sa concurrence avec Sparte avait épuisé les deux protagonistes, permettant à la Macédoine de finalement prendre le dessus. L'échec d'Alexandre le Grand à établir un empire macédonien dans la durée permit alors à Rome de former son propre empire, qui finit par vaciller sous son propre poids, ses propres contradictions.
On est là dans le contexte de l'effondrement du mode de production esclavagiste. Étaient remis en cause des décennies, des siècles, voire un, deux, trois millénaires de traditions, de psychologie, de mentalités...
L'échec du calvinisme est l'expression de l'échec du sud de la France à former une nation, malgré certains éléments constitutifs présents. Théodore Agrippa d'Aubigné lui-même vient de Pons, dans la région de Saintonge dans le Sud-Ouest de la France.
Friedrich Engels le constate bien, en comparant la situation du Sud de la France à celle de la Pologne au XVIIIe siècle. La Pologne a réussi à se maintenir en tant que nation par la dimension anti-féodale de son action, là où la France du Sud, de par le maintien complet du féodalisme, n'a pas pu se développer...
Le projet étant en échec, la perspective bloquée, Les Tragiques ne pouvaient exprimer le calvinisme français que par un ton chaotique, un fil décousu, une approche à la fois satirique et tragique, dans une impression de confusion générale. Il s'agit d'une fuite en avant, propre par ailleurs à la faiblesse idéologique du calvinisme naissant.
Martin Luther, une fois qu'il aura soutenu la noblesse contre les paysans révoltés, se précipitera pareillement dans une fuite en avant dans une sorte d'anticapitalisme romantique avant l'heure, adoptant un ton forcené appelant au massacre des sorcières et des juifs, afin de trouver une « direction » à indiquer, une perspective communautaire donnant du sens en apparence...
Cette limitation historique du calvinisme en France qui s'exprime dans Les Tragiques se lit également dans la forme du recueil. L’œuvre est divisée en sept parties, appelées livres, avec chacune un titre : Misères, Princes, La chambre dorée, Les feux, Les fers, Vengeances, Jugement.
On peut y voir, dans sa structure, un parallèle avec les sept sceaux de l'Apocalypse de Jean ; on retrouve, pareillement, des descriptions de choses monstrueuses, avant que les justes soient sauvés. Misères décrit la terrible situation d'alors, alors que Théodore Agrippa d'Aubigné se présente comme un nouveau Hannibal partant en guerre contre Rome...
En tant que recueil poétique, Les Tragiques reflètent à la fois une démarche de rupture avec le féodalisme porté par le calvinisme, mais également l'échec du calvinisme français de par la base de sa direction largement soumise à des fractions aristocratiques.
C'est une œuvre significative de tout un processus historique ayant eu une importance capitale en France, puisque conditionnant les modalités de l'affirmation de la monarchie absolue...
Les Tragiques sont ainsi une œuvre exprimant une défaite, et c'est cela qui fait son intérêt, Théodore Agrippa d'Aubigné étant une figure historique d'une grande importance pour la France du XVIe siècle.
Il fut, en effet, un des principaux activistes de la cause protestante en France, tant sur le plan militaire que sur le plan intellectuel.
C'est en ce sens qu'ont une valeur historique les écrits de Théodore Agrippa d'Aubigné synthétisant cet épisode historique que furent les guerres de religion : Les Tragiques, écrits en vers et publiés en 1616), l'Histoire Universelle, publiés dans la période 1616-1620, en prose et d'une approche plus formelle...
Nous sommes en 1616 lorsque Les Tragiques sont publiées, alors que Henri IV s'est fait assassiné en 1610, malgré qu'il ait abjuré le protestantisme en 1593. Son auteur, Théodore Agrippa d'Aubigné, figure du protestantisme et historiquement très proche de Henri IV, ne peut plus alors faire qu'un constat désabusé : « ce siècle n’est rien qu’une histoire tragique ».
Son parti, celui du calvinisme qui s'est lancé dans une grande offensive anti-cléricale, n'a pas réussi sa percée, alors que son chef même, son proche ami qu'il a toujours valorisé comme le chef des protestants, a capitulé pour devenir Roi. L’Édit de Nantes qu'il a formulé est d'ailleurs terriblement bancal et un piège se refermant sur les calvinistes...
Mao Zedong constate également une chose qui peut surprendre. En parlant des aspects de la contradiction, il en souligne l'unité. On pourrait se dire qu'il vaudrait mieux noter leur affrontement. Seulement, ce serait là aboutir au caractère indépendant, isolé d'un aspect de la contradiction – ce qui est impossible.
Mao Zedong explique cela dans un passage important : « L'identité, l'unité, la coïncidence, l'interpénétration, l'imprégnation réciproque, l'interdépendance (ou bien le conditionnement mutuel), la liaison réciproque ou la coopération mutuelle – tous ces termes ont la même signification et se rapportent aux deux points suivants : premièrement, chacun des deux aspects d'une contradiction dans le processus de développement d'une chose ou d'un phénomène présuppose l'existence de l'autre aspect qui est son contraire, tous deux coexistant dans l'unité »...
Connaître le mouvement, c'est connaître la matière. Connaître un mouvement en particulier, c'est connaître un phénomène en particulier. S'il y a des choses différentes, c'est parce que leur mouvement est différent.
Voici ce qu'explique Mao Zedong, dans un passage très important : « Toute forme de mouvement contient en soi ses propres contradictions spécifiques, lesquelles constituent cette essence spécifique qui différencie une chose des autres. C'est cela qui est la cause interne ou si l'on veut la base de la diversité infinie des choses dans le monde. »...
Michel de Montaigne se donna comme devise et comme symbole une balance avec écrit « Que sais-je ? », question formée par Pyrrhon, le théoricien du scepticisme, qui appelle à tout remetre en cause. Toutefois, rien de baroque chez Montaigne ; il ne s'agit pas de nier la vérité. Il s'agit de reconnaître qu'elle est mouvante, qu'elle est de nature politique. Il faut savoir gérer et pour cela il faut savoir évaluer. La philosophie de Michel de Montaigne, s'il fallait la résumer, consiste en une apologie de l'évaluation.
Les situations changeant toutes – Michel de Montaigne ne peut pas comprendre le matérialisme dialectique encore, historiquement – il ne donne pas un manuel, par conséquent, mais des pistes, des exemples, afin de s'inspirer, d'être capable de soupeser, d'évaluer...
Dans sa défense de Raymond Sebond, Michel de Montaigne ne parle donc pratiquement pas de Raymond Sebond. Il y parle toutefois extrêmement longuement des animaux. Raymond Sebond considérait que la religion et la Nature disaient la même chose ; quand on lit Michel de Montaigne, on a bien plutôt l'impression que l'être humain est un animal comme les autres, tout à fait dans la tradition du matérialisme. La manière avec laquelle il aborde la question des animaux est clairement athée.
Il a une réelle compassion pour les animaux, qu'on ne trouve que dans l'athéisme, qui célèbre la vie en général...
Le passage le plus connu des Essais touche, paradoxalement, la religion. Michel de Montaigne y prend la défense de Ramon Sibiuda (vers 1385 - 1436), un théologien catalan, dans un chapitre très long, bien plus long que les autres. Il semble dédié également à Marguerite de Valois, fille de Henri II et de Catherine de Médicis, femme d’Henri de Navarre, le futur Henri IV.
Ce qui est très paradoxal, c'est que Michel de Montaigne raconte un nombre incroyable de choses dans ce chapitre, mais en tout cas pas de Raymond Sebon. Il raconte avoir traduit une œuvre de Raymond Sebond à la demande de son père, qui s'y intéressait. C'est peut-être une couverture : Raymond Sebond considère en fait, dans la logique de la Renaissance, que la religion et la nature disent la même chose, que donc les sciences naturelles sont un moyen de retomber en quelque sorte sur la religion. C'est le fameux principe averroïste de la double vérité...
Avoir son avis pour soi, c'est forcément pratiquer la double vérité : on apparaît d'une certaine manière, aux yeux de l'Église, mais on a un avis personnel. Les commentateurs bourgeois ne sont jamais arrivés à trancher sur le caractère religieux ou non de Michel de Montaigne. Tout comme pour Molière, ils soupçonnent l'athéisme, mais ils voient que dans sa vie, Michel de Montaigne a respecté la religion, que dans les Essais le catholicisme est mis en avant. Ils ratent en fait le principe averroïste de présenter de manière indirecte les thèses de l'athéisme, en raison de la censure et de la répression.
On sait que chaque page des Essais contient une ou plusieurs citations d'auteur de l'antiquité, qu'il s'agit d'une oeuvre de réflexion, avec un regard critique sur soi-même. Il y a de la curiosité, un travail réel qui est fait. Or, Michel de Montaigne explique que pour apprécier la religion, il ne fait pas juger, il faut être pratiquement idiot...
L'averroïsme politique prône la rationalité, et donc, avec la critique de l'Espagne catholique et la séparation de l'Église et de la pensée d'État, on trouve le rejet des superstitions et de la torture. Cela témoigne du fait que sur le plan de la civilisation, la monarchie absolue représente une étape nouvelle.
Parmi les superstitions, Michel de Montaigne classe bien entendu la confiance aveugle en les médecins. Ce qui est préfiguré ici, c'est la critique de Molière. Voici comment Montaigne se moque de la nature des médicaments proposés : « Même le choix qu’ils font de leurs drogues a quelque chose de mystérieux et de divin. Le pied gauche d’une tortue, l’urine d’un lézard, lafiente d’un éléphant, le foie d’une taupe, du sang tiré sous l’aile droite d’un pigeon blanc...»
Michel de Montaigne travaillait dans sa bibliothèque, dans une tour de son domaine et y avait fait graver des phrases sur les poutres et les solives du plafond. On lit ainsi cette citation de Pline :
« Il n’est rien de certain que l’incertitude, et rien de plus misérable et de plus fier que l’homme. »
On y lisait aussi cette sentence de Sextus Empiricus :
« Il n’y a aucun argument qui n’ait son contraire, dit la plus sage école philosophique. »...
L'éloge de la « politique » contre le raffinement, de Sparte contre Athènes, est au cœur des Essais de Michel de Montaigne. C'est en cela qu'il faut comprendre les références aux autres pays, notamment à l'Amérique.
On sait que Michel de Montaigne, dans les Essais, a traité de la question des « cannibales » en Amérique ; c'est un argument ethno-différencialiste utilisé systématiquement dans les cours de français au lycée.
 L'année 1932 a été un tournant dans l'histoire allemande, dans la mesure où elle préfigure la prise du pouvoir par Adolf Hitler.
L'année 1932 a été un tournant dans l'histoire allemande, dans la mesure où elle préfigure la prise du pouvoir par Adolf Hitler.
Si elle réussit un bon score, la haute bourgeoisie osera de plus en plus à passer le cap d'un soutien à Marine Le Pen, chose considérée comme relevant encore trop de l'aventurisme.
Mais si son score en haut, si elle montre qu'elle encadre avec succès une large partie du prolétariat, alors elle montre son efficacité, sa fiabilité, et cela encore plus si un secteur de la bourgeoisie industrielle la soutient également.
C'est une raison de plus d'appeler au barrage électoral pour le second tour des élections présidentielles : il faut que Marine Le Pen perde, avec un score le plus bas possible !...
Le Front de la Patrie mit en place comme régime la République Populaire de Bulgarie, dont les deux premiers articles de la constitution constatant que :
« La Bulgarie est une République populaire à gouvernement représentatif, établie et affermie à la suite des luttes héroïques du peuple bulgare contre la dictature monarcho-fasciste et de l'insurrection populaire victorieuse du 9 septembre 1944.
Dans la République populaire de Bulgarie, tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple. Le peuple exerce ce pouvoir par des organes représentatifs librement élus et par référendum. Tous les organes représentatifs du pouvoir de l’État sont élus par les citoyens sur la base du droit électoral universel, égal et direct, au scrutin secret. »...
Le Front de la Patrie tint son premier congrès du 9 au 12 mars 1945, alors que parallèlement l'Union Générale des Syndicats Ouvriers tint son premier congrès du 16 au 20 mars 1945.
En août 1945, Georgi Dimitrov fut libéré de sa fonction de député du Soviet Suprême de l'URSS. Il put alors retourner en Bulgarie le 6 novembre 1945 en Bulgarie, après 22 années d'émigration.
Il devint alors la figure majeure du Front de la Patrie, qui présenta une liste unifiée aux élections du 18 novembre 1945, réunissant les communistes, le Parti Agrarien, l'Union Populaire « zvéno », le Parti Ouvrier Social-démocrate et le Parti Radical, récoltant 88,18 % des voix, avec un taux de participation de 85,60 %...
En mars 1941, la Bulgarie rentra dans la Seconde Guerre mondiale impérialiste, en rejoignant le pacte tripartie (regroupant l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon). Elle participe à l'offensive contre la Grèce et la Yougoslavie.
Les communistes lancèrent alors comme appel :
« Pas un grain de blé bulgare, pas un morceau de pain bulgare pour les fascistes allemands ! Pas un seul Bulgare à leurs service ! »...
« Pourquoi et de quelle façon le fascisme a-t-il pu vaincre ?
Le fascisme est le pire ennemi de la classe ouvrière et des travailleurs.
Le fascisme est l'ennemi des neuf dixièmes du peuple allemand, des neuf dixièmes du peuple autrichien, des neuf dixièmes des autres peuples des pays fascistes...
Une fois en URSS, Georgi Dimitrov participa à de très nombreuses célébrations, devenant une figure importante du pays.
Ce ne fut cependant pas tout : il participa aux travaux du VIIe congrès de l'Internationale Communiste, où il présenta dès le premier jour, le 2 août 1935, le rapport « L'offensive du fascisme et les tâches de l'Internationale Communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme ».
Il prononça également le discours de clôture du rapport au VIIe congrès, le 13 août, sous le titre « Pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme »...
Après le procès, Georgi Dimitrov se retrouva en première ligne pour exposer la nature du fascisme, ce qu'il fit tout d'abord dans la presse soviétique (Les premiers enseignements, Ce que nous devons dire avant tout). Voici l'extrait principal d'un article qu'il écrivit pour la Pravda, l'organe du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchévik). Paru dans ce quotidien le 4 mars 1934, l'articile s'intitule Une victoire de la solidarité prolétarienne :
L'incendie du Reichstag devait marquer et marqua effectivement l'origine d'une campagne terroriste du fascisme allemand contre le mouvement révolutionnaire du prolétariat.
La provocation du 27 février 1933 visait à être le signal de l'« anéantissement » du marxisme, en entendant par là le mouvement révolutionnaire du prolétariat allemand...
Dimitrov. - En vertu du paragraphe 258 du code de procédure criminelle, j'ai le droit de parler comme défenseur et comme accusé.
Le président. - Vous avez le droit de parler le dernier. Cela vous est accordé maintenant.
Dimitrov. - En vertu de ce code, j'ai le droit de discuter avec le ministère public et, ensuite, de faire une dernière déclaration.
Messieurs les juges, messieurs les accusateurs, messieurs les défenseurs, déjà, au début du procès, il y a trois mois de cela, j'ai adressé, en tant que prévenu, une lettre au président du tribunal...
Georgi Dimitrov s'installa à Vienne à partir de la fin janvier 1927, ville abritant la direction du Comité Central du Parti Communiste de Bulgarie (étroit). Il se rendit en 1928 en URSS, pour assister au IVe congrès du Profintern (l'Internationale Syndicale Rouge) et au VIe Congrès du Komintern, où il fut le délégué bulgare, parlant à ce titre le 6 août 1928.
L'écrasement de 1923 provoqua une véritable onde de choc dans l'esprit de Georgi Dimitrov, surtout que la situation en Bulgarie n'était pas marquée par une amélioration.
Par la suite, le Parti Communiste de Bulgarie (étroit) tenta en effet de prolonger le mouvement, en coopération avec les agrariens et des généraux de gauche.
L'apogée de cela consista, le 16 avril 1925, en la décision d'une partie de la direction de mener l'attaque à l'explosif de la cathédrale Sveta Nedelia devant accueillir la cour du roi lors des obsèques du général Konstantin Georgiev, exécuté par les communistes quelques jours auparavant pour son rôle dans la ligue militaire...
Un événement essentiel vint modifier la situation en Bulgarie en 1921. La victoire de l'Armée rouge dans la guerre civile russe amena les troupes du général Wrangel à se réfugier en Bulgarie.
La présence d'environ 36 000 soldats de l'armée blanche polarisait grandement la situation, faisant planer la menace d'un coup d’État.
Les communistes appuyèrent alors le gouvernement agrarien (« Union nationale agraire bulgare ») et socialiste, malgré sa répression menée jusque-là sous l'égide du premier ministre agrarien Alexandre Stamboliyski...
L'irruption des guerres balkaniques à partir de 1912 – la Bulgarie, la Grèce, la Serbie contre l'empire ottoman, puis la Bulgarie contre la Grèce et la Serbie – désorganisa relativement le Parti, même si en 1913 il obtint 18 députés (contre un seul auparavant), dont Georgi Dimitrov. Le Parti mena ensuite campagne en faveur de la cessation de la Première Guerre mondiale, Georgi Dimitrov étant arrêté pour cette raison à de nombreuses reprises de manière brève, la polarisation se produisant d'autant plus qu'à partir de septembre 1915, la monarchie bulgare fit entrer le pays dans la guerre, du côté de l'Allemagne.
Finalement, Georgi Dimitrov fut condamné à trois ans de prison, qu'il commença en août 1918, pour s'être rebellé en août 1917 contre un officier chassant un blessé de la première classe d'un train. L'accusation officielle fut « l'incitation des militaires à la désobéissance et à l'indiscipline en temps de guerre »...
Georgi Dimitrov est né le 18 juin 1882, dans le village de Kovatchevtsi près de Pernik, une région minière non loin de Sofia. Il est né dans les champs, sa mère servant d'aide aux champs, avant de devenir servante, tandis que son père parvint par la suite à s'installer comme artisan de chapeaux à Sofia.
Ses parents provenaient tous deux de la région de Krésna-Razlog, marquée à la fin du XIXe siècle par un soulèvement bulgare anti-ottoman, dans le cadre du refus de la Macédoine bulgare de rester dans le giron ottoman...
Georgi Dimitrov a été l'une des personnalités les plus connues mondialement durant les années 1930, marquant de son sceau l'histoire des années 1940 et 1950. Il est impossible de s'intéresser à l'Histoire du monde sans lui accorder une place extrêmement importante.
Les raisons pour cela sont multiples : tout d'abord, il fut la victime d'un procès retentissant en Allemagne nazie en 1933, attirant une attention très approfondie de la presse mondiale et de l'opinion démocratique mondiale...
Lorsque le KKE décide de cesser la lutte armée, la DSE dut organiser son repli. 55 381 personnes, dont 17 352 enfants, quittèrent la Grèce.
Environ 70 % des réfugiés venaient de la paysannerie ; environ un tiers était membre du KKE. En URSS, c'est l'Ouzbékistan qui accueillit les réfugiés, dans le quartier Politeies de la capitale Tachkent.
Le KKE tint rapidement son troisième congrès, du 10 au 14 octobre 1950, réaffirmant ses positions. Le prestige historique du KKE est alors très grand et lors du XIXe congrès du PCUS en octobre 1952, Níkos Zachariádis est mis en avant comme l'une des principales figures du mouvement communiste international...
De manière officielle, l’État grec réactionnaire avait perdu 55 528 soldats, alors que 38 839 soldats de la DSE avaient été tués ou blessés.
Mais la cessation de la lutte armée ne signifiait nullement la fin de la lutte des classes ; il restait d'ailleurs différentes unités et les deux derniers partisans de la DSE, Giorgos Tzompanakis et Spiros Blazakis en Crète, descendirent par exemple de la montagne en 1975 seulement, après l'effondrement de la dictature des colonels le 24 février.
C'est le général Aléxandros Papágos, le dirigeant des armées réactionnaires soutenues par les États-Unis d'Amérique, qui reçut la charge de réorganiser le pays...
La lutte démocratique pour l'émancipation de la femme est une cause essentielle. Les femmes représentent la moitié de l'Humanité et, pour des raisons historiques, elles ont été marginalisées socialement avec la mise en place de l'agriculture et de l'élevage.
C'est justement cette cause historique qui fait que le communisme, amenant le dépassement de la contradiction entre villes et campagnes, entre travail manuel et travail intellectuel, permet la réalisation de l'émancipation de la femme...
Les événements de l'année 1949 sont à la fois rapides, nombreux et extrêmement complexes, tout en étant relativement trompeurs. En effet, si d'un côté la DSE est défaite, le KKE considère que ce n'est un épisode particulièrement douloureux d'une vaste séquence dont il va sortir victorieux.
La situation est à considérer comme suit : les forces du progrès doivent chercher à éviter les campagnes d'encerclement et d'anéantissement des forces de la réaction. Jusque-là, la DSE avait montré ses capacités tout à fait excellentes à ce niveau...
La venue de Paul Eluard coïncide avec un moment où le KKE est le fer de lance pour la bataille de la démocratie populaire, au point qu'il est considéré dans l'est européen que la Grèce allait bientôt rejoindre le camp démocratique. Voici comment le KKE voit les choses, au début de l'année 1949, dans une résolution.
Celle-ci est issue de la tenue du cinquième Plénum commun du Comité Central du KKE, qui s'est tenu les 30 et 31 janvier 1949 ; elle a comme titre La Grèce sur la voie de la victoire devant le tournant décisif. On remarquera que le rôle essentiel de la révolution chinoise est soulignée dès le début du document...
L'ensemble du mouvement communiste international apporta son soutien à la DSE. Le quotidien du Parti Communiste français, L'Humanité, envoya Simone Téry comme reporter dans la Grèce libre, dans le nord du pays, en octobtre1947, ses reportages étant publiées dans une série intitulée Les hommes de cœur sont plus forts que les dollars, publiée dans le quotidien du 19 décembre 1947 au 14 janvier 1948. Par la suite, un événement marquant fut la venue en Grèce, en 1949, du poète et résistant français Paul Eluard.
Il fut accompagné notamment de gens issus de la gauche socialiste se rapprochant du PCF par leur parcours dans la Résistance : le journaliste et homme politique Yves Farge, à l'origine de la dénonciation d'un grand scandale de corruption en 1946, l'ancien journaliste du journaliste socialiste Le Populaire Jean Maurice Herman, fondateur du Syndicat National des Journalistes CGT, ainsi que l'instituteur Henri Bassis...
La clique de Tito poignarde dans le dos la Grèce démocratique populaire
par NICOS ZACHARIADIS
Cet article a été publié pour la première fois dans l'organe du Bureau d'Informations des Partis Communistes et Ouvriers « Pour une Paix durable pour la Démocratie Populaire » N°15 du 1er aout 1949
L'exploitation infâme de la question Macédonienne par la clique traîtresse de Tito
par PANAYOTIS MAVROMATIS
La question nationale fut toujours une des questions les plus délicates et les plus difficiles qu'avaient eu et ont à envisager les Partis de la classe ouvrière.
Les impérialistes anglais et la résistance nationale de Grèce et de Yougoslavie
par COSTAS CARAGHIORMS
Rien ne pourrait, peut-être illustrer plus nettement et d'une manière plus caractéristique la dégénérescence trotskiste et chauviniste des dirigeants du PCY que leur conduite envers la lutte antiimperialiste de libération nationale du peuple grec. A l'heure actuelle leur position est devenue plus franchement et plus ouvertement hostile.
La clique de Tito et le Parti Communiste de Grèce
par ZISSIS ZOGRAFOS
La trahison de Tito et de sa clique aboutit, ces derniers temps, à son extrême conséquence logique envers l'Union Soviétique, les Démocraties Populaires, le front anti impérialiste en général.
La clique de Tito au fond de la trahison
par MILTIADE PORFYROGENIS
Quand, vers la fin de juin 1948 fut communiquée la résolution du Bureau d'Informations des Partis Communistes et Ouvriers, sur la situation dans le Parti Communiste de Yougoslavie, et avant même que le Parti Communiste de la Grèce eût annoncé sa thèse sur la résolution, des simples membres du Parti, ici dans la Grèce Libre, exprimaient leur indignation pour l'attitude des dirigeants du P.C. de Yougoslavie.
RÉSOLUTION du 4e Plenum du CC du PCG
GRAMMOS 30-31 juillet 1948
La trahison de Tito et le PCG
par PETROS ROUSSOS
Cet article a été transmis pour la première fois par la Radio de la Grèce Libre le 6.8.49.
L'agence télégraphique « Grèce Libre » a révélé que le 5 juillet 1949 des officiers de Tito ont collaboré à la frontière avec des collègues monarcho-fascistes.
L'échec de l'opération Couronne fut un revers de taille pour l'impérialisme américain et les forces réactionnaires grecques.
Van Fleet décida alors de fasciser complètement l'armée grecque, dont le commandement revint en janvier 1949 à Aléxandros Papágos, dont l'une des premières mesures fut d'autoriser l'utilisation du napalm par les forces américaines.
Les officiers reçurent l'autorisation d'abattre ceux qui ne combattraient pas de manière assez décidée, les commandants eux-mêmes risquant la court martiale, les retraites n'étant autorisées que sur ordre exprès du quartier-général...
Níkos Zachariádis avait tout à fait compris que la question de la guerre civile était celui de l'affrontement entre la démocratie populaire et le fascisme. La DSE n'était pas une fin en soi, pas plus que l'EAM ; il ne s'agissait que d'éléments dans une séquence plus générale.
La force du mouvement de libération national avait ainsi résidé, selon Níkos Zachariádis, dans le fait que l'indépendance nationale avait été affirmée en rapport avec la bataille pour la démocratie, ce qui allait avec la question agraire ; la question nationale de l'indépendance était inséparable du rapport à la démocratie...
Si la DSE représentait la tendance démocratique, progressiste, se renforçant par rapport à une réaction déchaînée, mais s'épuisant, un nouveau facteur vint entièrement modifier la donne.
Les États-Unis considérèrent en effet qu'il était nécessaire qu'elles interviennent, afin d'empêcher la Grèce de devenir une démocratie populaire, étant donné que la Grande-Bretagne n'était plus en mesure de porter le régime grec...
La non-participation aux élections fut une erreur tactique, donnant le champ libre aux réactionnaires : le référendum sur le retour du Roi obtint 69 % de voix favorables à celui-ci, qui revint alors le 27 septembre 1946 à Athènes, accueilli triomphalement par ses partisans.
Le régime avait également auparavant annulé en mai 1946 la victoire (88%) aux élections syndicales de l'ERGAS (Ergatikos Antiphasistikos Synaspismos – Bloc ouvrier antifasciste), tout comme il avait en juin 1946 modifié la direction du syndicat GSEE, jusque-là communiste.
Jusqu'en 1947, le bilan de la répression s'élevait à 24 000 personnes assassinées, 105 exécutés par les cours martiales, 6 671 personnes grièvement blessées, 31 682 torturés, 84 931 détenus, 18 867 foyers saccagés, 577 bureaux et imprimeries mis à sac, 165 viols, 5 817 exils, 12 000 personnes envoyés en camp de concentration...
Le paradoxe du gigantesque succès du KKE avec l'EAM et l'ELAS, c'est que le théoricien de la ligne de libération nationale qui amena cela n'était plus présent depuis plusieurs années.
Arrêté en 1936 par la dictature de Ioánnis Metaxás, Níkos Zachariádis fut envoyé au camp de concentration de Dachau en 1941. Le KKE n'avait plus aucune nouvelle de lui depuis.
Grande figure historique cependant du KKE - à ce titre, Níkos Zachariádis était très connu des masses - la nouvelle de son retour annoncé le premier mai 1945 dans l'organe du Parti Rizospastis provoqua une onde de choc...
Winston Churchill, le Premier ministre anglais, avait exigé lors de la conférence de Moscou en octobre 1944 un découpage en zones d'influence, suivant les modalités suivantes : Hongrie et Yougoslavie : 50%- 50%, Roumanie : 10% - 90%, Bulgarie: 25% - 75% et Grèce : 90 % - 10%.
Ces pourcentages n'ont aucune signification en soi, à part qu'ils signifiaient que l'impérialisme britannique ne tolérerait pas d'intervention ouverte de l'Armée rouge en Grèce.
Impossible pour l'URSS de ne pas accepter cela, de par la nécessité de l'alliance générale contre l'Allemagne nazie – le risque n'étant pas de ne pas battre celle-ci, mais que celle-ci réussisse un retournement d'alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans une optique anti-soviétique...
Si le KKE avait l'initiative jusque-là, la présence britannique allait se révéler être un énorme un obstacle. Cette question allait être au cœur du positionnement du KKE et la source de la guerre civile.
Quelles sont les raisons à cela ? Déjà, parce que cela signifiait à court terme une reformation de l'EDES, qui put mener une dernière contre-offensive en janvier 1944, ce qui provoqua immédiatement une réponse acharnée de l'ELAS. Ensuite, parce que l'impérialisme britannique s'était placé au centre des négociations entre l'ELAS, l'EKKA et l'EDES. Enfin, parce qu'avec ce positionnement, l'impérialisme britannique appuyait tout azimut les initiatives anti-communistes, récupérant toutes les forces possibles, même celles ayant été auparavant des fervents soutiens de l'Allemagne nazie...
L'opposition à l'occupation prit en Grèce rapidement un large aspect populaire, comme en témoigne la vague de grèves et de rassemblements à Athènes à la fin d'octobre 1941. L'EAM, bien que très faible dans certaines zones, organisait notamment des cuisines populaires pour faire face à la famine ; cela restait embryonnaire, mais une dynamique s'affirmait.
Cela aboutit notamment à la vaste grève à Athènes à l'été 1942, à laquelle participèrent les ouvriers d'une usine de caoutchouc pour l'Armée allemande, ceux du port, ceux des tramways et de la production d'électricité, des assurances, de quelques banques, des postes et télécommunications, etc...
Le coup d’État d'août 1936 porta un coup terrible au KKE : 1 000 membres furent arrêtés, les archives du bureau politique furent découvertes par les services secrets et l'organisation clandestine démantelée, alors que 150 membres furent encore arrêtés en 1938.
A la fin novembre 1939, l'ensemble du Comité Central de 1935 était en prison. Le régime pratiqua l'isolement et la torture, encourageant à des formes ouvertes de repentir, avec publications dans la presse, etc. Il mit même en place une fausse organisation du KKE se posant comme « direction provisoire » afin de saboter la reconstitution organisationnelle illégale du KKE...
L'histoire politique de la Grèce est marquée par la tentative de réaliser la « Grande Idée » et son échec avec la « grande catastrophe », c'est-à-dire que l'opposition à la domination ottomane réalisée par l'instauration d'une monarchie en 1832 s'est prolongée en un nationalisme ouvertement expansionniste, qui se brisa toutefois face à la Turquie. Au cours de ce processus, la Grèce put s'agrandir initialement, à la suite de la guerre balkanique de 1912-1913, sa population passant de 2,8 à 5 millions de personnes.
Mais la Première Guerre mondiale et ses conséquences, avec l'apparition de la Turquie, eut comme résultat une défaite militaire complète en 1922, l'échange de population, avec un million et demi de chrétiens quittant l'Anatolie et la Thrace orientale (et 388 000 Turcs la Macédoine), provoquant un procès en Grèce contre les prétendus responsables de la défaite (le « procès des six », avec la condamnation à mort de cinq ministres et du chef de l'armée en Asie mineure), puis même l'effondrement de la monarchie en mars 1924...
En 1919, Karl Kautsky publia Domination populaire ou domination de la violence et son point de vue est très simple. Les Alliés ont gagné la guerre, car leur prolétariat les a soutenu, la lutte s'étant présentée selon lui comme une lutte contre le militarisme et l'autocratie. Pour cette raison, le prolétariat ne pourra désormais plus que prolonger sa logique de revendications et le socialisme apparaîtra comme nécessaire, sans même une révolution violente.
Cela montre à quel point Karl Kautsky n'a en rien saisi la nature de l'impérialisme, que Lénine a justement défini...
Le centrisme de Karl Kautsky se prolongea y compris en pleine effervescence révolutionnaire en Allemagne. Lors d'un conférence générale de l'opposition en avril 1917, Karl Kautsky s'opposa ainsi tant à la présence des spartakistes qu'à la formation d'une nouvelle organisation, le Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - USPD (Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne).
L'USPD eut pourtant un succès immédiat, obtenant 120 000 adhérents en quelques mois, alors que le vieux parti social-démocrate n'en avait alors plus que 240 000. Karl Kautsky et Eduard Bernstein prirent dans ce cadre une position tellement réformiste qu'ils devinrent les chefs de file de son aile droite...
Il est nécessaire ici de voir que c'est précisément cette passivité typique de Karl Kautsky que Lénine dénonce sous le vocable de kautskysme. Le kautskysme est ici un centrisme, c'est-à-dire une collusion avec la droite contre la gauche, au nom du succès mécanique inévitable censé arriver.
Karl Kautsky assuma cette position centriste jusqu'à la caricature. En 1915, il publia dans ce cadre État national, État impérialiste et fédération des États. C'était un ouvrage étrange : Karl Kautsky tentait d'y formuler une ligne de pseudo-critique de l'impérialisme, en pleine guerre...
La question de la grève de masses révéla tout ce que le kautskysme contenait de problématique. En 1893, Karl Kautsky abordait ainsi la question du parlementarisme, dans un long document cherchant à définir la position de la social-démocratie. Ce qui y est frappant, c'est que dès le début, il insiste sur une de ses anciennes positions : à ses yeux, même lorsque le peuple donnera directement le pouvoir, le parlementarisme est absolument nécessaire.
C'est très exactement la critique que fera Rosa Luxembourg à Lénine à la suite de la révolution russe de 1917. La principale erreur de la social-démocratie historique a été, en effet, une conception de la démocratie qu'elle opposait, non pas à la bourgeoisie comme le fit Lénine, mais à l'absolutisme...
Karl Kautsky considérait que la social-démocratie allait l'emporter de manière naturelle, submergeant le capitalisme pourrissant. Cette conception combinant mécanique historique et mouvement populaire se trouva relativement mise en défaut avec l'un des débats les plus importants dans la social-démocratie, celui de la grève de masses.
Il s'agissait d'une forme nouvelle, développé par le mouvement ouvrier belge, dans le cadre de la bataille pour le droit de vote, réservé à 44 000 personnes par la monarchie parlementaire née en 1830. Le Parti Ouvrier Belge en 1885 développa une ligne de masses aboutissant à de multiples grève politique de masse, en 1891, 1892, 1893, 1902 et 1913...
Comment comprendre historiquement que Karl Kautsky ait été la grande figure de la social-démocratie, mais soit devenu ensuite ce que Lénine appellera un renégat?
La source de ce mystère tient bien entendu à la matrice idéologique même de Karl Kautsky. Le problème essentiel de celui-ci est la séparation complète qu'il réalise entre le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. S'il reconnaît la dialectique dans la nature comme dans la société, il considère qu'il y a des modalités spécifiques, n'ayant pratiquement rien à voir...
Karl Kautsky œuvra à une critique approfondie de la position d'Eduard Bernstein, qui apparut comme un « révisionnisme ». Il ne s'agissait pas de rejeter le fait que le socialisme scientifique devait progresser, que certaines affirmations de Karl Marx et Friedrich Engels apparaîtraient comme insuffisantes ou erronées : les progrès de la science seraient ininterrompus et il y aurait forcément des améliorations.
Avant de voir quelle fut la position de Karl Kautsky quant aux thèses d'Eduard Bernstein, regardons comment celles-ci ont pu être comprises et soutenues.
En France, le théoricien syndicaliste-révolutionnaire Georges Sorel apprécia par exemple énormément cette dénonciation du marxisme. Voici ce qu'il écrit, dans une lettre au philosophe italien Benedetto Croce :
Eduard Bernstein était un intellectuel qui, avec Karl Kautsky, était le plus proche de Friedrich Engels, dont il fut même l'exécuteur testamentaire. Son positionnement fut cependant totalement différent de celui de Kautsky et il provoqua une bataille idéologique dans les rangs de la social-démocratie allemande.
Eduard Bernstein savait tout à fait ce qu'est le marxisme. Il était tout à fait conscient, de manière pertinente, qu'il ne contient pas simplement un aspect économique, mais bien une base philosophique. Dans Les présupposés du socialisme et les tâches de la social-démocratie, la première partie de l'ouvrage est consacré à présenter la conception marxiste, on y lit, de manière juste :
« La question de la justesse de la conception matérialiste de l'histoire est la question de la nécessité historique et de leurs causes. Être matérialiste cela signifie de fait de ramener tout événément aux mouvements nécessaires de la matière...
La Revue des Deux Mondes accorda en 1904 son attention au congrès social-démocrate d'Amsterdam. L'article de J. Bourdeau présente de manière très intéressante comment l'orthodoxie de la social-démocratie allemande avec Karl Kautsky posait un souci fondamental à la gauche française. En voici des extraits significatifs, où l'observateur amusé constate bien la différence totale d'approche.
De tous les Congrès socialistes internationaux, celui d’Amsterdam a provoqué en France le plus d’attention et soulevé le plus de polémiques.
C’est à peine si la presse anglaise en a fait mention. Les socialistes d’Amsterdam ont aussi peu excité la curiosité des Anglais, que s’il s’était agi d’une réunion cosmopolite de médecins ou de philosophes, bien que les socialistes se proposent non d’améliorer ou d’interpréter le monde, mais de le changer ; — c’est que les Anglais professent la plus parfaite indifférence pour les phrases et les théories. Les socialistes du continent sont d’habiles metteurs en scène, et ils savent organiser leurs représentations théâtrales...
Karl Kautsky était le défenseur du matérialisme historique, faisant tout pour populariser les thèses de Karl Marx et Friedrich Engels, reconnaissant entièrement que leur approche était scientifique et qu'il fallait se placer historiquement dans cette orientation. C'était le sens de son orthodoxie.
En 1887, Karl Kautsky publia ainsi un écrit sur les enseignements économiques de Karl Marx, qui sont à ses yeux la clef de voûte du marxisme et donc de la social-démocratie. A ses yeux, Le Capital compte comme une œuvre d'histoire et ce qui compte, c'est l'analyse objective de la réalité, en portant son attention sur le mode de production...
Karl Kautsky aborde de manière plus directe la question française dans La république et la social-démocratie en France, série d'articles publiée dans la Neue Zeit en 1904 et en 1905.
A l'arrière-plan, il y a l'opposition idéologique avec Jean Jaurès, qui a une conception de la république « au-delà » de la lutte des classes qui n'est pas considérée comme marxiste.
Tous deux ont d'ailleurs étudié la révolution française, Karl Kautsky publiant en 1899 Les antagonismes de classes à l'époque de la Révolution française. Jean Jaurès se positionnait à la base même contre Karl Kautsky et le marxisme...
Karl Kautsky représente l'approche orthodoxe du marxisme ; à l'opposé d'en France, la direction de la social-démocratie reconnaît le marxisme comme science.
La différence est fondamentale entre le socialisme de type français, éclectique, anti-idéologique, Jean Jaurès lui-même n'ayant jamais formulé de corpus théorique, et le marxisme défendu par la social-démocratie allemande...
Karl Kautsky est né à Prague le 16 octobre 1854. Sa famille appartient alors au milieu du théâtre ; sa mère est actrice et écrivain, son père peint dans les théâtres. Installée d'abord à Prague, ensuite à Vienne 1875, Karl Kautsky étudia à l'université de cette ville, jusqu'en 1878, dans les domaines de l'histoire, de la philosophie, de l'économie.
Influencé lors de ce parcours par un enseignant à la maison appartenant au hussitisme, il devint un démocrate radical, avant que la Commune de Paris ait un impact significatif sur lui, l'amenant au socialisme...
En France, quand on parle du marxisme, on se réfère aux œuvres de Karl Marx et on pense que le marxisme consiste précisément en ces œuvres. Ce point de vue est fondamentalement erroné et à lui s'associe une phrase de Karl Marx, mise hors contexte :
« Tout ce que je sais, moi, c’est que je ne suis pas marxiste. »
La réalité est toute autre. Historiquement, le marxisme n'a jamais consisté en les œuvres de Marx, mais en l'interprétation des œuvres de Karl Marx et Friedrich Engels effectuée par Karl Kautsky dans le cadre de la social-démocratie allemande...
Pourquoi le libéralisme fut-il en mesure de s'affranchir aussi aisément du mercantilisme ? L'exemple français est ici très pertinent.
En 1615, déjà, le protestant Antoine de Montchrestien (1575-1621) avait dans Traité d’économie politique fournit les principales thèses mercantilistes. L'impact historique s'effaça cependant, en raison du poids du catholicisme et de la féodalité.
Or, le poids du catholicisme et de la féodalité ne signifie rien d'autre que le capitalisme n'a pas encore pénétré les campagnes de manière suffisante...
Le mercantilisme anglais est, de fait, celui qui fut le plus authentique, car le plus poussé, au point de paver la voie à une véritable analyse économique capitaliste.
Les figures qui y participèrent furent très nombreuses et jouèrent un rôle historique de grande importance ; il est souvent parlé de mercantilisme « commercialiste » pour désigner leur approche.
On trouve ainsi Thomas Gresham (1519-1579), marchand et financier richissime, fondateur de la bourse du commerce de Londres, la Royal Exchange...
À l'opposé de l'esprit modernisateur de Jean-Baptiste Colbert, l'Espagne pratiqua une forme totalement décadente de mercantilisme. Si la France était une monarchie absolue, avec une base féodale et une superstructure en contradiction avec sa propre base, tel n'était pas le cas en Espagne, bastion du féodalisme et du catholicisme.
Le processus de conquête espagnol en Amérique se déroula, par conséquent, dans une optique d'esprit étroit, borné, féodal, ce qui aboutit au fétichisme complet pour l'or. C'est la fameuse figure du conquistador avec son obsession pour ce métal précieux...
Le mercantilisme se fonde sur le cadre national, théorisé en France par Jean Bodin ; dans la logique du mercantilisme, un pays ne peut s'enrichir qu'aux dépens d'un autre, le niveau des richesses ne se modifiant pas.
C'est là une vision bien entendu réductrice, dont la faiblesse réside dans la focalisation unilatérale sur l'argent, dans le cadre d'une évaluation de la balance commerciale. Il faut vendre plus que les autres, vendre plus cher, et ce moment-là le pays s'enrichit...
La préface de Jean Bodin pour Les Six Livres de la République a donné naissance au mercantilisme, parce que le mercantilisme est une réflexion sur la richesse des nations. Or, pour cela, il faut une nation.
C'est justement la monarchie absolue qui en France lui donne naissance.
Jean Bodin inaugure un discours qui est celui de ce qu'on appelle la politique, soit le débat sur la richesse nationale et ses modalités...
Pour comprendre la genèse du mercantilisme, il faut en France remonter au XVIe siècle. On sait que les guerres de religion ont secoué terriblement le pays alors, amenant la fraction dites des politiques à lancer une opération dont la réalisation sera l'arrivée au trône de Henri de Navarre, sous le nom de Henri IV.
L'Édit de Nantes ne fut qu'un aléas dans l'histoire du drame protestant, dans la mesure où les huguenots furent toujours plus les victimes de la monarchie absolue en formation. Toutefois et justement, la monarchie devenant absolue est née en profitant des guerres de religion pour former une faction au-dessus de la mêlée...
Il serait erroné de penser que, de manière logique, les commerçants et les marchands partent à la conquête du monde non capitaliste. En effet, lorsque les commerçants et marchands ont les mains libres, ils tentent de maintenir leur monopole, d'avoir une démarche agressive.
Karl Marx, dans Le Capital, constate ainsi :
« Là où le capital marchand domine, il représente, par conséquent partout, un système de pillage tout comme d'ailleurs son évolution chez les peuples commerçants des temps anciens et des nouveaux est directement liée au pillage par la violence, à la piraterie, au rapt d'esclaves, à la soumission (dans les colonies) ; ainsi à Carthage, à Rome, plus tard chez les Vénitiens, les Portugais, les Hollandais, etc. (…). »
Historiquement, la première forme de capital est le capital marchand. Il est porté par les commerçants et les marchands, qui ont accumulé suffisamment de travail pour disposer de suffisamment de moyens d'échanges et tentent de généraliser autour d'eux les échanges, en en tirant un bénéfice.
Les commerçants et les marchands apparaissent initialement comme des intermédiaires troquant, achetant des objets pour les revendre. Le capital accumulé alors sert à renforcer les achats et les ventes, afin d'élargir toujours plus les capacités du capital à s'approprier davantage de biens, afin des les vendre plus et plus cher...
Dans le Discours de la servitude volontaire, on trouve une grande réflexion sur les aides administratives et techniques dont dispose le tyran. Ce dernier profite du soutien d'une poignée de gens, qui sont au coeur de ce que nous devons désormais appeler l'appareil d’État.
Voici comme est présenté le « secret » de l'existence même de la domination du tyran : déjà, il ne s'agit pas du pouvoir armé...
Le Discours de la servitude volontaire dénonce les superstitions, tout le folklore utilisé par le puissants pour justifier leur parasitisme général. Redonnons un exemple parlant :
« Le premiers rois d’Égypte ne se montraient guère sans porter, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête : ils se masquaient ainsi et se transformaient en bateleurs.
Et pour cela pour inspirer, par ces formes étranges, respect et admiration à leurs sujets, qui, s’ils n’eussent pas été si stupide ou si avilis, n’auraient dû que s’en moquer et en rire. »
Nous avons donc une œuvre, le Discours de la servitude volontaire, qui dénonce non pas une forme générale de pouvoir comme la monarchie, mais bien spécifiquement la tyrannie. Il est parlé du pouvoir et ce sont des exemples historiques qui sont donnés, mais on peut très bien appliquer ce qui est expliqué à l’Église catholique et dénoncer le Pape, pour aboutir à une forme d'organisation comme celle des protestants.
Cet appel à rejeter la tyrannie s'appuie, par ailleurs, sur un principe d'autonomie individuelle propre au protestantisme et à l'humanisme...
Comme on le sait, la monarchie française s'est fondée en lien étroit avec la religion. C'est un processus qui prolonge les périodes romane et gothique.
Ainsi, la légende catholique veut que Clotilde la femme de Clovis, alla prier avec un ermite, dans la forêt de Cruye (désormais forêt de Marly), lorsqu'un ange apparut et lui demanda de remplacer les trois crapauds de l'écusson royal par trois fleurs de lys en or.
On retrouve par la suite la fleur de Lys à l'époque de la dynaste carolingienne (à la suite de Charlemagne), avant d'être officialisé en tant que tel par Louis VII le Jeune au XIIe siècle. Il semble bien cependant que le nombre de trois fleurs de lys fut décidé par Charles V le Sage au XIVe siècle, en référence à la « Sainte Trinité »...
On se souvient que Michel de Montaigne avait prétendu dans les Essais que le Discours de la servitude volontaire était une sorte d'écrit de jeunesse d'Etienne de La Boétie, qui serait sans prétention, juste un exercice de style ayant comme but de témoigner de la connaissance de l'histoire de la Grèce et de la Rome antiques.
C'est clairement un masque pour une tentative d'analyse du principe d'opinion publique. L'auteur du Discours fait exactement comme l'auteur des Essais : il propose, soupèse, fait des digressions… Il n'y aucune rupture entre le Discours et les Essais à ce niveau...
Dans le Discours de la servitude volontaire, on trouve cet appel pathétique :
« Chose vraiment surprenante (et pourtant si commune, qu’il faut plutôt en gémir que s’en étonner) ! c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel...»
Lorsque dans les Essais, Michel de Montaigne annonce que c'est Etienne de La Boétie qui a écrit le Discours de la servitude volontaire, il fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait. En feignant d'avoir voulu le publier, mais de ne plus le pouvoir, il attire l'attention de manière précise dessus.
En plaçant 29 poèmes à la place du Discours, il souligne bien l'importance de ce dernier, par son absence dont il est pourtant parlé, et qu'il faut même combler. En en parlant au sein d'un vaste discours philosophique sur l'amitié, il se couvre : s'il parle du Discours de la servitude volontaire, ce n'est qu'en référence à son ami… qui fut comme une partie de lui-même... Michel de Montaigne a de plus bien souligné par ailleurs qu'il a connu Etienne de La Boétie parce qu'il avait connu son Discours…
Le thème du Discours de la servitude volontaire d'Etienne de La Boétie est simple : le peuple accepte un régime en lequel il ne croit pas ou ne devrait plus croire, par la force de l'habitude. Nicolas Machiavel en Italie à la même époque avait raisonné au sujet de cette question de l'opinion publique, tout comme Kautilya en Inde au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, Machiavel et Kautilya s'adressaient au Roi, tout au moins le prétendaient-il.
Or, le Discours de la servitude volontaire parle du peuple, en espérant faire réagir les couches intellectualisées non liées au « tyran ». C'est précisément la position de Jean Calvin...
Influencé par le Discours merveilleux, La France-Turquie, c’est à dire, conseils et moyens tenus par les ennemis de la Couronne de France, pour réduire le Royaume en tel état que la tyrannie turquesque fut publié en 1575, en trois parties distinctes tout d'abord.
La première, Conseil du Chevalier Poncet, donné en presence de la Royne mere & du Conte de Retz, pour reduire la France en mesme estat que la Turque, consiste en la présentation des conseils donnés par un chevalier Poncet à Catherine de Médicis après avoir visité l'empire ottoman...
Aux côtés de François Hotman comme grande figure monarchomaque, on trouve Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), grand érudit protestant maîtrisant parfaitement le latin, mais également le grec, l'hébreu, l'allemand, ayant des connaissances larges en néerlandais, en anglais, ainsi qu'en italien.
Il sera ainsi un proche conseiller de Henri de Navarre, avant que celui-ci ne devienne Henri IV, cherchant à propulser celui-ci comme roi protestant maintenant une tolérance vaste pour les deux religions chrétiennes. La trahison de Henri IV l’amènera à gérer la situation inverse avec la négociation de l'Édit de Nantes, lui-même étant mis de côté par la suite, alors que s'intensifiait la vague monarchique anti-protestante...
Avec l'opposition entre protestantisme et catholicisme, la situation était explosive ; avec l'existence de la faction italienne au sein de la royauté, le besoin d'une rupture devenait complet pour les protestants.
La Francogallia eut donc un impact retentissant ; en pleine guerre civile, l'appel de François Hotman possédait un sens dépassant le simple cadre protestant. C'est toute l'option ultra du catholicisme et de la faction italienne de la royauté qui apparaissait comme précipitant le pays dans le chaos...
Le P«C»F est divisé en trois entités bien déterminées : la base, les cadres et les élus. Ces derniers ont conscience de la pression sur la survie de leur structure, la base vit dans une mythologie directement issue du révisionnisme.
Quant aux éléments intermédiaires, ils tanguent entre les deux, espérant en tout cas maintenir coûte que coûte la structure générale que les élus pourraient avoir tendance à dissoudre dans un regroupement plus vaste...
Le problème historique de la France est qu'elle a été influencée tant par l'humanisme et le protestantisme d'un côté, que par la Renaissance italienne et le baroque de l'autre. Or, cela est résolument contradictoire, de par les bases historiques de chaque mouvement, le premier étant progressiste, le second ancré dans le catholicisme, l'aristocratie, la réaction.
Pire encore, la nation française étant née à travers l'unification de ces deux pôles antagoniques, leur antagonisme est pour cette raison profondément masqué, inconnu, alors qu'il est justement à la source de profonds déséquilibres et fournit la base à maints événements historiques de notre pays...
Au XVIe siècle, tout un courant de pensée se développe sur la base du protestantisme (mais la dépassant largement) développant une conception politique qui sera, par la suite, qualifiée de monarchomaque, c'est-à-dire d'opposant à la monarchie.
Cette irruption d'une démarche politique était inévitable, pour deux raisons. Tout d'abord, il y avait l'affrontement entre le pouvoir royal et l'aristocratie, avec en arrière-plan la tendance à la formation de la monarchie absolue, pour centraliser et moderniser le pays...
L'année prochaine, tous les révolutionnaires authentiques du monde salueront la révolution d'octobre, la prise du pouvoir en Russie, il y a cent ans. Avec le grand Lénine à la tête des « bolcheviks » formant la majorité du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, les révolutionnaires ont été capables de renverser l’État réactionnaire et d'établir le socialisme.
Comme communistes suivant le chemin de 1917, nous voulons profiter de ce centième anniversaire à venir pour souligner un très impo..rtant aspect de la révolution d'Octobre : la question de la direction, c'est-à-dire l'importance de Lénine...
Ainsi, la France des années 30 a connu de nombreuses organisations d'extrême-droite, mais les historiens bourgeois ont toujours nié que celles-ci relevaient du fascisme. Ils ont en particulier cherché à nier la nature des Croix de Feu et du Parti Social Français.
Seuls deux historiens bourgeois se sont opposés à cette vision : Bernard-Henri Lévy et Zeev Sternhell, qui ont considéré qu'il y a eu toute une scène fasciste qui a fait office de laboratoire et est passé ensuite dans le camp du pétainisme...
Connaître l'histoire des Croix de Feu et du Parti Social Français est capital pour qui veut comprendre les mentalités et la politique dans notre pays. En effet, ces deux organisations, la seconde étant issue de la première, ont formé ce qui a été historiquement le parti politique français avec le plus d'adhérents, sur une base idéologique et culturelle représentant le fascisme français.
Là réside d'ailleurs une sorte de secret, que seul le matérialisme dialectique permet de percer : ce dossier est une arme politique, idéologique et culturelle très puissante...
Il est très difficile d'établir le panorama du P.S.F. pendant l'Occupation, tellement les contradictions de la situation le firent imploser. Tous les choix possibles ont été faits au P.S.F., avec toutes les nuances.
On a ainsi Bernard Dupérier, pilote de François de La Rocque, qui prendra lors de la Résistance le commandement de l'escadre aérienne de chasse française en Grande-Bretagne, ou encore le député Edmond Barrachin qui rejoint Londres, tandis que le député Jacques Bounin organisa la Résistance à l'intérieur du pays.
Mais on retrouve aussi Paul Touvier, figure même du milicien, Paul Creyssel qui fut un temps secrétaire général à la propagande du régime de Vichy...
La défaite face à l'Allemagne nazie fut un coup terrible à la stratégie de François de La Rocque, entièrement fondée sur l'indépendance française complète, avec un partenariat proposable uniquement à l'Espagne franquiste et l'Italie fasciste, une opposition franche à l'Allemagne.
Bien entendu, une prise de contact eut lieu ; en septembre 1936, un représentant du P.S.F. alla en Allemagne discuter avec Rudolf Hess, en présence d'un consul espagnol anti-républicain et du fasciste anglais Oswald Mosley. En décembre de la même année, François de La Rocque se rend à Bruxelles, afin de rencontrer Léon Degrelle, le dirigeant belge du mouvement rexiste, ainsi que le banquier allemand Dessler...
A l'opposé des ligues espérant le coup d’État, François de La Rocque comptait phagocyter la République. La question électorale se posa alors inévitablement. Ce n'était pas du tout dans la démarche des ligues, ce qui souligne sa spécificité.
Cela ne veut pas dire que la prise du pouvoir soit conçue comme un simple processus électoral. Le P.S.F. ne se cachait pas sur ce plan, expliquant :
« Pour réaliser son programme, le Parti Social Français réclame LE POUVOIR...
L'anarchisme est une théorie du XIXe siècle, né sur le terrain de la petite propriété et faisant de l'individu la figure historique de notre époque, tout comme le libéralisme.
Au sein de la première Internationale, le marxisme a réussi à vaincre l'anarchisme, dont les figures les plus connues étaient alors Pierre-Joseph Proudhon et le russe Mikhaïl Bakounine...
L'opposition droite-gauche en France est issue, du point de vue du matérialisme dialectique, de l'affrontement entre deux fractions de la bourgeoisie : celle ouvertement réactionnaire, lié au royalisme et au catholicisme, et celle moderniste et laïque. Cette opposition est directement issue du compromis du tout début du XXe siècle. Le Parti Communiste n'a pas réussi à saisir cet arrière-plan, ne saisissant pas les contradictions au sein de la bourgeoisie.
Il n'a donc pas compris le radicalisme, cette forme de républicanisme de centre-gauche, expression de la bourgeoisie modernisatrice, partisane d'un capitalisme libéral et, de ce fait, opposé aux fractions de la bourgeoisie historiquement liées au féodalisme, au catholicisme, au monarchisme, etc...
Si le Parti Communiste a été amené aussi aisément dans les bras du jauressisme, ce n'est pas seulement pour des raisons d'incompréhension du matérialisme dialectique. François de La Rocque est, en fait, peut-être le seul en France à avoir compris ce qu'est le léninisme, et il était contre. Sa dynamique vise clairement, comme le national-socialisme allemand, à siphonner le développement d'un Parti Communiste s'établissant dans l'Histoire de son pays, impulsant des positionnements idéologiques et culturels révolutionnaire.
François de La Rocque a compris qu'il s'agissait d'une guerre de positions et le Parti Communiste s'est aperçu qu'il était en retard dans ce processus. C'est la raison pour laquelle il s'est précipité aussi facilement dans le républicanisme, tentant de lancer un mouvement Croix de Feu inversé...
A la mi-septembre 1937, la police mène une opération contre des dépôts d'armes dans tout le pays, mettant la main sur des centaines de fusils-mitrailleurs, des dizaines de mitrailleuses, ainsi que 10 000 grenades de provenance italienne et allemande. Fin janvier 1938, un de ces dépôts saute accidentellement, tuant 14 personnes ; il cachait 6 000 grenades et 200 kilos d'explosifs.
Telle était l'atmosphère lourdement pesante où l'extrême-droite s'organisait et s'armait. Dans ce cadre, le Parti Communiste, par l'intermédiaire de L'Humanité a très régulièrement parlé de François de La Rocque, des Croix de Feu et du P.S.F., tout à fait conscient de son importance dans le dispositif d'extrême-droite...
La position de François de La Rocque devint de plus en plus antagonique avec l'extrême-droite traditionnelle qui, fin 1937, met en place le plan d'un coup d’État. Le gouvernement devait avoir à sa tête le maréchal Franchet d'Esperey, le maréchal Weygand ayant refusé, le maréchal Pétain ayant « réservé son avenir » même si son chef de cabinet, le commandant Loustanau-Lacau, assurait la liaison entre les putschistes. Philippe Pétain considérait que le Front populaire s'effondrerait de lui-même et qu'il pourrait alors prendre les commandes des institutions.
François de La Rocque, comme en 1934, refusa de participer en mettant ses troupes à la disposition du coup d’État...
La ligne du P.S.F. est ainsi orientée vers les masses, car il s'agit, ce que les autres organisations de l'extrême-droite n'avaient pas compris, de faire nombre, comme le dit l'article « Le nombre » :
« En face des partis marxistes, il n'y a qu'un parti de masse : le P.S.F. Cela n'est plus contesté par personne. Et pourtant, cette constatation a le droit d'irriter certains qui, pour marquer leur dépit, répètent que le nombre n'est rien.
Or, il en est du nombre comme de la force. C'est une chose odieuse et méprisable, si elle est au service du mal – mais combien précieuse lorsqu'un noble idéal peut s'appuyer sur elle. »...
Pour rendre crédible la théorie de la profession organisée, François de La Rocque mit en place de vastes campagnes se voulant sociales, visant à contribuer à l'apolitisme d'orientation nationaliste, afin de produire une atmosphère rendant crédible sa proposition corporatiste. Il résumera sa stratégie ainsi, en juin 1936 dans une note aux chefs de sections :
« Qu’il s’agisse de l’ascension de nos idées vers le pouvoir, de la pénétration des milieux ouvriers et paysans ou, dans un champ d’action moins élevé, de la période électorale, cette action sociale est la condition sine qua non de nos succès. »...
Les Croix de Feu étaient nés comme structure d'anciens combattants, mais le glissement vers une ligne ouverte à tous avait donc été impulsée par François de La Rocque. En 1935, on lit d'ailleurs dans le Programme du Mouvement Social Français des Croix-de-Feu que :
« Nous ne pratiquerons jamais la religion de l’État, mais nous voulons un État tuteur, un État qui serve, contrôle, sanctionne.
Le Mouvement Croix-de-Feu est aussi loin de la conception totalitaire, à la mode italienne, allemande, où l’enfant dès sa naissance est voué à l’État, que de la conception marxiste où l’individu devient un numéro anonyme, écrasé sous la tyrannie collective d’une poignée de dictateurs. L’épithète fasciste convient à d’autres. Pas à nous. »...
Il faut bien être conscient que si le principe de « profession organisée » est une aberration technocratique, un corporatisme relevant du fascisme, ce principe sert avant tout une mystique que François de La Rocque a réussi à développer puissamment en profitant du fait que les ligues ont dû cesser d'exister. Le processus a été accompagné d'une de maître, avec une grande finesse politique.
Depuis 1935, les Croix de Feu s'appuient sur un Mouvement Social Français des Croix-de-Feu, avec une base idéologique ayant largement quitté l'approche unilatérale du nationalisme du type « anciens combattants ». Le 22 juin 1936, François de La Rocque faisait passer une circulaire indiquant aux adhérents qu'ils doivent rester en contact avec leur chef de « dizaine », expliquant le 24 juin dans une communication interne : « Le gouvernement… a prononcé dans l'arbitraire un nouveau décret de dissolution des Croix de Feu et des Volontaires Nationaux. Nous nous y attendions… Nous créons le « Parti Social Français ». »
Dans son ouvrage publié en 1934, Service public, François de La Rocque formulait sa théorie corporatiste sous le nom de « profession organisée ». Cela donnait la définition suivante, tout à fait contradictoire par ailleurs :
« Organiser la profession, explique-t-il ailleurs, c’est, dans le plan local, régional, national, réunir entre elles les différentes catégories de travailleurs, depuis l’ouvrier manuel jusqu’au patron, pour une même branche de production...»
Quelle est la différence entre les Croix de Feu et le Parti Social Français? Elle est très simple à comprendre.
Les Croix de Feu étaient une structure anti-marxiste : le P.S.F. se voulait la structure anti-marxiste par excellence. Toute sa forme tendait à ce but.
En janvier 1938, il devint une « union interfédérale », avec chaque fédération existant de manière officiellement autonome. Le comité exécutif, de son côté, se centralisait davantage, se réunissant quatre fois par ans seulement, alors qu'une commission administrative permanente s'occupait des activités au jour le jour...
Historiquement, le Front populaire a procédé à la dissolution des ligues. Les Croix de Feu devinrent le Parti Social Français, les autres ligues tentant de former des partis, sans grand succès, et en tout cas sans aucun rapport avec l'expansion numérique gigantesque du Parti Social Français.
Les historiens bourgeois se fondent dessus pour nier l'existence d'un fascisme français, en disant que le Parti Social Français – historiquement le parti qui en France a eu le plus d'adhérents – était un parti de droite dure, ayant même été finalement un obstacle à l'extrême-droite. François de La Rocque aurait fait basculer la ligue des Croix de Feu vers les institutions. En faisant cela, il aurait empêché le fascisme d'avoir une base populaire...
Le Parti Communiste français n'avait pas compris le caractère spécifique des Croix de Feu et du P.S.F., les assimilant avec François de La Rocque à l'extrême-droite ayant existé jusque-là sous la forme de groupes de pression nationalistes, favorables à un coup d’État. Il le paiera cher, car la conséquence sera l'incompréhension du gaullisme, qui est dans la continuité directe de la position de François de La Rocque.
Pourtant, les événements de 1934 auraient dû l'amener à comprendre cela. On sait que le 6 février 1934 a été un événement capital de l'Histoire de notre pays, avec plusieurs dizaines de milliers de manifestants des « ligues » d'extrême-droite tentant de marcher en direction du parlement, pour le prendre d'assaut...
En pratique, les Croix de Feu, aidés des Volontaires Nationaux qui étaient une structure de soutien, étaient une organisation de guerre civile. Les structures fonctionnaient de manière autonome, mais avec en leur sein une hiérarchie très stricte, avec des responsabilités paramilitaires et militaires bien définies.
Cinq adhérents, de la même maison, de la même rue, habitant près les uns des autres, formaient une « main ». Deux « mains » formaient une dizaine, trois dizaines une « trentaine », qui elle-même était associée à deux autres trentaines, pour former une « centaine ». Les centaines étaient reliées par « secteur »...
Dans l'optique d'un refus de l'opposition droite contre gauche et dans l'idée d'une renaissance-réconciliation, les Croix de Feu fondaient leur activité publique sur la mobilisation. Il ne s'agissait pas, comme l'extrême-droite liée au royalisme, de passer par la violence pour mener des coups d'éclat.
Il s'agit de diffuser un état d'esprit, une mentalité, ce qui correspond absolument aux démarches des S.A allemands et des chemises noires italiennes...
François de La Rocque se pose donc en sauveur de la Nation, qu'il veut refonder, en procédant à la réconciliation de la population et en purifiant l'administration. En cela, sa position peut se conjuguer aux Croix de Feu, qui ont également des attentes de réorganisation nationale, de valorisation du patriotisme complet, de rétablissement des valeurs traditionnelles, etc.
Cette dynamique est puissante et elle n'a pas besoin, par conséquent de s'inspirer d'autres tentatives du même genre ou différentes effectuées ailleurs. François de La Rocque rejette donc le fascisme, ce dernier étant considéré comme correspondant uniquement au modèle italien...
Que veut François de La Rocque, que compte-t-il faire des Croix de Feu ? En fait, tout comme avec les dirigeants nationalistes de l'époque, il n'a pas d'idéologie bien définie. Il agit, parce qu'il considère qu'il doit le faire, pour le bien de la Nation. Il transporte quelque chose qui est inhérent à la Nation, qui est nécessaire. C'est pourquoi il a pu affirmer que : « Le but est l'existence nationale. Un régime est un moyen. »
Et, de par sa base idéologique et culturelle, François de La Rocque a une certitude : s'il y a des problèmes sociaux, il est possible de les résoudre en se fondant sur une approche chrétienne et nationale, car les deux sont liés...
Maurice d'Hartoy n'était pas un idéologue, mais un sentimental nationaliste pétri de romantisme. Mais l'idéalisme s'effondre nécessairement dans la vie quotidienne la plus misérable.
En pratique, François Coty avait une liaison avec une secrétaire, dont il eut pas moins de quatre enfants. Celle-ci eut également une liaison avec Maurice d'Hartoy, qu'elle rejoindra par ailleurs à la mort de François Coty, qui finira par revenir en fait avec sa femme. Entre-temps, François Coty propose un marché à Maurice d'Hartoy, l'éloignant avec sa femme pendant une année au moins, par contrat, secret, lui finançant des voyages à l'étranger sous prétexte d'articles...
Avec cet arrière-plan, on ne s'étonnera guère que François de La Rocque se soit rapproché des Croix de Feu, initialement un mouvement d'anciens combattants d'orientation nationaliste.
Tout part de Maurice-Lucien Hanot, dit lieutenant d'Hartoy, au moment où il se rapproche de Joseph Marie François Spoturno dit François Coty, qui est alors un des hommes les plus riches du monde grâce à son industrie de parfum...
En novembre 1925, le ministre de l'intérieur Camille Chautemps fit procéder à des perquisitions : sont visés les sièges de l'extrême-droite, plus précisément de l'Action française, des Jeunesses Patriotes, de la Ligue des chefs de section (une organisation nationaliste d'anciens combattants), du Faisceau.
La raison en était que les quelques maréchaux qu'avaient alors la France travaillaient sur l'hypothèse d'un coup de force, provoquant une certaine panique au gouvernement du Cartel des gauches. Au cœur de cette logique putschiste, on a Hubert Lyautey...
Pour être en mesure de comprendre ce qu'ont été les Croix de Feu et le Parti Social Français, il faut saisir tout l'arrière-plan idéologique et culturel qui lui a donné naissance.
A ce titre, François de La Rocque, dit de Séverac, théoricien et dirigeant des Croix de Feu et du Parti Social Français, est en soi un caractère-type. Fils de général, il se marie à Édith Marie-Louise Allotte de la Füye, elle-même fille de général. C'est à l'origine un aristocrate, fervent chrétien, abonné à l'Action française, dont l'esprit est celui même de l'élite de l'Armée française...
Un nombre important de groupes français furent influencés par la gauche « germano-hollandaise » et la « gauche italienne ». Tous se situaient dans la mouvance syndicaliste-révolutionnaire et d'ultra-gauche, prônant une ligne de refus complet de réformisme au moyen d'une propagande unilatétale pour la révolution.
Cette révolution devait être anti-parti, par définition, le bureaucratisme étant considéré comme le second pilier du « système » avec le capitalisme...
Le KAPD a été le centre historique de la « gauche germano-hollandaise », avec un important centre intellectuel aux Pays-Bas. L'Italie, la Belgique et la France ont été par contre les pays touchés par la « gauche italienne ».
Initialement, la gauche italienne s'appuie sur la position d'Amadeo Bordiga, qui sera l'opposant historique à Antonio Gramsci dans la bataille pour la direction du Parti Communiste d'Italie...
Anton Pannekoek, avec sa critique du Parti social-démocrate, ne pouvait que revenir à l'anarchisme né justement de l'opposition à un tel parti. Par conséquent, Anton Pannekoek va faire toute une théorie comme quoi le principe de parti n'est là que pour permettre à une couche sociale composée d'intellectuels de former une bureaucratie dirigeante.
Cette théorie sort totalement de l'analyse matérialiste des classes, pour rejoindre la théorie anarchiste sur l'État.
On l'aura compris, Anton Pannekoek dénonce au fond le Parti dirigeant tel que la social-démocratie l'a théorisé. Voici comment il voit les choses :
« La social-démocratie a toujours vu dans le parti (lié aux syndicats) l'organe servant à mener la révolution à bonne fin.
Ceci ne veut pas dire forcément l'emploi exclusif des méthodes électorales; pour sa fraction radicale, le parti devait utiliser la pression conjointe des moyens parlementaires et de moyens extra-parlementaires tels que les grèves et les manifestations, afin de faire valoir la puissance du prolétariat...»
Si Otto Rühle représente la principale figure du gauchisme dans sa variante largement ouverte au syndicalisme-révolutionnaire, au point de n'en être ouvertement qu'une variante, le hollandais Anton Pannekoek (1873-1960) est quant à lui la figure du « communisme des conseils » rejetant le syndicat.
Issu de la haute bourgeoisie, Anton Pannekoek mena une carrière institutionnelle d'astronome, devenant professeur à l'université d'Amsterdam en 1932 et la même année membre de l'Académie néerlandaise des sciences...
L'un des courants relativement exemplaire du volontarisme gauchiste – avec toute l'apologie d'une énergie vitaliste se précipitant dans une sorte de recette-miracle comme « clef » de la révolution – fut ce qui sera par la suite appelé le « national-bolchevisme ».
Ce courant n'a rien rien à voir avec les courants de droite qui utilisent la démagogie sociale ; le national-bolchevisme initial est une tentative gauchiste de profiter d'une situation particulière pour faire avancer la révolution...
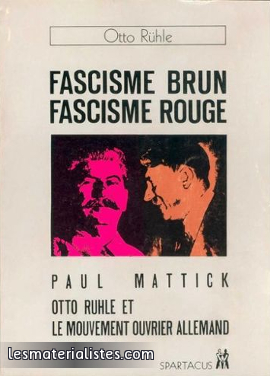 Otto Rühle n'est pas original dans son propos, dans la mesure où il prolonge sa critique du Parti de type social-démocrate. Ce dernier s'étant développé en le parti de type léniniste, Otto Rühle ne fait que continuer sa critique, en l'adaptant à la nouvelle forme. En arrière-plan, c'est la notion même de parti social-démocrate qui est remis en cause, le léninisme étant sa forme la plus développée.
Otto Rühle n'est pas original dans son propos, dans la mesure où il prolonge sa critique du Parti de type social-démocrate. Ce dernier s'étant développé en le parti de type léniniste, Otto Rühle ne fait que continuer sa critique, en l'adaptant à la nouvelle forme. En arrière-plan, c'est la notion même de parti social-démocrate qui est remis en cause, le léninisme étant sa forme la plus développée.
Pour nous, le communisme doit véritablement comprendre le sens de la contradiction villes-campagnes. Le marxisme contenait la base scientifique pour saisir cela, mais pour en saisir la dimension réelle, il a fallu attendre le léninisme et l'URSS – notamment avec le concept de biosphère –, ainsi que le maoïsme et la Chine populaire – avec le principe des communes populaires et de l'univers en oignon.
En ce début du XXIe siècle, alors que le crise générale du capitalisme est si grande, impossible de ne pas voir cet aspect...
L'une des principales figures du gauchisme allemand fut Otto Rühle. Professeur membre de la social-démocratie, il fut élu au parlement en 1912 et fit partie des 15 parlementaires sociaux-démocrates sur 111 qui le 3 août 1914 refusèrent de voter pour les crédits de guerre.
Il participa ensuite à une importante réunion de la gauche, en mars 1915, dans l'appartement de Wilhelm Pieck, qui sera par la suite dirigeant du KPD (Parti Communiste d'Allemagne), avec Liebknecht, Mehring et neuf autres personnes, qui fondèrent la revue Die Internationale, qui n'aura qu'un numéro mais donnera naissance au Gruppe Internationale, qui deviendra le Spartakusgruppe et donnera naissance au KPD...
L'élan de la révolution allemande fut très profond et, malgré la mort de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, le Parti Communiste d'Allemagne (KPD) se construisit de manière très rapide.
Toutefois, il y avait deux axes possibles qui en découlaient. Soit il fallait se tourner vers tout un ensemble de structures dispersées liées directement à la perspective de l'insurrection, dans l'idée d'aller le plus rapidement possible, en mettant l'idéologie et l'organisation de côté...
Le gauchisme n'est pas sorti de nulle part ; il n'est nullement une tendance radicale spontanée qui serait le fruit d'une vague révolutionnaire, comme les gauchistes le prétendent pourtant. Il est issu des courants défaits par la social-démocratie et renouvelant leurs formes.
Il suffit de voir ainsi quelle était la situation aux Pays-Bas, pays où le gauchisme en tant que courant organisé fut particulièrement fort. Il est d'ailleurs parlé, chez les gauchistes, de la « gauche germano-hollandaise » et de la « gauche italienne »...
Historiquement, la social-démocratie a été le mouvement ouvrier s'appuyant sur un Parti de cadres autour d'une idéologie bien précise : le socialisme scientifique.
Ce Parti dirige les luttes de classe, dans l'intégralité du processus ; la spontanéité est rejetée. Cette forme de Parti a été accepté par Lénine, lui-même un social-démocrate initialement ; dans Que faire?, il souligne son accord avec Karl Kautsky sur ce point.
Ce qu'on appelle le gauchisme est la réfutation de ce type de Parti...
On a appris hier le décès de l'historien bourgeois allemand Ernst Nolte, une figure très célèbre pour son interprétation du national-socialisme. Ernst Nolte a, en effet, provoqué une polémique importante en affirmant que le national-socialisme n'était qu'une simple réaction au communisme.
Selon lui :
« Ce qu’il y a dans le national-socialisme de plus essentiel, c’est son rapport au marxisme, au communisme particulièrement, dans la forme qu’il a prise grâce à la victoire des bolcheviks. »
(La Guerre civile européenne)
L'empirio-criticisme est ainsi un mélange d'idéalisme et de matérialisme, il est d'autant plus difficile à saisir que bien entendu ce mélange est particulièrement confus, tentant de masquer sa propre nature finalement idéaliste par des positions qui ont l'air matérialiste.
Lénine note de ce fait : « Eduard von Hartmann, idéaliste conséquent et réactionnaire conséquent en philosophie, qui voit d'un œil bienveillant la lutte des disciples de Mach contre le matérialisme, se rapproche beaucoup de la vérité en disant que la philosophie de Mach représente « un mélange confus (Nichtunterscheidung [sans distinction concrète]) de réalisme naïf et d'illusionnisme absolu »...
Une fois qu'il a posé le cadre, Lénine part à l'assaut. Pour cela, il explique la position philosophique du physicien et philosophe autrichien Ernst Mach (1838-1916) et de son successeur le philosophe allemand Richard Avenarius (1843-1896).
En pratique, les thèses d'Enrst Mach et de Richard Avenarius sont extrêmement proches de celles de Henri Bergson en France, une vingtaine-trentaine d'années plus tard. Ernst Mach dit ainsi que « Ce ne sont pas les choses (les corps), mais bien les couleurs, les sons, les pressions, les espaces, les durées (ce que nous appelons d'habitude des sensations) qui sont les véritables éléments du monde » : on a la même approche psychologique, orientant tout le savoir vers ce qui serait une vie intérieure propre à chacun...
Nous voulons conserver une solide fidélité à la bannière de Marx – Engels – Lénine – Staline et réaliser de manière conséquente les conseils du grand Staline sur la nécessité d'assurer l'amitié entre les peuples. (Applaudissements tempétueux)
En Allemagne de l'est, après la libération par l'armée soviétique, ont été tirées les leçons de la catastrophe où le fascisme hitlérien avait amené l'Allemagne. Les forces démocratiques et amoureuses de la paix ont mené une politique de paix, de reconstruction de l'économie pacifique et d'amitié entre les peuples...
Lénine, dans Matérialisme et empirio-criticisme, fait référence à Denis Diderot, qu'il présente comme résumant la thèse matérialiste. Voici ce que dit Lénine, dans un long passage consistant surtout en des citations :
« Quant aux matérialistes, le maître des encyclopédistes, Diderot, dit de Berkeley : « On appelle idéalistes ces philosophes qui, n'ayant conscience que de leur existence et des sensations qui se succèdent au‑dedans d'eux‑mêmes, n'admettent pas autre chose : système extravagant qui ne pouvait, ce me semble, devoir sa naissance qu'à des aveugles ; système qui, à la honte de l'esprit humain et de la philosophie, est le plus difficile à combattre, quoique le plus absurde de tous. »...
Lénine écrit au début du XXe siècle en Russie, dans un pays où la monarchie absolue tente de développer le pays, soutenant le capitalisme, alors que la féodalité est encore massive, portée par une aristocratie profondément réactionnaire. La religion, le christianisme orthodoxe, est ici la clef de voûte du dispositif idéologique.
Le matérialisme et le marxisme ont alors eu une influence notable sur les couches éclairées et surtout sur la classe ouvrière, au point que les représentants intellectuels des couches dominantes devaient y faire face...
Matérialisme et empiriocriticisme est une d'une importance capitale dans l'histoire du matérialisme dialectique. Lorsque Lénine l'écrit en 1908 – il sera publié en 1909 – il ne fait en apparence que défendre les enseignements de Karl Marx et Friedrich Engels dans le cadre du développement des sciences à l'époque.
En pratique pourtant, il approfondit de manière essentielle la connaissance du matérialisme dialectique, en le replaçant au centre de préoccupations des révolutionnaires représentant la classe ouvrière. Sous l'impulsion de Karl Kautsky en effet, les partisans du marxisme tendaient toujours plus à se focaliser sur le matérialisme historique, mettant de côté ou effaçant la signification scientifique complète des enseignements de Karl Marx et Friedrich Engels...
La ligne du PCI, depuis que le régime a vacillé avec le « coup » contre Benito Mussolini et l'intervention militaire des Alliés en Italie même, est très claire : il faut unifier les masses pour chasser l'envahisseur allemand.
Les Instructions pour tous les camarades et pour toutes les formations du parti, écrites par Palmiro Togliatti en 1944, affirment les points suivants :
1) ligne générale du Parti pour le moment présent : Insurrection nationale du peuple dans toutes les régions occupées pour la libération du pays et l’écrasement des envahisseurs allemands et des traîtres fascistes...
Le paradoxe du gouvernement de Pietro Badoglio, c'est que lorsque l'armistice fut organisé avec les alliés et déclaré le 8 septembre au soir, il dut fuir Rome, ce qui fut également le cas pour le Roi. Le commandement militaire lui-même s'enfuit en pleine panique, sans prévenir aucun ministre, abandonnant des documents secrets, le sceau de l'état-major, etc.
C'est ce qui fut appelé la défense manquée de Rome, et cela alors que 80 000 soldats italiens étaient présents en périphérie. Le 9 septembre, dans la matinée, l'Armée allemande a déjà le contrôle de la capitale italienne...
Au sens strict, le fascisme est un modernisme poussé par la partie nord de l'Italie, industrialisée et ayant accepté un compromis avec le féodalisme du sud. Le respect de la royauté a fait partie de ce compromis.
Giovanni Gentile a été l'artisan de ce compromis, notamment avec une réforme de l'école. Désireux de mettre en avant la « morale », il avait fait en sorte que dans les « gymnases », c'est-à-dire les lycées, 70 % des cours relèvent des sciences humaines (italien, latin, grec, histoire, philosophie), comprises comme des « méthodes », des « règles », le par cœur étant la principale démarche...
1943 est l'année de l'effondrement interne du fascisme italien. Rien qu'en mars ont lieu des grèves en masse, à Turin tout d'abord, puis Milan, Venise afin de se diffuser, pour toucher 100 000 ouvriers protestant contre leurs conditions de vie et exigeant la paix. Les centaines d'arrestations ne suffisent pas à ébrécher un mouvement témoignant d'une véritable relance de la lutte de classe ; elles nuisent par contre grandement aux réseaux communistes.
Toutefois, les impérialistes connaissent également la situation et ils ont intégré ce fait. En juillet 1943, le 10, les Alliés organisent un débarquement en Sicile, ayant pris au préalable de nombreux contacts avec la mafia italienne pour aider à assurer une transition. L'Armée fasciste ne fait pas le poids avec ses 18 divisions mal équipées, ainsi que 8 autres en garnisons dans les îles, alors que 34 autres sont actives en France, en Grèce et dans les Balkans...
Le fascisme épuise sa crédibilité alors que la crise sociale s'approfondit et que la guerre impérialiste devient la seule orientation véritable du régime. Le PCI a quant à lui décider de lutter pour conquérir les masses ; en comprenant qu'il doit lutter y compris au sein de syndicats ou de la jeunesse fascistes, il a compris que le radicalisme verbal bordiguiste était une faille. Il assume le travail de fond et dans ce cadre, le PCI assume ainsi enfin la ligne du Front populaire, ce qui est d'autant plus facile que l'Italie fasciste s'allie totalement à l'Allemagne nazie...
L'Italie ayant émergé sur le tard comme puissance impérialiste, le « partage du monde » était déjà en grande partie réalisé et le pays eut un rôle colonial mineur comparé à l'Angleterre ou la France, se contentant des zones secondaires. La toute première colonie italienne fut établie en Érythrée par l'armateur Rubattino en 1882 ; dix ans tard, au terme d'une rude concurrence avec les britanniques, s'ajouta la Somalie voisine.
Une option disponible pour les Italiens était également de se confronter aux forces coloniales déjà existantes pour leur arracher des territoires. Ce fut le cas de la guerre de 1911 contre l'Empire Ottoman, l'Italie de Giolitti arrachant la Tripolitaine, la Cyrénaïque ainsi que le Dodécanèse grec...
L'annonce de la fin de la guerre d'Afrique a été saluée par vous avec joie, car dans vos coeurs s'est allumée l'espérance de voir finalement s'améliorer vos pénibles conditions de vie.
On nous a répeté que les sacrifices de la guerre étaient nécessaires pour assurer le bien-être au peuple italien, pour garantir le pain et le travail à tous nos ouvriers, pour réaliser - comme disait Mussolini - "la plus haute des justices sociales, qui, depuis la nuit des temps, est le plus grand désir des masses en lutte âpre et quotidienne avec les necessités de la vie les plus élémentaires", pour donner des terres à nos paysans, pour créer les conditions de la paix...
La mort d'Antonio Gramsci, le 27 avril 1937, apparaît comme le moment qui clôt toute une période. Antonio Gramsci, qui était bossu, avait une santé très faible en général et la détention a fait des dernières années de sa vie un enfer, alors qu'il souffrait de dépression cardiaque, de tuberculose pulmonaire, d'arthrite, d'hypertension, d'une hernie ombilicale, d'une pyorrhée alvéolaire qui lui a fait perdre plusieurs dents.
Les conditions infectes de son emprisonnement étaient supervisées directement par Benito Mussolini ; il s'agissait d'empêcher que le PCI puisse profiter, de quelque manière que ce soit, de son dirigeant emprisonné...
Qu'est-ce que la société italienne fasciste ? Est-elle un « totalitarisme » ? En fait, la société italienne reste une société où les valeurs libérales prédominent au plan individuel ; le fascisme se veut même le meilleur porteur du libéralisme.
Cependant, selon l'idéologie fasciste, seul l’État est le garant des droits individuels. C'est ici qu'on retrouve la philosophie de Giovanni Gentile, le maître d'oeuvre idéologique du régime. Selon Giovanni Gentile, la philosophie de la praxis est conforme à la réalité : ce n'est qu'en s'actualisant dans la pratique que la conscience est réalité...
Du 14 au 21 avril 1931 a lieu le 4e congrès du PCI, à Cologne en Allemagne. On y retrouve 35 ouvriers, 3 artisans, 2 ouvriers agricoles, 2 paysans, 7 employés, 2 étudiants et 5 intellectuels. Un ouvrage de 1952, retraçant les 30 années de lutte du PCI, raconte à ce sujet :
« Les travaux étaient entourés par le calme de la forêt tandis que les équipes de surveillance du parti communiste allemand étaient nuit et jour en alerte. Non seulement l’organisation logistique fut admirable mais également la protection... »
A quoi ressemble le régime fasciste une fois qu'il a placé dans l'illégalité toute l'opposition et considérablement affaibli le PCI ?
L'une des choses les plus importantes qu'il réalise, dans le cadre italien, est un accord avec le Vatican, signé le 11 février 1929. Ces « accords de Latran » – du nom du palais du Latran, la résidence du pape – donnent naissance à l’État du Vatican, formellement indépendant, et fait de l’Église catholique, apostolique et romaine la tenante de la religion officielle de l'Italie...
L'un des grands soucis posés par le fascisme italien est l'émigration des progressistes. Celle-ci touche 44 782 personnes en 1921, 100 000 en 1922, 167 000 en 1923, 201 000 en 1924, 45 528 en 1925, 111 252 en 1926.
Comment lutter contre le fascisme si les plus progressistes s'en vont, abandonnant le terrain ? Le PCI, lui, décide de rester fermement sur le terrain de la lutte de classes en Italie ; seule une centaine de cadres émigre pour des conditions de sécurité. Pratiquement 6 500 militants combattent de pied ferme, dans 47 organisations provinciales (23 provinces n'ayant pas de structure unifiée), affrontant une terrible répression les ciblant de manière prioritaire : 3000 communistes passent par la prison...
Toutefois, le fascisme ne compte pas ne pas profiter de sa situation de force, notamment après l'affaire Zaniboni. Le responsable du Parti Socialiste Unitaire, Tito Zaniboni, aidé du général fasciste mais franc-maçon Luigi Capello, tenta en effet de tuer Mussolini, le 4 novembre 1925.
L'opération échoua, mais tendit encore plus la situation ; le régime exigea que la presse soutienne désormais le régime, forçant la presse contestataire à capituler. En septembre 1925, la Stampa fut suspendue pour un mois, par la suite son responsable Luigi Salvatorelli fut obligé de quitter sa direction...
Le grand problème posé par le fascisme au gouvernement est de savoir comment l'en sortir. Le PCI considère que pour l'extirper, il faut nécessairement changer de régime. Le PSI, basculant toujours plus à droite, pense qu'il est possible justement de s'appuyer sur le régime pour le chasser.
Il y a toutefois pire comme problématique : personne ne pense que le fascisme puisse se maintenir. Tout le monde pense que Benito Mussolini pousse dans la brutalité des chemises noires justement afin de parvenir à un compromis et de s'institutionnaliser...
1923 a été un tournant pour le Parti Communiste d'Italie : il y a d'un côté la répression légale qui nuit, la répression para-légale qui tue, la question de la direction qui est posée avec Antonio Gramsci remplaçant Amadeo Bordiga.
Au final de la réorganisation, le PCI a 8619 activistes, principalement basés en Italie du Nord. Ils sont 1244 dans le Piémont, 350 en Ligurie, 1260 en Lombardie, 818 en Veneto, 866 en Vénétie Julienne, 1385 en Emilie-Romagne, 989 en Toscane, 280 dans les Marches, 123 en Ombrie, 585 dans le Latium, 150 dans les Abruzzes Molise, 394 en Campanie, 340 dans les Pouilles, 378 en Calabre, 338 en Sicile, 119 en Sardaigne.
Il est clair que le fascisme présente des caractéristiques différentes suivant les pays, en fonction des situations concrètes, spécifiques à chacun. Il a néanmoins deux caractéristiques constantes : d'une part, un programme pseudo-révolutionnaire qui, de façon extrêmement habile, prend appui sur les courants d'opinion, les intérêts et les revendications des masses sociales les plus larges et, d'autre part, l'emploi de la terreur la plus brutale.
L'Italie offre à ce jour l'exemple classique du fascisme et de son développement. Dans ce pays, le fascisme a trouvé un terrain favorable en raison du démantèlement et de la faiblesse de l'économie...
Un an après la soi-disant révolution fasciste, on ne peut rester indifférent au souvenir de ce qu'était le programme du fascisme à la veille de la conquête du pouvoir, et en examinant les résultats atteints pendant ce laps de temps. Une période de douze mois, dans cette époque vertigineuse durant lesquels les mois semblent des décennies, ne peut pas être considerée trop brève pour juger d'un gouvernement, même si ce dernier - comme celui fasciste en l'occurrence - déclare qu'avant d'accepter le jugement de qui que ce soit, il a besoin de "temps"...
Il y a 45 ans, Petra Schelm était tuée par la police ouest-allemande. C'était le 15 juillet 1971, un mois avant l'anniversaire de ses 21 ans.
Après des études de coiffeuse, elle qui venait de milieux modestes avait choisi la rupture. Elle participait aux milieux hippies politisés, surnommé le « blues » et composé de cent colocations rassemblant plusieurs centaines de gens vivant de manière « alternative », dans un mélange de rock et de haschich (tout en refusant l'alcool, dans l'esprit hippie de l'époque). C'est du « blues » dont seront largement issus des organisations de lutte armée comme « les rebelles du hasch », « le mouvement du 2 juin », « les Tupamaros de Berlin-Ouest »...
C'est donc une chose très importante à comprendre : en 1922, le fascisme ne prend pas le pouvoir, il prend seulement la tête du gouvernement. Il y a une répression illégale menée par les squadristes, il y a des interdictions, mais le régime n'a pas changé officiellement de nature.
Ainsi, en 1923 l’État procède à un très vaste coup de filet anti-communiste, décapitant la direction du Parti Communiste d'Italie. Or, les 2000 personnes arrêtées ne le sont que pour peu de temps, quelques mois au maximum, 97 sont libérées pour manques de preuves alors que les 31 personnes passant en procès sont acquittés, sauf une à quatre mois de prison...
L'Internationale Communiste, depuis le début, a un problème avec la direction du PCI, qui n'hésite pas à faire comme bon lui semble, au nom de la révolution qui serait imminente dans toutes les situations, ce qui nécessiterait une position ultra-gauchiste afin d'apparaître comme la seule option aux yeux des masses.
Lorsque l'Internationale Communiste exige que le Parti Communiste d'Italie fusionne avec le Parti Socialiste italien, Amadeo Bordiga qui est emprisonné parvient à exposer sa ligne dans ses messages : il faut dire non et rejeter l'Internationale Communiste. La rupture est alors complète et l'Internationale Communiste peut enfin remplacer la direction du PCI, ce qui se réalise à la mi-1924, avec enfin un poste de secrétaire général qui est formé, Antonio Gramsci assumant cette fonction...
Les avancées énormes du fascisme ont deux conséquences à gauche. La première est l'organisation militaire du PCI, la seconde la scission du Parti Socialiste italien.
A partir de 1921 et du tournant de 1922, le PCI dispose de structures clandestines qui sont progressivement efficaces, principalement dans les villes : Turin est son bastion, à quoi il faut ajouter Milan et Rome, ainsi que Novara, Trieste et Gênes...
La marche sur Rome est l'événement le plus connu du fascisme italien. Il est souvent associé à la prise du pouvoir en tant que tel, ce qui est tout à fait erroné : avec cette marche, le fascisme a progressé d'une étape, mais il ne possède pas encore réellement le pouvoir.
Ce qui se passe est que, après que les faisceaux italiens de combat se soient lancés contre la gauche par la violence, il y a une tentative de capitaliser cela politiquement avec la fondation, le 9 novembre 1921, d'un Parti National Fasciste (PNF).
Benito Mussolini tente, par cette manœuvre, d'unifier un mouvement disparate. Avant la fondation du PNF, les 2200 faisceaux regroupent 320 000 personnes, dont la majorité consiste en des étudiants, des employés, des commerçants et artisans, des propriétaires terriens...
L'appel de Cochin est l'un des documents les plus importants de l'histoire de la contradiction au sein de la bourgeoisie française, entre la fraction d'orientation industrielle, d'esprit moderniste et libéral, et la fraction d'orientation gaulliste, d'esprit stratégique et nationaliste.
Ces deux orientations s'appuient sur deux secteurs différents de la bourgeoisie : d'un côté le secteur principalement lié à l'industrie et au commerce, de l'autre le secteur lié aux banques, aux groupes monopolistes et à l'armement...
Né en 1889, Amadeo Bordiga a été le premier dirigeant du Parti Communiste d'Italie, sa grande figure théorique. A ce titre, il a une responsabilité absolue dans la défaite du PCI.
Amadeo Bordiga était quelqu'un se plaçant directement dans la lignée du syndicalisme révolutionnaire, rejetant la politique : à ses yeux, le Parti Communiste jouait le rôle moteur, comme le syndicat pour les syndicalistes révolutionnaires, et c'était absolument suffisant pour le processus révolutionnaire...
Pendant que les forces du PCI sont harcelées et débordées sur tout le territoire, des antifascistes se regroupent spontanément, principalement des anciens combattants progressistes, des républicains du Parti Populaire Italien (catholique), des anarchistes, des socialistes...
En quelques mois, ce phénomène de cellules autonomes, les Arditi del Popolo, prend une ampleur telle que leur nombre atteint 20 000 hommes pour 144 sections. Le style des Arditi del Popolo était au moins en partie problématique, car il reprenait le principe de la brigade de choc de la première guerre mondiale, l'esthétique rebelle sans démilitations culturelles et politiques, etc. C'était une révolte populaire épidermique, née sur le terrain de la contre-violence face aux violences fascistes...
La gauche, à la suite du bienno rosso, a de plus en plus perdu les masses. Les fascistes ont réussi à happer des secteurs entiers dans le corporatisme, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire sans la révolution, l'énergie sociale-révolutionnaire passant dans le nationalisme.
On reste dans l'apolitisme, au nom de l'anti-parlementarisme, mais la sortie n'est plus une hypothétique révolution, mais la transformation nationale-révolutionnaire. Benito Mussolini est historiquement le dirigeant socialiste qui a le plus accepté et soutenu le syndicalisme révolutionnaire...
Les fascistes avaient réussi à s'organiser et à développer une réelle pratique. Qu'en était-il à gauche ? Tout dépendrait de cela.
Soit la gauche s'épuisait, soit elle avançait réellement et alors elle pouvait faire face au fascisme. L'aile droite du PSI ne le voulait pas, appelant à « tendre l'autre joue », à respecter la « civilité socialiste » à tout prix, pensant que le fascisme n'était qu'un phénomène faible et passager...
En réaction au mouvement ouvrier, ainsi que dans le prolongement de l'irrédentisme et du nationalisme, le fascisme s'est développé en Italie avec un grand succès. Son symbole était un faisceau, un fascio, d'où le qualificatif de fasciste (qui se prononce ainsi initialement en français avec un son en « s » et non en « ch »).
Le faisceau avait été utilisé comme symbole révolutionnaire, surtout démocrate, dans l'Italie de la fin du XIXe siècle, notamment en Sicile ; composé de verges, c'est-à-dire de baguettes en bois, le faisceau représentait la force de l'unité, de par la solidité de l'ensemble par rapport à la fragilité d'une verge seule...
Au lendemain de la Première Guerre mondiale impérialiste, ce n'est pourtant pas le nationalisme qui a immédiatement l'initiative, mais le mouvement ouvrier, avec deux années d'intenses mobilisations.
Le drame historique est qu'il n'y eut pas de développement d'un contenu idéologique et culturel conséquent; pour cette raison, le « bienno rosso » - les « deux années rouges » - ont abouti directement à renforcer le fascisme en lui laissant un espace majeur.
De fait, le Parti Socialiste italien disposait en 1919 d'une base solide. Il avait 200 000 membres, ayant encore ses structures intactes en s'étant surtout mis en veilleuse pendant la Première Guerre mondiale, sur une ligne refusant tant le soutien à la guerre que son refus, synthétisé par le mot d'ordre « ni adhérer ni saboter »...
La contradiction entre l'Italie du Nord et celle du Sud devait être résolue soit par une révolution démocratique – qui ne pouvait plus être menée que par le prolétariat, la bourgeoisie étant devenue réactionnaire alors – soit par une tentative de modernisation par en haut ossifiant la contradiction dans une fuite en avant.
L'irruption de la première guerre mondiale impérialiste précipita la seconde option ; tel est la nature du fascisme qui triomphera à sa suite...
Quelle a été la base pour l'émergence de la pensée d'Antonio Labriola, du courant futuriste, du théâtre « existentiel » de Luigi Pirandello ?
Il s'agit du contraste et de la contradiction entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, c'est-à-dire d'une question nationale et, par conséquent, d'une question liée à l'émergence du capitalisme face au féodalisme...
Il serait totalement erroné de penser que le volontarisme subjectiviste modernisateur se soit cantonné dans les arts et la littérature de l'Italie du début du XXe siècle ; en réalité, les arts et la littérature sont le reflet culturel-idéologique de toute lame de fond sociale et intellectuelle.
De la même manière qu'en France, le marxisme a été largement incompris en Italie. Cela a donné, comme en France, la combinaison d'un réformisme politique « socialiste » et d'une ligne « ultra » de type syndicaliste-révolutionnaire...
L'approche de Luigi Pirandello en littérature, dans le roman et le théâtre, trouve son plus proche parent dans le futurisme, un mouvement artistique fondé et dirigé de manière despotique par Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).
Ce dernier puise directement dans le symbolisme-décadentisme, mais de par les particularités italiennes, cela se transforme non pas en élitisme de la mise à l'écart esthétisante des artistes, mais par l'appel à la prise de contrôle des destinées artistiques du pays...
La France a toujours possédé des liens étroits avec l'Italie. C'est une nation en quelque sorte cousine, si ce n'est sœur, et il est considéré que finalement la différence entre Français et Italiens ne tient qu'à quelques différences de tempérament, de mentalités. Historiquement, la figure de Benito Mussolini n'a ainsi jamais pu être prise au sérieux en France, pays où le classicisme et les Lumières ont amené une exigence de propreté formelle, de linéarité dans l'expression.
Benito Mussolini apparaît pour cette raison, comme une figure de la commedia dell'arte, qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Le fascisme italien est dévalué comme une sorte d'aventure foklorique propre à l'Italie, à placer au même niveau que les simulations des joueurs italiens de football ou les frasques de Silvio Berlusconi, l'entrepreneur qui a dirigé l'Italie pendant de longues années...
Il reste pour la Bhagavad Gîtâ à se préoccuper du sort de Krishna : qui est-il ? On sait que c'est un avatar de Vishnou, apparaissant lors des troubles afin d'indiquer la voie correcte. Reste que dans le Mahâbhârata, on le prend pour un être humain tout en s'adressant à lui comme s'il était un dieu.
Comment se sortir de cette contradiction, de ce qui a sans doute été une figure humaine déifiée, comme le plus souvent dans les religions indiennes ?...
Cette question du sacrifice en esprit qui est supérieur au sacrifice dans l'action a comme base l'objectif idéologique qu'est l'hégémonie des prêtres. En pratique, une fois le cœur de la Bhagavad Gîtâ mis en place dans les quatre premiers chapitres, le restant des chapitres sert en effet à colmater la série nombreuse de brèches provoquée par le saut qualitatif effectué par la modification du rapport caste des guerriers – caste des prêtres.
Le premier souci est, comme le souligne Arjuna, de savoir s'il faut privilégier tout d'abord « le renoncement qui supprime l’action » ou bien « le yoga qui est effort »...
Les trois premiers chapitres de la Bhagavad Gîtâ sont déjà magistraux : ils ont déjà fourni la substance de l'œuvre, donné sa perspective. Reste qu'en tant qu'œuvre religieuse-magique, il fallait bien justifier l'irruption de Vishnou sous la forme de son avatar Krishna, homme tout bleu intervenant avec ses conseils avisés.
Portons un regard sur ce qu'ajoute Krishna dans le troisième chapitre, qui reflète une véritable réflexion philosophique sur le sens du monde. La Bhagavad Gîtâ n'aurait pu avoir un tel écho si elle ne présentait pas une tentative d'explication rationnelle du monde, au moins en partie.
Ce qui rend ici les choses très intéressantes, c'est que la Bhagavad Gîtâ considère que les humains font l'histoire par nécessité, et non pas par choix individuel. Il y a ici très clairement une rupture matérialiste avec l'antiquité et ses guerriers agissant comme bon leur semble en apparence...
La plus grande erreur qu'on puisse faire au sujet de l'hindouisme, c'est de considérer qu'il s'agit d'un simple justificatif de castes. L'hindouisme est plus que cela ; c'est un dépassement du brahmanisme, qui avait instauré et systématisé la domination aryenne sur les peuples de ce qui est devenu l'Inde.
Ce dépassement est en étroite liaison avec les grandes rébellions progressistes qu'ont été le bouddhisme et le jaïnisme, qui ont rejeté le système des castes...
Le second chapitre de la Bhagavad Gîtâ tient à la réponse faite par Krishna aux propos d'Arjuna. L'explication de Krishna se divise elle-même en deux parties : tout d'abord, il y a une présentation de l'univers et du sens qu'a la vie en son sein, et ensuite on a l'exposition de la méthode à suivre pour agir de manière correcte.
Le paradoxe de l'approche qu'on trouve dans la Bhagavad Gîtâ est que Krishna ne conforte pas du tout Arjuna dans sa volonté de ne pas combattre. La conclusion du Mahâbhârata tient justement à ce que l'affrontement général a amené la disparition de pratiquement tous les combattants, pavant la voie à une nouvelle génération devenue « pure »...
La Bhagavad Gîtâ est un exposé de morale et de philosophie en 18 chapitres qui date d'entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ, fournissant les principes généraux de la vie en commun dans l'Inde antique.
Cet ouvrage très important de la culture mondiale s'insère lui-même dans le Mahâbhârata, gigantesque poème de 81 936 strophes, racontant la bataille finale des guerriers de l'Inde, prélude à une fin du monde et à une renaissance...
Avant [les accords de Munich], dans la République [de Tchécoslovaquie], c'était une petite clique de messieurs de la haute finance, de la grande industrie et des grands propriétaires terriens, qui gouvernait et décidait.
Cela est maintenant su de chacun, de chaque tchèque et de chaque slovaque. Dans la constitution, il était bien sûr écrit que tout le pouvoir vient du peuple, mais en réalité le peuple sentait à chaque pas qu'il faisait que c'était du sac d'argent que venait tout le pouvoir...
Extrait du rapport lu par Walter Ulbricht, à Berlin le 19 avril 1946, lors du XVe congrès du Parti Communiste d'Allemagne.
La question essentielle qui se pose présentement en Allemagne est de se débarrasser des bases matérielles de l'impérialisme et du militarisme allemands, et la lutte contre les idéologies impérialistes et militaristes.
Il ne doit pas être de nouveau permis aux forces impérialistes réactionnaires, aux messieurs des monopoles et de la banque et aux grands propriétaires terriens d'utiliser la démocratie dans leur combat contre l'ordre démocratique et pour la reconstruction de leurs organisations réactionnaires...
Il y a 50 ans commençait en Chine populaire la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne (GRCP). Les médias bourgeois de notre pays se déchaînent contre cet épisode historique, alors qu'en Chine devenue social-fasciste, le thème est totalement tabou en raison de ce qu'il révèle : que les cibles de la GRCP ont triomphé et rétabli le capitalisme, avec un régime fasciste.
En France, dans les années 1960, la GRCP a été largement incomprise : elle a été niée très rapidement par le PCMLF (qui scissionna ensuite en pro-révisionnistes chinois et en pro-albanais anti-maoïste) et elle a été comprise par des spontanéistes comme une sorte de mouvement anti-bureaucratique de « dépassement » du léninisme...
La grève des 100 000 est un événement historique d'une très grande importance et en tant que communistes de France et de Belgique, nous tenons à honorer, 75 années après, la mémoire de ses combattants.
Il s'agit de se souvenir de comment les masses travailleuses de Belgique ont osé faire face à l'occupant nazi, afin de faire triompher leurs revendications et d'ébranler la machine de guerre impérialiste...
1.La situation de la Belgique
* La victoire militaire de l'Allemagne nazie sur la Belgique et la France a fait que la Belgique et le Nord de la France sont réunis et directement administrés par l’armée nazie, sous la direction du général von Falkenhausen.
* L'esprit de résistance nationale à l'occupant allemand s'est tout de suite développé en Belgique, avec la diffusion de nombreuses publications clandestines, notamment grâce au Front de l'Indépendance (FI) fondé en mars 1941 par le Parti Communiste de Belgique...
Cependant mets-y ensemble deux prisonniers et surtout des communistes et voilà en cinq minutes une communauté qui va bouleverser tous tes plans. Depuis l'année 1942, on ne l'appelait déjà plus que « la centrale communiste ».
Elle a connu beaucoup de changements et sur ses bancs ont passé des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Mais une chose n'y a jamais changé, c'en l'âme de la communauté, dévouée à la lutte et sûre de la victoire...
Nous nous tenons mutuellement fermement les mains… Nous réussissons l'unité !
Camarades ! Une année de dure labeur s'est terminée. La nouvelle année commence avec des tâches encore plus grandes !
L'année 1946 rentrera dans l'histoire du mouvement ouvrier comme le début de l'unité organisationnelle. Dans la zone Est de l'Allemagne, le Parti Social-Démocrate et le Parti Communiste se sont unifiés en Parti Socialiste de l'Unité !...
Ce qui est frappant c'est que si les zapovedniks n'avaient pas été compris par les communistes d'Union Soviétique, une fois le révisionnisme ayant triomphé après 1953, les révisionnistes avaient tout à fait compris que les zapovedniks formaient pour eux une menace terrible.
Le principe des zapovedniks tient à celui de Biosphère, de superorganisme ; il s'oppose à la conception bourgeoise d'écosystème où tout est relatif et individualisé, défendue par exemple en URSS par Leontii Ramensky (1884-1953), qui rejoignit le PCUS(b) en 1946...
Le plan considère l'ensemble des forces productives. Par conséquent, l'existence de zones naturelles fait face à lui comme une possibilité et une menace. C'est une possibilité, car le développement de l'humanité se déroule au sein même de la nature et il y a donc une nécessaire rencontre qui doit se faire. C'est une menace, au sens où les zones naturelles échappent à la tendance historique formée par le plan.
La question de la résolution de cette question était vitale pour le plan ; on peut considérer que cet aspect – qui va de pair avec la question de l'agriculture, arriérée malgré sa base socialiste majoritaire, en raison de l'importance de la production des koklhozes relativement autonomes, ainsi que de l'infime secteur privé – a joué un rôle central dans l'émergence et la victoire du révisionnisme...
Il existe une contradiction dans la société soviétique, qui n'a pas été vue par le PCUS(b). Celle-ci ne tient pas seulement aux restes idéologiques de la bourgeoisie, mais à l'arriération de l'agriculture. C'est d'ailleurs cette arriération qui empêche la liquidation complète des restes idéologiques du passé.
Ainsi, en 1931, une loi organisa l'établissement de « zones de culture de forêts » et appela le Commissariat au peuple à l'agriculture à empêcher les sécheresses par une ceinture de forêts, en formulant bien que cela devait être réalisé sur le terrain de l’État et celui des fermes collectives...
Le plan le plus connu qui fut développé parallèlement aux plans quinquennaux est ce qui fut connu sous le nom de « plan de transformation de la nature » ; le document promulgué le 24 octobre 1948 avait comme nom complet « Plan des plantations forestières protectrices, de l'introduction d'ensemencement en herbes variables, sur la construction des digues et d'étangs artificiels en vue d'obtenir des rendements élevés et stables dans les régions de la steppe et de la steppe boisée de la partie européenne de l'URSS ».
C'était une décision du Conseil des ministres de l'URSS et du Comité Central du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchévik) ; administrativement, un poste de vice-premier ministre à l'irrigation fut constitué et l'Administration centrale de l'économie des eaux, dépendant du ministère de l'agriculture, fut renforcée...
La planification de la totalité de l'économie permet, plan quinquennal après plan quinquennal, d'agrandir la production et par conséquent de renforcer la consommation qui n'a, dans le socialisme, pas le même sens que dans le capitalisme. Ce dernier, en effet, nivelle culturellement vers le bas, tend à des produits de masse de mauvaise qualité et à des marchandises élitistes sans intérêt réel bien souvent.
En URSS, la planification visait donc à renforcer le développement matériel et spirituel, en attribuant une part toujours plus grande à la culture, aux sciences, à la vie sociale, aux soins médicaux, etc. Une partie des ressources servait à l'accumulation pour lancer et renforcer le prochain cycle quinquennal, une autre partie à la consommation afin de satisfaire de mieux en mieux les masses...
La planification soviétique consistait, à l'époque de Staline, en une comptabilité administrée par un organisme d’État, donnant aux entreprises d’État une liste de tâches productives.
C'est là le grand apport de Staline au marxisme-léninisme, puisque la planification n'est pas mise en place en URSS, en tant que telle et véritablement, avant 1932, cet apport étant dans la continuité directe du léninisme...
Comment l'URSS de Staline concevait-elle sa planification ? Quelle était sa « loi économique », c'est-à-dire sa manière d'appréhender la production et la consommation ?
Cette question est d'une importance capitale, car il serait faux de penser que la planification suffirait « en soi » à caractériser le socialisme. Le socialisme a un contenu et la planification ne peut pas exister s'il n'y a pas ce contenu...
Organisant l'économie à l'échelle d'un pays, le GOSPLAN était dans la nécessité de procéder à des équilibres, des opérations de balances, afin qu'il y ait un équilibre général.
Le plan consiste en la gestion de la matière relevant des forces productives, avec un plan comptable consistant en des entrées et des sorties, un équilibre devant être réalisé, chaque entreprise devant être capable d'une « assimilation » complète de ses possibilités afin de les réaliser...
Si le GOSPLAN a besoin de statistiques, ce n'est pas pour gérer une économie qui se reproduit, c'est pour saisir la situation afin de la transformer en transmettant des ordres et des moyens aux entreprises collectivisées.
Cela passait également par une gestion par branches économiques, ainsi que par territoires (l'URSS étant une fédération de républiques, comprenant chacune une division territoriale plus ou moins hiérarchisée)...
On se doute que la grande difficulté de l'établissement d'un plan, c'est la question des données : non seulement il faut les déterminer, les définir en détail, mais il faut aussi les rassembler, elles doivent être fiables, complètes, mais en plus il faut savoir les utiliser. Pour cette raison, l'URSS de Staline a fourni un apport d'une incroyable valeur à la comptabilité et aux statistiques.
Staline, au XVIe congrès du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchévik), résume cela de la manière suivante : « Un travail de construction, un travail de gouvernement, un travail planifié sont impensables sans une comptabilité exacte. Et la comptabilité est impensable sans la statistique. »...
La planification soviétique se fonde sur le matérialisme dialectique. Elle se fonde par conséquent sur la réalité matérielle et le travail comme transformation de la réalité, en ayant les moyens d'agir tant sur l'une que sur l'autre.
En effet, la réalité matérielle a été progressivement socialisée ; l'ensemble des moyens de production appartient à la société, au lieu d'appartenir à des individus en concurrence. Le travail est désormais extrêmement organisé, étant donné que c'est la classe ouvrière elle-même qui dirige l’État...
Le premier plan réalisé après la révolution d'Octobre 1917 fut adopté par le 8e congrès des soviets, en décembre 1920 ; entre-temps, la guerre civile et l'intervention étrangère avaient empêché une réorganisation générale d'un pays qui, rappelons le, était extrêmement arriéré dans son développement.
Pour toutes ces raisons – chaos, guerre civile, arriération culturelle – la direction centrale des statistiques mise en place par le nouveau régime dirigé par le Parti Communiste ne possédait pas de vue d'ensemble avant la fin de l'année 1919...
La grande caractéristique de l'URSS de l'époque de Staline a été la planification de l'économie : un organisme central établissait un plan qui était suivi par toutes les entités productives, elles-mêmes collectivisées.
Contrairement au capitalisme où c'est le marché, par la concurrence, qui décide de ce qui est produit, le matérialisme dialectique considère qu'il est possible de prévoir ce qu'il faut produire, le plan étant établi de manière quinquennale, avec des adaptations trimestrielles et annuelles...
Il s'agit donc d'être absolument clair : pour Lénine, on ne peut pas rétrograder et faire cesser l'impérialisme pour en revenir au stade du capitalisme concurrentiel.
Ce qui se passe pourtant – et c'est dialectiquement relié à cela – est qu'une partie des responsables ouvriers pratiquent le social-impérialisme, prétextant pouvoir « réformer » l'impérialisme, mais en réalité le modernisant, l'aménageant, etc...
Ce qui est à la base de la compréhension léniniste de l'impérialisme, c'est que celui-ci a deux aspects. Le monopole est un progrès par rapport au capitalisme libéral concurrentiel ; en même temps, il porte en lui son propre dépassement.
Une fois qu'il a, en effet, atteint son développement, le monopole issu du capitalisme devient simplement parasitaire. Il a été l'expression de l'accroissement des forces productives ; il en devient un frein, un obstacle, une frontière...
Le matérialisme dialectique étant la science du réel, Lénine a tenté de donner la définition la plus précise du phénomène impérialiste. Naturellement, cette définition constate le développement de ce phénomène par des contradictions.
Voici ce que dit Lénine : « Il nous faut maintenant essayer de dresser un bilan, de faire la synthèse de ce qui a été dit plus haut de l'impérialisme. »...
Extrait de l'article écrit par Hilary Minc sous le titre « Au sujet de certains problèmes de la démocratie populaire à la lumière de l'enseignement de Lénine et Staline quant à la dictature du prolétariat », et publié dans Nowe Drogi, organe théorique du Parti, en 1950.
Le grand bouleversement social qui a eu lieu après la guerre dans les pays d'Europe centrale et d'Europe du sud-est, et dont le résultat a été l'ancrage dans ces pays de la dictature du prolétariat sous la forme de l'État de la démocratie populaire, a porté les caractéristiques d'une révolution prolétarienne, d'une révolution socialiste...
Ainsi, il y a d'un côté des regroupements capitalistes de type monopoliste menant une bataille à l'échelle planétaire, de l'autre les États eux-mêmes, en tant qu'outils toujours davantage dans les mains des monopoles, participant à la bataille pour le contrôle de territoires.
Ce qui détermine notamment la première guerre mondiale impérialiste, c'est que la période la précédant avait été marquée par la fin du partage. L'Afrique et la Polynésie colonisées, il ne restait plus de territoires disponibles. Les contradictions inter-impérialistes ne pouvaient que s'amplifier...
On a vu que dans l'impérialisme, le capital jouait un rôle encore plus grand, car il était centralisé, avec les banques. Or, s'il est centralisé, il est dialectiquement encore plus dispersé, les capitalistes investissant partout de par le monde.
Lénine formule donc la définition scientifique suivante : « Ce qui caractérisait l'ancien capitalisme, où régnait la libre concurrence, c'était l'exportation des marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel, où règnent les monopoles, c'est l'exportation des capitaux. »...
« Concentration de la production avec, comme conséquence, les monopoles ; fusion ou interpénétration des banques et de l'industrie, voilà l'histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion. »
C'est ainsi que Lénine synthétise les deux premiers chapitres de L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ; cependant, il considère comme nécessaire d'expliciter de manière scientifique deux notions étroitement liées : celles de capital financier et d'oligarchie financière...
Dans le premier chapitre de L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine traite de la question des monopoles.
C'est le point de départ de son analyse, tout son œuvre s'appuie sur cette base, directement issue de l'analyse de Karl Marx dans Le Capital...
Lénine, dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ajoute un concept au marxisme. L'analyse de Karl Marx est juste, dit Lénine, cependant ce dernier considère qu'il faut préciser certains aspects, en particulier le caractère parasitaire du capitalisme devenu monopoliste.
Le choix du terme « impérialisme » n'est pas de Lénine lui-même ; il reprend un terme utilisé par deux auteurs liés au marxisme, mais dont les analyses n'étaient pas assez développées ni conséquentes...
Nous avons la chance de disposer historiquement des cahiers utilisés par Lénine pour prendre des notes au sujet de l'impérialisme, notes qu'il assemblera et synthétisera pour donner naissance à ce qui est peut-être son ouvrage le plus fameux : L'impérialisme, stade suprême du capitalisme.
Ces cahiers furent écrits principalement en deux fois. Lénine commença à les écrire dans la seconde partie de 1915, alors qu'il était en exil en Suisse, en pleine guerre impérialiste, avant de poursuivre en 1916 à Zurich, que Lénine avait privilégié en raison de la présence là-bas d'une grande bibliothèque...
Aux yeux du matérialisme historique, Port-Royal exprime donc un courant fondamentaliste. D'où vient-il ? Du décrochage de la religion catholique française par rapport au courant ascendant de la monarchie absolue, qui a établi un accord avec le Vatican au moment d'Henri IV.
La religion catholique est depuis l’Édit de Nantes indissociablement liée à la montée du pouvoir absolu du roi, elle l'accompagne, afin de tenter de récupérer son hégémonie dans la foulée...
L'histoire du jansénisme et de Port-Royal a marqué les esprits, surtout de par l'ampleur de la répression subie. Historiquement, deux ans après la mort de Jansénius, parut en 1640 son ouvrage majeur, appelée Augustinus seu doctrina Sancti Augustini de humanæ naturæ sanitate, ægritudine, medicinā adversùs Pelagianos et Massilienses.
L'oeuvre fut mise à l'index par une bulle papale, In eminenti, dans la foulée, en 1642, mais la bulle ne fut publiée qu'en 1643 ce qui laissa le temps aux jansénistes français d'intervenir pour défendre leur idéologie. La polémique fut lancée avec, en 1653, une nouvelle bulle papale, Cum occasione, condamnant le jansénisme, dont les thèses furent résumées en cinq points...
Né en 1639, Jean Racine a perdu ses parents dès 1643 et ce sont ses grands-parents paternels qui s'occupèrent de lui, à la Ferté-Milon, non loin de Port-Royal des Champs. Sa tante y était devenue pensionnaire, avant d'y prononcer ses vœux, comme l'avait déjà fait sa propre tante.
A la mort de son grand-père, il rejoint les Petites-Ecoles de Port-Royal Paris, alors que sa grand-mère rejoint l'institution en tant que religieuse...
Blaise Pascal (1623-1662) est extrêmement réputé en France, d'abord comme scientifique, ensuite comme auteur des Pensées. C'est là quelque chose d'absurde, car ces deux faces s'opposent radicalement. Blaise Pascal, ayant basculé dans la religion dans une variante mystique, est un fanatique, radicalement opposé aux sciences.
Cela a été une opération de grande envergure du catholicisme que de prétendre qu'il n'y a aucune contradiction dans ces deux aspects, tout comme par ailleurs le fait de nier que la démarche mystique de Blaise Pascal est janséniste et donc différente de la ligne officielle du Vatican...
Port-Royal apparaît comme le pendant de René Descartes : la démarche est la même, mais René Descartes a historiquement servi indirectement la bourgeoisie et sa volonté d'aller à la science, alors que Port-Royal rejetait la science.
C'était donc plus clair et plus franc du côté de Port-Royal, alors que René Descartes se noyait dans ses contradictions, étant religieux mais devant publier ses œuvres aux Provinces-Unies par crainte de l’Église...
Comment saisir le fondamentalisme de Port-Royal ? En fait, il existe un épisode absolument méconnu de tous les discours sur le « jansénisme », qui pourtant révèle la nature de celui-ci. La responsable de Port-Royal, Agnès Arnauld, a en effet écrit un texte mystique intitulé Chapelet Secret du Saint-Sacrement.
Ce texte fut écrit à la demande de son confesseur, Charles de Condren (1588-1641), qui voulait connaître son rapport à Jésus. Charles de Condren était une figure très importante de l'Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France, fondé par Pierre de Bérulle, qui comme on le sait joua un rôle déterminant pour Saint-Cyran...
La treizième lettre s'adresse directement aux jésuites, leur répondant directement, mais de manière publique, et même politique. Blaise Pascal, en effet, attaque entièrement les jésuites ; il ne fait pas que les critiquer, il les dénonce et appelle à leur élimination. Ce n'est compréhensible que si l'on saisit cette question de la régénération mystique prônée par Port-Royal.
Car l'objectif de Port-Royal est de régénerer l’Église au moyen du « coeur », de l'adoration, du mysticisme. Blaise Pascal expose donc son point de vue de manière très franchement, et c'est donc très différent d'auparavant...
En quoi fut-il intéressant pour Port-Royal de s'appuyer sur René Descartes face aux jésuites ? Eh bien, l'accusation contre les jésuites tenait à ce qu'ils adaptent leurs règles selon les gens.
Or, ils se référent pour cela à la scolastique, c'est-à-dire la logique développée à partir des écrits d'Aristote. Il était donc nécessaire à Port-Royal d'expliquer que les jésuites tronquaient les définitions, que leur « casuistique » était incohérente...
La onzième lettre inaugure les messages directs de Blaise Pascal – qui écrit de manière anonyme – aux « Révérends Pères ». On passe ici à l'offensive ouverte, et on devine qu'il y a une véritable théologie pour se le permettre.
Attaquer les jésuites de front est en effet très osé, surtout que le vocabulaire est outrancier : « opinions extravagantes », « décisions si fantasques et si peu chrétiennes » désignent les opinion des jésuites, tandis que Blaise Pascal assume entièrement un « discours de moquerie » une « ironie piquante »...
Port-Royal entendait refuser l'approche des jésuites, visant à aller sur le terrain de ceux qui sont opposés à Dieu. Mais comment faire pour synthétiser cette approche sans basculer dans le mysticisme pur et simple?
C'est là qu'on voit que Port-Royal est une école de pensée, qui n'est pas parvenu à établir une doctrine, mais qui a tenté d'aller en ce sens...
La dixième lettre est pratiquement la dernière des Provinciales, les autres se voulant des lettres ouvertes à des révérends pères, c'est-à-dire des religieux. On notera qu'historiquement, ces attaques auront un grand écho dans leur attribution d'une mauvaise image des jésuites, du point de vue catholique lui-même.
Il s'agit d'une dénonciation des jésuites, du côté catholique même. Voici un exemple significatif, avec la définition justement de l'adjectif révérend par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales...
Le terme « janséniste » fut formé par le camp des jésuites, qui tentaient ainsi de présenter Jansénius comme une sorte de nouveau Jean Calvin, de fondateur d'un nouveau schisme, un danger pour l'Église.
Jansénius, cependant, voulait refonder l’Église, plus que l'abolir ; quant à ses partisans français, ils représentaient un courant aux idées multiples, uni dans l'opposition aux jésuites et la volonté d'une quête spirituelle...
Lorsque Blaise Pascal commence la huitième lettre, il remarque que beaucoup de gens se demandent qui est l'auteur des Provinciales, mais que personne ne le sait. Il souligne également qu'il apprend ce que pensent les jésuites en masquant sa véritable opinion à ce sujet.
Toutefois, il ne la donne pas encore et la raison, pour nous, est qu'il ne peut pas le faire, parce que le point de vue « janséniste » n'a pas été encore synthétisé. Le point de vue « janséniste » est une approche mystique rejetant les jésuites, mais il n'y a pas de proposition stratégique pour la société française...
Il va de soi que le jansénisme en tant que courant religieux ne fut pas en mesure de s'implanter aussi rapidement en France, sans disposer d'une base pour cela. Le paradoxe est que cette base ne fut pas janséniste ; en fait, on peut quasiment dire que le jansénisme n'a en tant que tel jamais existé, étant pris comme prétexte par les uns et les autres. Il existait toutefois un dénominateur commun : un esprit tendant au renouveau de la spiritualité, contre l'aridité intellectuelle et philosophique des jésuites.
On trouve à l'origine de cette base le cardinal Pierre de Bérulle (1575-1629), qui dirige la faction catholique pro-autrichienne, totalement cléricale-féodale, dans le contexte de l'Édit de Nantes et de la politique de modernisation du roi Henri IV...
Dans les sixième et septième lettres, Blaise Pascal est dans son élan ; les lettres ont eu leur succès, il peut approfondir le niveau, faire passer des messages plus âpres, avec davantage de profondeur théorique. Il peut tenter le saut qualitatif pour faire des lettres un vecteur idéologique.
Dans ces nouvelles lettres, il fait par conséquent parler un jésuite et lui fait décrire un véritable catalogue de situations, avec à chaque une fois une analyse des « intentions ». On lit par exemple et l'exemple est brutal : « Et même, selon notre célèbre P. Lamy, il est permis aux prêtres et aux religieux de prévenir ceux qui les veulent noircir par des médisances, en les tuant pour les en empêcher. Mais c’est toujours en dirigeant bien l’intention »...
Le jansénisme en tant que courant proposait une alternative à la compagnie de Jésus. Cette dernière était pour une éducation stricte d'une élite tournée vers le peuple et chargée de la mobiliser, de le canaliser dans le mysticisme religieux.
Le jansénisme était quant à lui tourné vers la formation d'une élite religieuse moins hiérarchisée et entourée fortement de laïcs, le tout dans une atmosphère non pas populaire et mystique en général comme avec le baroque jésuite, mais individuel et austère, en faveur du repentir, d'une mystique personnalisée...
Le jansénisme est donc un espace, qui permet de réaliser une offensive anti-jésuite dans la mesure où sa dynamique en est totalement indépendante. Et ce qui est frappant, c'est qu'en apparence, les lettres de Blaise Pascal que sont les « Provinciales » ne dépassent pas une critique absolue des jésuites. C'est le cas de la cinquième lettre, qui semble n'être qu'une critique morale.
On verra par la suite que l'ampleur de la critique possède un véritable fond, de type mystique et fondamentaliste. Au départ des lettres cependant, on est toutefois dans une opération de communication moraliste, sur un ton moqueur...
Regardons ce que dit Cornelius Jansen, par rapport à la critique anti-jésuite de Blaise Pascal. Que dit Cornelius Jansen ? Il a exprimé sa thèse de manière la plus développée dans Augustinus, une œuvre posthume publiée en 1640. Ce fut considéré alors, notamment par les jésuites, comme une « déviation » au sein du catholicisme, qui fut appelée « jansénisme ».
Cornelius Jansen accepte en effet le point de vue calviniste de la prédestination divine : pour le protestantisme façonné par Jean Calvin, il n'y a pas d'intermédiaire entre soi et Dieu, et Dieu a décidé, dans sa toute-puissance...
Le jansénisme est donc né aux Pays-Bas, avec comme base le patriciat, qui pour exister ne pouvait pas accepter ni le calvinisme bourgeois, ni les jésuites et leur apologie du féodalisme le plus strict. Il s'agit d'une idéologie indépendante tant du calvinisme, que des jésuites. A ce titre, on peut la reprendre et s'en inspirer. C'est ce que fait Port-Royal, qui y voit un outil pour ses propres thèses, qui restent à exposer.
Cependant, il est un fait qu'il faut bien saisir de prime abord. En France, on a considéré souvent que puisque l'école de Port-Royal combattait les jésuites, et que ceux-ci étant les partisans de la féodalité, alors Port-Royal serait anti-féodal. On a justifié cela notamment en remarquant que les gens s'intéressant au jansénisme dans l'Eglise catholique au 18e siècle avaient une logique d'Eglise française, opposée aux jésuites et au Vatican, voire soutenant la révolution française en représentant les intérêts du bas-clergé...
Pourquoi Blaise Pascal peut-il viser les jésuites de manière aussi forte ? Il ne peut, de fait, le faire que parce que le jansénisme qu'il propage a un noyau idéologique suffisamment fort pour cela. Cela nous ramène à la question de la genèse du jansénisme, qui va nous expliquer l'indépendance idéologique du jansénisme par rapport à la noblesse et à l'Église.
En fait, la plupart des grandes villes de Flandres, du Brabant et de la principauté de Liège sont historiquement des « villes à charte ». Ces chartes, achetées à grand prix, leur conféraient des droits communaux forts, ainsi qu’une certaine indépendance vis à vis de la féodalité...
Jansénius a donc agi aux Pays-Bas, dans un contexte différent de celui de la France. Mais si sa conception avait un intérêt pour des gens en France, c'est qu'elle répondait à leurs attentes. Ce qui est en jeu en fait, dans la défense du jansénisme ou plus exactement de l'abbaye de Port-Royal, c'est l'offensive anti-jésuite.
Ainsi, si les deux premières lettres avaient exposé le contenu théologique de l'affaire, Blaise Pascal profite du succès des lettres – et avec lui l'équipe de Port-Royal qui supervise leur contenu – pour déplacer le débat, pour l'accentuer et attaquer les jésuites en tant que jésuites, ce qui est par ailleurs le véritable objectif fondamental de Port-Royal...
Pour comprendre la position du jansénisme sur la grâce de Dieu, il faut voir comment celui-ci est né.
Le terme de jansénisme vient de l’évêque de la ville flamande d'Ypres, Cornelius Jansen (1585-1653), qui a donné son contenu à ce courant religieux. En français, il fut appelé Jansénius. Ses idées elles-mêmes sont en continuité de celles de Michael Bajus (1513-1589), un professeur de l'université de Louvain, connu en France sous le nom de Michel De Bay...
Pour comprendre ce qu'est le jansénisme, il faut saisir ce qui s'est déroulé précisément dans la France du XVIIe siècle, et pour cela étudier la constitution de la polémique provoquée par les lettres écrites par Blaise Pascal et appelées Provinciales. En effet, chacune d'entre elles révèle un aspect particulier permettant de comprendre le jansénisme en tant que phénomène.
Publiées anonymement et diffusées une par une, elles racontaient la répression contre les jansénistes, telle que contée par un parisien à quelqu'un en province. Le tirage, clandestin, passa rapidement de 2000 à 10 000 exemplaires. Elles furent ensuite rassemblées sous le titre de Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces Pères...
C'est un phénomène historique qui a eu relativement peu d'importance en France, voire qui a été insignifiant. Pourtant, il a exercé une fascination continuelle dans la petite-bourgeoisie intellectuelle. Cela est tellement vrai que les professeurs de français, en classe de première, y accordent encore aujourd'hui systématiquement toute leur attention.
Il y a une bonne raison pour cela : le jansénisme possède, en son cœur, quelque chose qui frappe la petite-bourgeoisie intellectuelle, qui l'attire, qui exerce une fascination qui ne s'est jamais démentie. C'est une forme ambiguë, une manière de voir les choses qui aboutit à une démarche visant à faire pression, pas à contester ou à révolutionner...
Qu'est-ce que le révisionnisme ? C'est modifier le marxisme, l'histoire du mouvement révolutionnaire, les valeurs révolutionnaires, afin d'en changer la substance. L'objectif, c'est la négation de la révolution et la soumission au capitalisme.
C'est un processus objectif, dont les porteurs n'ont souvent nullement conscience. L'esprit d'escroquerie est tel, cependant, au bout d'un moment, que les révisionnistes comprennent bien qu'ils sont des escrocs...
L'union UGT-CNT et le renforcement de l'unification des forces dans le régime républicain ne pouvaient pas aller sans contradictions, dont la première victime fut Francisco Largo Caballero. Son positionnement visant à placer le PSOE comme seul guide au-delà de la mêlée ne pouvait plus fonctionner après la crise de 1937, qui le voit être remplacé par Juan Negrín, également du PSOE.
Ce dernier était moins à gauche politiquement, mais il était un fervent partisan de l'unité républicaine, de l'unification des forces, de leur rationalisation...
Ce qui caractérise l'Espagne républicaine, c'est la prédominance de l'esprit révolutionnaire, les masses s'engouffrant dans les organisations de gauche, mais aussi dans les deux syndicats : l'Union General de Trabajadores (UGT) fondé en 1888 et lié au PSOE, la Confederacion National del Trabajo (CNT), fondée en 1910 et ayant comme objectif le communisme libertaire.
La lutte contre le fascisme avait galvanisé les masses, renforçant leur détermination, mais aussi leur conscience de la situation. Deux dynamiques s'entrecroisaient alors, se soutenant et se confrontant...
Au début de l'année 1937, l'Espagne républicaine est sur la défensive ; elle a su défendre Madrid, elle profitait de l'aide de l'U.R.S.S. et des Brigades Internationales, mais l'initiative restait dans le camp du putsch de Fancisco Franco. Le 8 février, l'armée putschiste prenait ainsi l'importante ville de Málaga, pratiquant meurtres et viols en masse, au point d'horrifier l'armée italienne.
Lors de cette bataille, les milices, la plupart anarchistes, n'étaient pas réorganisées dans l'Armée Populaire Républicaine, et n'appliquaient pas des méthodes modernes : on ne trouvait ni tranchées, ni barrages. C'était un exemple, parmi tant d'autres, de l'esprit anarchiste refusant le centralisme et les grades, au profit de l'esprit milicien...
Deux forces principales existaient à gauche au moment du coup d’État militaire de Francisco Franco : le gouvernement, d'esprit libéral-démocratique et socialisant, ainsi que la CNT. Le premier entendait maintenir le régime, suivant une ligne de front antifasciste, sans armer les masses pour autant ; la seconde entendait armer les masses, mais sans se préoccuper du régime ni du front antifasciste.
Les deux furent obligés de composer, en raison de la situation : sans un régime centralisé, on ne pouvait faire face à l'armée de Franco et sans les masses, la lutte était impossible...
Il n'est pas possible de comprendre la guerre d'Espagne sans saisir climat de terreur et de contre-violence systématiques qui ont régné. La situation était marquée par des urgences, des choix difficiles pour les républicains, alors que la ligne de l'armée de Francisco Franco était exterminatrice et justifiée idéologiquement, depuis 1937, par les Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, fusion idéologique des troupes d'extrême-droite pour mobiliser la population dans une orientation désormais fasciste.
On a un exemple parlant de la violence régnant alors avec les troupes basques décidant en 1936 de capituler face à l'armée de Francisco Franco à San Sebastián, afin de préserver la ville de la destruction, et exécutant les miliciens anarchistes opposés à la reddition...
L'U.R.S.S. ne se contenta pas de fournir des armes, ainsi que de très nombreux conseillers militaires afin de suppléer à l'absence de cadres dans l'armée, ceux-ci état en écrasante majorité passés au coup d’État. Elle lança également, par l'intermédiaire de l'Internationale Communiste, à la mise en place de Brigades Internationales.
Le 16 octobre 1936, Staline avait envoyé le télégramme suivant au secrétaire général du PCE, Jose Diaz, qui fut publié dans le Mundo Obrero (Monde ouvrier) et annonça l'esprit de l'initiative...
Sur lesmaterialistes.com, on trouve de très nombreuses archives de la Gauche Prolétarienne et de son organe de presse La cause du peuple.
La « GP » a joué après mai 1968 un rôle historiquement très important dans la réaffirmation de la confrontation prolétariat-bourgeoisie, et le PCF(mlm) en est le prolongement à travers un vaste détour historique. Connaître les grandes lignes de l'histoire du PCF (1920-1953) et de la GP est le bagage minimum de toute personne authentiquement révolutionnaire en France...
La guerre d'Espagne fut une guerre défensive des progressistes ; il y eut bien entendu des avancées sociales et culturelles considérées comme nécessaires par tout le monde, mais les exigences étaient fort différentes et l'aspect principal était celui la dimension protectrice.
Il s'agissait de faire front, ce qui n'allait pas sans contradictions donc puisque les exigences des uns ou des autres pouvaient entrer en conflit avec le processus...
Les forces libérales de gauche et républicaines firent le choix de refuser le coup d’État, mais les masses populaires elles-mêmes prirent immédiatement l'initiative, l'UGT et la CNT déclarant une grève générale.
A Barcelone, la CNT avait lancé la bataille pour le contrôle des arsenaux, alors que s'opposait au coup d’État les organismes policiers qu'étaient la Garde Civile et la Garde d’Assaut...
La libération des 30 000 prisonniers politiques par le Front populaire et l'instauration d'un gouvernement de centre-gauche soutenue par la gauche apparaît immédiatement comme une tendance terrible pour les forces conservatrices, car montrant le Front populaire capable d'une grande stabilité de par sa conquête du centre et d'un grand élan de par le renforcement de la gauche révolutionnaire.
Initialement, la République apparaissait comme une sorte de tampon entre les forces conservatrices et progressistes ; dans ses deux premières années, la répression républicaine avait fait à gauche 400 morts, 3.000 blessés, 9.000 arrêtés, 160 déportés, 160 saisies de journaux ouvriers (et 4 de journaux d'extrême-droite). Le Front populaire apparaissait comme un changement dans le précaire équilibre, d'autant plus que cela succédait à la tentative échouée de l'extrême-droite de faire pencher la balance dans l'autre sens...
Lorsque diverses affaires ébranlèrent le gouvernement en 1936, notamment une affaire de roulette truquée (le Straperlo) soutenue par le ministre de l'intérieur, le président préfère dissoudre l'assemblée que nommer le dirigeant de la CEDA, José María Gil-Robles, comme premier ministre. Un tel triomphe de la CEDA aurait amené une atmosphère de guerre civile et seules des élections pouvaient vérifier quel était le rapport de force.
Or, la situation était particulièrement tranchée, tant depuis la répression massive suivant la révolution des Asturies en Espagne qu'avec l'exemple terrible du national-socialisme allemand. Par conséquent, la gauche fit en sorte de s'unir, au sein d'un Front populaire...
La « révolution des Asturies » marqua très profondément les masses populaires espagnoles et posa un lourd problème à la CNT. La CNT avait, en effet, participé comme observateur à la réunion secrète à Saint-Sébastien qui avait mis en place le principe de renversement du régime.
Si elle avait soutenu indirectement l'initiative, elle avait par contre ouvertement appelé à l'abstention aux élections de 1933, contribuant clairement à la victoire électorale des forces conservatrices, qui avaient mené une répression importante, notamment contre la CNT...
La question de l'alcool fut une question importante au sein du mouvement ouvrier, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
C'est bien sûr dans la social-démocratie allemande qu'on trouve le plus de recherches approfondies sur cette question, deux positions s'exprimant : celle qui considérait qu'il fallait lutter de manière offensive contre la consommation d'alcool et celle qui considérait que la consommation d'alcool disparaîtrait avec le socialisme, la question étant alors relativement secondaire...
Le maintien de la féodalité permit aux forces conservatrices de maintenir leur existence et de se restructurer. Elles se fédérèrent rapidement après leur défaite de 1931 et dès 1933 exista une Confederación Española de Derechas Autónomas (Confédération Espagnole des Droites Autonomes – CEDA), rassemblant de multiples courants et disposant également d'une Juventudes de Acción Popular, section de jeunesse pratiquant le combat de rue.
L'impact fut tel que les élections parlementaires de 1933 – les premières où les femmes pouvaient également voter – furent une défaite terrible pour le gouvernement. La gauche obtint un peu plus de 3,1 millions de voix, les conservateurs un peu plus de 3,3 millions de voix, les centristes un peu plus de 2 millions de voix...
La seconde république était portée par un arc allant du PSOE à la droite libérale, en étant soutenue au moins indirectement par les révolutionnaires communistes et anarchistes. Cela suffisait pour abattre la monarchie ayant échoué dans son programme de corporatisme avec Miguel Primo de Rivera, mais les défis restaient de taille.
Pour ce faire, le régime était monocaméral : l'assemblée élue permettait la formation d'un gouvernement capable de prendre des décisions fortes, avec un président servant de « soupape de sécurité » en pouvant procéder, deux fois, à la dissolution de l'assemblée...
La chute de la réforme générale par Miguel Primo de Rivera scella la fin du régime. A son départ, c'est le général Dámaso Berenguer, chef de la maison militaire du roi, qui prend le relais ; la période où il gouverna fut ensuite appelée la « dictablanda », « blanda » signifiant molle et remplaçant « dura », « dure », dans le mot dictature en espagnol (« dictadura »).
Il est remplacé finalement par l'amiral Juan Bautista Aznar-Cabañas, qui est obligé de gérer une transition, la bourgeoisie ne soutenant plus le régime. Un comité fut même fondé en août à Saint-Sébastien pour organiser un soulèvement...
L'armée avait un rôle essentiel dans l’État espagnol, servant de colonne vertébrale à un régime caractérisé par la toute-puissance des caciques locaux. C'est la raison pour laquelle le général Miguel Primo de Rivera (1870-1930), capitaine général de Catalogne, organisé un pronuciamento, c'est-à-dire un coup d’État militaire.
Dans son Manifeste « au pays et à l'armée », le 13 septembre 1923, Primo de Rivera appela à se débarrasser de « la propagande communiste impunie », de « l'impiété et de l'inculture », de « l'indiscipline sociale », de « la justice influencée par la politique ». Par conséquent, c'est un directoire militaire qui prend le contrôle du pays, pendant deux ans, puis un directoire civil...
La réaction avait dû accorder en 1869 une constitution libérale ; avec l'échec de la République, la constitution de 1876 qui la remplace rétablit un ordre particulièrement autoritaire.
C'est l'armée qui a rétabli la dynastie des Bourbons et placé Alphonse XII sur le trône ; à côté de la chambre des députés, avec élections au suffrage universel pour les hommes, on a un sénat résolument féodal, composé de la famille royale, des grandes familles aristocratiques, des plus hauts responsables ecclésiastiques, des dirigeants de l'armée, des plus hauts membres de l'administration, ainsi que de personnes nommés à vie par le roi et de membres élus au suffrage indirect par les grands corps d’État et les plus riches contribuables. On a ainsi un système féodal renouvelé, où prédominent les « caciques », des figures féodales locales ayant pratiquement tout pouvoir décisionnaire...
La guerre d'Espagne a été un des grands événements du XXe siècle ; depuis notre pays, nous avons assisté pratiquement aux premières loges à cette grande bataille entre d'un côté les forces conservatrices et fascistes, de l'autre les forces républicaines et démocratiques.
Pour comprendre la signification de cette guerre, qui a tellement marqué les esprits, il faut saisir la nature de l'Espagne à cette époque. Ce pays a connu une histoire particulièrement tourmentée, en raison des succès de la féodalité suite à sa « découverte » de l'Amérique, et par conséquent l'absence de révolution bourgeoise démocratique comme en France...
Comme on le sait, le matérialisme dialectique enseigne qu'il existe le schéma historique suivant : féodalisme => capitalisme => socialisme. A chaque fois, un mode de production en remplace un autre. Ce développement en étapes historiques est historiquement été présenté par Karl Marx et Friedrich Engels.
Toutefois, conformément à la loi matérialiste dialectique du développement inégal, ce processus de développement apparaît comme particulièrement tourmenté dans certains cas...
Dans cette conjoncture de transition, la caractéristique dominante du programme politique général est la conquête des masses à la lutte armée et leur organisation sur ce terrain, les deux étant des conditions essentielles pour le passage à la phase de la guerre civile général.
Ce passage n'apparaît pas comme objectivement possible sans que soient patiemment formés tous les instruments organisationnels que la situation requiert. C'est-à-dire tant que le prolétariat métropolitain n'a pas conquis la capacité politico-militaire de manifester sa force dans un mode unitaire, mais également dans ses formes multiples que sa structure complexe revendique...
La révolution française était ainsi sur le plan du contenu bien plus proche d'Henri IV, de par les forces sociales en action. Le grand paradoxe est que le protestantisme fut utilisé pour moderniser l'appareil d'État, contre les forces anciennes de la féodalité, mais que le protestantisme fut abandonné par pragmatisme.
Henri IV se plaçait clairement au-dessus des religions et il ne reconnaissait leur existence que dans une logique pratique. En ce sens, il annonce absolument Richelieu. Il développe l'économie politique de la monarchie absolue et il contribue à donner à la culture politique française le culte du sens politique, du « flair »...
Au moment de l'Édit de Nantes, le régime est pacifié, d'une manière telle que les esprits en sont durablement frappés. Dans son Théâtre d'agriculture et ménage des champs, Olivier de Serres y parle d'une population qui « demeure en sûreté publique, sous son figuier, cultivant sa terre, comme à vos pieds, à l'abri de Vôtre Majesté, qui a à ses côtés la justice et la paix ».
Une formule d'Henri IV passa à la postérité, donnant de lui une image paternaliste, celle d'un souverain soucieux de son peuple : « Si Dieu me prête vie, je ferai qu’il n’y aura point de laboureur en mon royaume qui n’ait les moyens d’avoir le dimanche une poule dans son pot ! »...
La question du pouvoir d'État était bien entendu fondamental, au-delà des réformes économiques, même si bien sûr les deux sont dialectiquement liées puisque Henri IV apparaît comme celui qui historiquement doit résoudre la crise de croissance de la monarchie absolue.
Une figure essentielle fut ici le protestant Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), qui fut extrêmement proche d'Henri IV et dont une phrase est ici très connue : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. »...
Articles de Paul Lafargue, intitulés Les luttes de classes en Flandre de 1336-1348 et de 1379-1385
Paru en deux parties dans l'Egalité, 22 et 29 janvier 1882.
L'Édit de Nantes fut le point de départ du rétablissement de l'ordre royal, ce qui signifie pour la population principalement la remise en ordre de l'agriculture, et pour la bourgeoisie la possibilité de produire et de commercer.
Ce rétablissement de l'ordre, à ce moment de l'histoire de France, signifie le renforcement de la base nationale, par le renforcement du marché national s'étant développé et ayant permis à François Ier d'apparaître comme figure historique...
L'Édit de Nantes est promulgué le 13 avril 1598. Il a fallu deux années de négociation pour arriver un texte acceptable ou tout au moins relativement gérable par le pouvoir royal, aux dépens des factions catholique et protestante.
Trente années de troubles provoqués par d'incessantes guerres de religion et d'influences extérieures imposaient au pouvoir royal, pour se maintenir, de stabiliser à tout prix la situation, au moins pour un temps. La dimension nationale l'emporterait : en pratique, c'est sur la bourgeoisie que mise la monarchie absolue...
Ayant installé son gouvernement en Touraine après l'échec de la prise de Paris, Henri IV parvient à lancer une offensive militaire et à écraser la Ligue à Ivry en mars 1590. La question nationale, permise dans son existence même par la monarchie absolue, va alors se poser dans toute son ampleur.
Le soutien espagnol provoque un trouble certain sur le plan de la conscience nationale, qui saisit que l'éventuel succès de la Ligue renforcerait l'Espagne aux dépens de la France, voire briserait la France, en renforçant la féodalité de type médiéval...
Successeur de Henri III, Henri de Navarre procède par étapes. Tout d'abord, il lui faut trouver un terrain d'entente avec le pape et les catholiques, tout en contournant la faction catholique française alliée au roi d'Espagne.
C'est la seule possibilité de rétablir une stabilité politique et économique relative, et par là relancer le processus de monarchie absolue...
La question n'est donc nullement le simple rapport catholicisme – protestantisme. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on est déjà dans une situation où la féodalité de l'ancien Moyen-Âge disparaît. La monarchie absolue est déjà présente en grande partie. C'est la raison pour laquelle les états généraux n'ont pas été convoqués de 1484 à 1560.
Le régime est déjà centralisé, et se forge un appareil d'Etat qu'il lui faut assumer. La création de postes administratifs rémunérés, mais exigeant un prix d'entrée, provoque une explosion des salaires à payer : on passe de 1,2 millions de livres par an à cinq millions en 1585...
Le matérialisme dialectique enseigne non seulement que le moteur d'un phénomène est sa contradiction interne, mais également qu'il y a plusieurs aspects, dont un seul est le principal. Bien entendu, l'aspect principal peut changer, et le saisir est la clef pour comprendre le phénomène.
Saisir les événements en rapport à l'Édit de Nantes demande donc une grande précision, car il ne s'agit nullement de voir les choses comme un simple affrontement entre catholiques et protestants...
Au moment de l'Édit de Nantes, le pouvoir royal dispose d'une base nationale permise par la naissance d'un marché mis en place par le capitalisme naissant. Il s'élance dans la monarchie absolue par la synthèse nationale, à travers l'administration et l'armée.
Toutefois, autant le catholicisme semble une force sociale toujours plus faible, autant le protestantisme a une base problématique pour la monarchie absolue, dans le cadre français...
L'Édit de Nantes est un épisode historique d'une très grande importance dans l'histoire de notre peuple. La France a connu de multiples épisodes de guerres de religion entre catholiques et protestants, et cet édit a été un moment de vivre ensemble particulièrement notable, avant que le protestantisme ne soit ensuite pratiquement définitivement pourchassé et anéanti dans notre pays.
Toutefois, la connaissance de cet épisode historique capital pour le développement culturel de la France exige également de comprendre l'importance de la monarchie absolue, qui s'élance précisément avec François Ier, se développe à travers Henri IV et son Édit de Nantes, pour culminer avec Louis XIV...
La liberté individuelle de circulation est un concept bourgeois qui s'oppose au principe de la gestion planifiée de la production en harmonie avec la biosphère.
L'immigration et l'émigration des travailleurs sont autant inséparables de l'essence du capitalisme que le chômage, la surproduction et la sous-consommation des travailleurs.
La social-démocratie a historiquement déjà abordé la question de l'émigration et de l'immigration.
Il y a 500 ans a eu lieu une bataille capitale pour l'histoire de notre nation : celle qu'on a retenu sous le nom francisé de Marignan, et qui s'est déroulé en Italie non loin de Melegnano, près de Milan. Des générations d'écoliers ont appris à associer la date et le lieu, la formule devenant pratiquement le symbole du début de la France.
« Marignan, 1515 » est effectivement bien le symbole de la naissance de notre nation...
La multiplication du nombre de réfugiés, en plus de celui des migrants, est une conséquence inéluctable de la domination impérialiste.
Il existe une différence fondamentale entre les migrants et les réfugiés
L'importance toujours plus grande des transferts de fond témoigne qu'au-delà du rêve américain se profile le désir d'accumuler à tout prix du capital pour vivre tel un « colon » dans son propre pays d'origine, ou au moins d'y jouer un rôle semi-colonial.
Les pays semi-coloniaux semi-féodaux connaissent un pillage généralisé de leurs forces vives et une tentative impérialiste de suppression de la possibilité d'établir une solide souveraineté nationale intellectuelle, culturelle et scientifique.
L'existence d'une population immigrée importante dans un pays capitaliste s'accompagne d'un phénomène dialectique, dont les deux aspects sont d'un côté le harcèlement raciste, de l'autre l'établissement d'un communautarisme semi-féodal.
La non-reconnaissance de ce phénomène est propre à la fois à l'extrême-droite et au post-modernisme, dans leur négation commune du matérialisme dialectique...
 Le déplacement de centaines de milliers de personnes depuis les pays semi-coloniaux semi-féodaux vers les pays capitalistes n'est pas réellement propre au cycle d'accumulation du capital commencé en 1945, car le phénomène existait à différents niveaux auparavant.
Le déplacement de centaines de milliers de personnes depuis les pays semi-coloniaux semi-féodaux vers les pays capitalistes n'est pas réellement propre au cycle d'accumulation du capital commencé en 1945, car le phénomène existait à différents niveaux auparavant.
Le processus d'éviction des paysans de leur terre n'est pas valable seulement pour le capitalisme au sein d'un pays donné. C'est vrai aussi dans le cadre du rapport entre un pays où le capitalisme est développé, même relativement, et un pays où le capitalisme est bloqué, par la colonisation, imposant historiquement une forme semi-coloniale semi-féodale.
Le processus de l'exode rural a été largement analysé par Karl Marx, dans Le capital, où celui-ci décrit la naissance du capitalisme et donc les modifications de la situation dans les campagnes. Il raconte comment l'accumulation du capital fut possible justement en brisant la production traditionnelle dans les campagnes, en pourchassant les mendiants et vagabonds, en disciplinant les anciens paysans ayant quitté leurs terres.
Ici, le protestantisme a joué un rôle clef dans la rationalisation de la vie sociale, l'urbanisation des mœurs. Le calvinisme a été un vecteur essentiel pour les nouvelles moeurs...
Historiquement, les progrès techniques dans la production de biens manufacturés, ce qu'on appelle la « révolution industrielle », ont provoqué un déplacement massif de la population paysanne, ce qu'on appelle « l'exode rural ».
Cependant, cela est vrai dès le début de la croissance des bourgs, où vivent les bourgeois, c'est-à-dire les commerçants, artisans, marchands et négociants...
Les individus pensent choisir de se déplacer d'un endroit à un autre pour y habiter, que ce soit dans leur pays ou en allant dans un autre pays. C'est une illusion : en réalité, c'est la reproduction de la vie réelle qui décide, c'est-à-dire le mode de production. Les êtres humains sont de la matière, obéissant aux mouvements matériels au sein de la biosphère ; leurs consciences ne font que refléter les tendances inévitables du développement dialectique de la matière en transformation éternelle.
Le mode de production capitaliste, en particulier, a provoqué des déplacements matériels massifs et systématiques, en raison de ses besoins. Au-delà des déplacements de matières premières et de transformations agricole et industriel, il y a les mouvements migratoires.
6. Cela introduit une autre question : la Ligne de Masses de l'Organisation, à savoir la question du Programme de Transition au Communisme, de ses Formes Conjoncturelles et de ses Formes Immédiates.
Sans un Programme de Transition au Communisme, qui explique les objectifs sociaux de la guerre, il n'est pas possible de localiser toutes les composantes prolétariennes qui y sont objectivement intéressés.
Thomas Hobbes (1588-1679) a été proche du pouvoir politique en Angleterre et il est surtout connu pour avoir fourni une conception idéologique de l’État conforme aux exigences royales, par opposition aux perspectives de John Locke et David Hume, qui bien qu'allant dans le même sens ne soulignait pas assez les caractéristiques propres à l'Angleterre et sa monarchie intégrant les capitalistes aux côtés des aristocrates.
Thomas Hobbes est tout à fait sur le terrain de l'empirisme anglais, et dès le début de son ouvrage majeur, Le Léviathan, on lit :
« L'origine de toutes nos pensées est ce que nous appelons SENSATION, (car il n'est nulle conception dans l'esprit humain qui n'ait été d'abord, totalement ou par parties, causée au niveau des organes de la sensation). Les autres dérivent de cette origine...
L'écossais David Hume (1711 - 1776) est, avec John Locke, Francis Bacon ou encore George Berkeley, la grande figure de l'empirisme, et plus précisément ici de l'empirisme dit « relativiste ». Il connut la fraction radicale du matérialisme français, car alors qu'il fut secrétaire d'ambassade à Paris, de 1763 à 1766, il fréquenta pas moins que Dens Diderot, Jean le Rond D’Alembert, Helvétius, Paul-Henri Thiry d'Holbach, et également Jean-Jacques Rousseau.
Un rapport plus continu et davantage élaboré fut par contre réalisé avec le grand théoricien du libéralisme économique, son ami Adam Smith, écossais comme lui...
Paul Mattick
"KARL KAUTSKY : DE MARX A HITLER" (1939)
Karl Kautsky est mort à Amsterdam vers la fin de 1938; il avait alors 84 ans. On a vu en lui le plus éminent théoricien que le marxisme ait compté dans ses rangs depuis la mort de ses fondateurs, et l'on n'exagérerait pas en soutenant qu'il en fut le plus représentatif. Kautsky unit en sa personne, de la manière la plus nette, les côtés révolutionnaires et les côtés réactionnaires de ce mouvement.
La figure de l'évêque irlandais George Berkeley (1685 – 1753) est connu dans le cadre du matérialisme dialectique par les multiples remarques explicatives que fait Lénine à son sujet dans Matérialisme et empirio-criticisme, y opposant la démarche de Diderot.
Georges Politzer, dans ses Principes élémentaires de philosophie, a tenté de résumer la conception de George Berkeley. Il explique comment George Berkeley part de l'empirisme, en acceptant de se fonder uniqueent sur les sens, pour aboutir à la conclusion que puisqu'il y a un esprit recevant les informations des sens, seul l'esprit compte, le reste étant illusion...
John Locke est le véritable fondateur du libéralisme en politique. Puisqu'en effet chaque individu a ses propres sens, alors il faut le laisser libre. Lui-même ne doit admettre une structure politique que dans la mesure où elle lui permet de s'épanouir comme acteur libre, c'est-dire comme capitaliste.
Ce qui relève de la morale, des valeurs, tout cela relève des individus, dont les contrats sont à la base de tout, tant des affaires que de l’état. Le pouvoir politique ne vient pas de Dieu, mais des hommes propriétaires, et il consiste en une délégation pour que la société soit coordonnée de la manière la meilleure possible...
John Locke (1632-1704) est la grande figure de l'empirisme anglais, parce qu'avec lui il triomphe politiquement, sous la forme du libéralisme. L'idéologie capitaliste de la monarchie constitutionnelle anglaise se confond tellement avec ce penseur que Voltaire dira qu'entre Platon et lui, il ne s'est rien passé en philosophie.
Avec John Locke, on a d'une certaine manière le « scotisme », la pensée de Jean Duns Scot, qui ressurgit triomphalement en ayant attendu son heure. Cette heure, c'est bien sûr la période de l'histoire où la bourgeoisie peut exiger une vision du monde conforme à ses intérêts...
1. L'actuelle conjoncture politique se trouve entre deux phases : nous ne sommes plus dans la phase de la propagande armée et pas encore dans celle de la guerre civile. Il s'agit ainsi d'une conjoncture de transition.
Nous devons accorder une grande attention aux particularités et aux contradictions caractérisant cette conjoncture et ne pas sous-estimer le fait que la transition de l'une à l'autre peut également être prolongé dans le temps...
Pour comprendre l'importance du matérialisme anglais, il faut saisir la signification d'une bataille idéologique de grande ampleur ayant eu lieu au Moyen-Âge.
Ce qui a été appelé historiquement la « querelle des universaux » fut, en effet, un élément clef de l'histoire. Avec l'irruption des œuvres d'Averroès en Europe, c'est l'une des deux grandes dynamiques médiévales permettant l'affirmation du matérialisme...
Le romantisme français était un cul-de-sac. Né comme produit idéologique de la restauration monarchique, alors que son équivalent allemand était né à la base contre le formalisme aristocratique, il devait se révéler toujours plus improductif avec le triomphe du capitalisme et la disparition de l'aristocratie.
Certains, tel Victor Hugo, rejoignirent alors le camp de la république, mélange de démocratie-chrétienne et de réformisme social-républicain. D'autres, par contre, basculèrent dans une décadence « fin de siècle » aux relents mystiques, qui sera appelé le « symbolisme »...
Emmanuel Kant, en tant qu'auteur des Lumières, a donc théorisé la toute-puissance de l'entendement. Dans un texte fameux de 1784, il appelle ainsi à l'autonomie de la pensée, dans un grand élan anti-féodal :
« Les lumières, c’est pour l’homme sortir d’une minorité qui n’est imputable qu’à lui. La minorité, c’est l’incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d’un autre. C’est à lui seul qu’est imputable cette minorité dès lors qu’elle ne procède pas du manque d’entendement, mais du manque de résolution et de courage nécessaires pour se servir de son entendement sans la tutelle d’autrui...»
La prise du pouvoir par le fascisme en Slovaquie est, d'une certaine manière, exemplaire pour le type de fascisme dont il s'agit ici. En l'occurrence, le fascisme slovaque consiste en un nationalisme porté par le catholicisme et résolvant ses manques dus à son existence abstraite en se posant comme satellite semi-colonial d'un impérialisme. Il est le produit d'un séparatisme coupant un pays en deux.
Historiquement, la Slovaquie a été une composante de l'empire autrichien, en étant elle-même une colonie de la Hongrie. Cette dernière parvint à se renforcer toujours plus dans l'empire, parvenant au « compromis » donnant naissance à l'Autriche-Hongrie...
Leonid Brejnev dirigea l'URSS de 1964 à 1982. A sa mort, c'est Iouri Andropov qui prit sa place, à 70 ans, après avoir été dirigeant du KGB de 1967 à 1982. A sa mort en 1984, il fut suivi de Konstantin Tchernenko, âgé de 73 ans, pourtant gravement malade. A sa mort en 1985, ce fut inversement une figure plus jeune qui prit la succession : Mikhaïl Gorbatchev, âgé de 54 ans.
Néanmoins, Mikhaïl Gorbatchev n'apporta rien de nouveau et ne fit qu'appliquer la ligne d'Andropov. Celui-ci avait compris que l'Union Soviétique allait s'effondrer. L'URSS donnait l'image d'une superpuissance, qu'elle était militairement, mais à moins d'une offensive militaire tout azimut à la fois contre l'Europe de l'Ouest et contre la Chine populaire, il était pratiquement impossible de s'en sortir...
La situation compliquée au début des années 1960 obligeait la nouvelle bourgeoisie « soviétique » à effectuer un choix. En 1957, le maréchal Joukov avait été démis de ses fonctions de ministre de la défense ; il avait sauvé l'installation de Nikita Khrouchtchev au pouvoir, mais il représentait l'armée qui était mise de côté par rapport aux bureaucrates ayant gravi les échelons en tant que techniciens, cadres, etc.
Nikita Khrouchtchev avait alors porté tous ses efforts sur le nucléaire, les missiles intercontinentaux et la course à l'espace, avec les succès du Spoutnik et du voyage spatial de Youri Gagarine. Il pensait parvenir à développer rapidement l'URSS de cette manière, d'où ses célèbres phrases grandiloquentes comme quoi l'URSS dépasserait très vite les Etats-Unis et entrerait même dans le communisme à court terme...
Dès l'accession de Nikita Khrouchtchev au pouvoir, celui-ci s'attacha à développer des liens commerciaux nouveaux dans les pays du « tiers-monde », pratiquant l'ouverture diplomatique générale, envoyant conseillers, professeurs, techniciens, dans de multiples pays, notamment africains.
Il fit notamment une tournée en 1955 en Afghanistan, en Birmanie, en Inde, en Indonésie. Voici comment, en décembre 1958, le rapport de la délégation soviétique à la conférence du Caire (menée par Arzumanân) « résume » les propositions soviétiques aux pays du « tiers-monde »...
Nikita Khrouchtchev a eu énormément de mal à gérer l'avènement définitif de la nouvelle bourgeoisie née en URSS. Il fallait aller vite de l'avant, tout en liquidant les forces révolutionnaires et sans provoquer d'instabilités trop fortes. Il fallait d'un côté faire semblant de préserver le cadre soviétique et en même temps aménager les meilleures conditions pour le développement de la bourgeoisie.
C'était un jeu d'équilibriste, demandant des changements rapides et des répressions, dans une atmosphère idéologique et culturelle incohérente, avec des failles économiques gigantesques....
Le rétablissement du capitalisme dans les campagnes ne cessa de se renforcer. Ainsi, en 1964, les kolkhoziens pouvaient posséder une vache, un veau plus les veaux nés dans l'année, une truie avec ses petits ou un porc « gras », trois moutons ou chèvres avec leurs petits (cinq au cas où il n'y aurait pas de vache ou de porc), des poulets et des ruches en nombre illimité.
L'acquisition d'une vache était aidée par un crédit d’État, les particuliers pouvaient directement acheter du fourrage d’État, ainsi que faire paître les vaches sur les terres publiques. Les impôts sur le bétail possédé par les citadins disparurent ; les prix de vente sur le marché privé étaient libérés.
La possession de lopins de terre à cultiver était de plus en plus autorisé pour tous, et devenait même une obligation pour les instituteurs, les médecins et les techniciens vivant et travaillant dans les campagnes...
 Après le triomphe du 20e congrès, Nikita Khrouchtchev formula ouvertement son plan de transformation de l'économie soviétique, tout d'abord dans un rapport au Comité Central du Parti Communiste d'Union Soviétique le 14 février 1957, puis le 30 mars 1957 dans quatre pages, résumant ce rapport, publiées dans la presse.
Après le triomphe du 20e congrès, Nikita Khrouchtchev formula ouvertement son plan de transformation de l'économie soviétique, tout d'abord dans un rapport au Comité Central du Parti Communiste d'Union Soviétique le 14 février 1957, puis le 30 mars 1957 dans quatre pages, résumant ce rapport, publiées dans la presse.
Après 1945, les thèses soviétiques étaient que les contradictions inter-capitalistes s'exacerberaient, que la tendance à la guerre deviendrait de plus en plus forte, que l'impérialisme américain était à la tête d'opérations de sabotages, d'infiltrations et d'agression contre l'Union Soviétique.
Par conséquent, il fallait mobiliser les masses sur des thèmes anti-guerre, ainsi que prôner l'interdiction de l'arme atomique. Ces considérations s'appuient sur la thèse du matérialisme dialectique comme quoi l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, produisant la guerre et le fascisme.
Cependant, Nikita Khrouchtchev représentait une clique de bureaucrates et de carriéristes au sein du Parti, de l'industrie et de l'armée, qui n'avaient par conséquent aucunement envie d'assumer un conflit idéologique ouvert, avec les pays capitalistes, ni de s'engager de manière militante dans le soutien à des processus révolutionnaires où les Partis Communistes s'engagent les armes à la main...
L'espagnol Pablo Picasso (1881-1973) est un peintre membre de « l'avant-garde » décadente du début du XXe siècle, principalement du courant cubiste qu'il a contribué à fonder, avant de participer de manière décisive à ce qui deviendra l'art abstrait.
Menant une vie de bohème à la manière d'un millionnaire, Pablo Picasso était très proche du Parti Communiste français, qui combinait thorézisme et une ligne culturelle justement tournée vers les courants cubistes – futuristes – surréalistes qui avaient été catégoriquement rejetés par le réalisme socialiste en URSS...
Le XXe congrès du Parti Communiste d'Union Soviétique (PCUS) fut un moment clef de l'histoire de l'URSS.
Normalement, les congrès possédaient une large publicité, témoignant de la vie du Parti dirigeant la société. Les délégués débattent suite au rapport fait par la direction, une ligne est votée pour le futur et des dirigeants élus pour l'appliquer.
Le XXe congrès dérogea totalement à la règle, puisque le secrétaire du PCUS prononça un « discours secret ». Ce discours ne fut pas sténographié, et il fut même demandé aux 1400 délégués de ne pas en dévoiler le contenu...
À la mort de Staline en 1953, les éléments pro-capitalistes dans le Parti Communiste d'Union Soviétique lancent de vastes actions pour contrecarrer la « légalité socialiste » sous le masque du refus du « culte de la personnalité » et de la « bureaucratie ».
La mort de Staline s'est déroulée dans des conditions obscures ; il aurait connu une attaque cérébrale dans la nuit menant au premier mars, mais n'a pas été soigné, pour être déclaré mort le 5 mars.
Auparavant, il avait été isolé sur le plan de l'organisation. Alexandr Proskrebychev, son principal collaborateur depuis 1924, avait été mis à pied en 1952 sur la base d'une fausse accusation de vol de documents. Le responsable de sa sécurité depuis 1931, Nikolai Vlasik, fut pareillement écarté en 1952 sur la base d'une fausse accusation, cette fois de complot...
Le sujet de notre travail n'est pas l'analyse-critique de l'U.R.S.S. « en tant que Pays socialiste » comme si l'Union Soviétique était une formation socio-économique inconnue et inexplorée encore à l'heure actuelle: en réalité une étude avec des prémisses pareilles rentre dans des domaines différents de ceux que nous posons à la base de notre enquête politique.
De ce point de vue, la critique pratique des camarades chinois, indépendamment des aboutissements contre-révolutionnaires de la Révolution chinoise, représente aujourd’hui encore un patrimoine, non seulement pas encore atteint ailleurs, mais définitivement acquis.
Et ce n'est pas non plus l'analyse du « social-mpérialisme », parce que même en y recourant, nous ne considérons pas la catégorie du « social-impérialisme » comme une catégorie valable, capable de rendre compte, de façon exhaustive, de la complexité de la formation soviétique...
Le protestantisme est le prolongement direct du hussitisme. On doit même parler d'identité, ce que bien entendu seul le matérialisme dialectique est en mesure de constater. La forme et le contenu du hussitisme et du protestantisme sont en tout point similaire.
De fait, de la même manière qu'on y retrouve le rejet des images, on a une remise en cause des cérémonies religieuses traditionnelles et du rôle de l’Église et de son clergé.
Le vrai maître, c'est Jésus, qui parle à l'entendement, par conséquent tout doit tourner autour de lui. Son arrivée bouleverse la tradition qu'on trouvait dans l'Ancien Testament : désormais, chacun est égal face à Dieu...
 En tant que vision du monde, le calvinisme avait à réaliser une tâche très importante. Le mouvement hussite – à la base du protestantisme – avait attaqué vigoureusement l’Église catholique pour son utilisation des images, dégradant la dignité de Dieu afin de servir
En tant que vision du monde, le calvinisme avait à réaliser une tâche très importante. Le mouvement hussite – à la base du protestantisme – avait attaqué vigoureusement l’Église catholique pour son utilisation des images, dégradant la dignité de Dieu afin de servir
On comprend tout à fait pourquoi Jean Calvin a souligné l'importance de ce qui est pour les chrétiens l'Ancien Testament. En effet, s'il entendait mettre en avant une morale économique, il avait besoin d'un modèle de société, et inversement.
On ne trouve pas cela dans le Nouveau Testament, mais l'Ancien est parfaitement utile puisqu'on y trouve de représenté une communauté organisée sur de nouvelles règles. Il suffisait seulement de les interpréter de manière conforme aux exigences de sa propre époque.
Jean Calvin est ici quelqu'un qui produit une vision du monde, maniant de manière dialectique la forme idéologique et les exigences matérielles propres à la petite production s'élançant dans le capitalisme génétalisé...
Le calvinisme ne s'adresse pas qu'aux capitalistes en formation, il vise également à façonner les travailleurs libres. Chacun doit participer au grand projet entrepreneurial, à l'activité raisonnable, s'appuyant sur l'entendement.
Cette participation, on la retrouve donc dans le militantisme des pasteurs pour organiser une société marquée par de larges secteurs populaires marginalisées, issues des campagnes et formant une plèbe urbaine qui va être le futur prolétariat.
Pacifier cette plèbe fut une étape incontournable pour le développement franc du capitalisme. On a vu dans le hussitisme comment la plèbe avait joué un rôle historique de très grande importance, avec des tendances communistes...
Jean Calvin a fourni une œuvre dont la dimension économique est historiquement d'une importance immense. En fait, sa perspective est même celle d'un capitalisme organisé qui n'en est pas un ; il témoigne encore une fois ici d'une approche dialectique très poussée.
Son point de vue sur la banque est ici un exemple tout à fait pertinent dans ce cadre. Jean Calvin s'oppose ainsi formellement aux banques ; il a lutté pour qu'il n'y en ait pas à Genève...
Ce que dit Jean Calvin permet l'avènement de l'individu, en tant que forme sociale nécessaire pour le capitalisme. Il faut bien faire ici à ne pas réduire les positions de Jean Calvin à la base culturelle pour le développement des capitalistes, ce qui en ferait une religion des capitalistes pour les capitalistes.
En réalité la théologie de Jean Calvin est le reflet des besoins du capitalisme en tant que mode de production. Or, quels étaient ces besoins ? Ils ne consistaient pas seulement en l'apparition d'une nouvelle couche sociale ayant des pratiques adéquates : il faut également la couche sociale qui est son pendant dialectique...
Jean Calvin propose ici un paradoxe, l'être humain pourrait et devrait être bon, mais la chute d'Adam a bouleversé la donne :
« Nous disons donc que l'homme est naturellement corrompu en perversité : mais que cette perversité n'est point en lui de nature.
Nous nions qu'elle doit de nature, afin de montrer que c'est plutôt une qualité survenue à l'homme, qu'une propriété de substance, laquelle a été dès le commencement enraciné en lui : toutes les fois que nous l'appelons naturelle, afin qu'aucun pense qu'elle s'acquiert d'un chacun par mauvaise coutume et exemple, comme ainsi soit qu'elle nous enveloppe tous dès notre première naissance. »...
Jean Calvin considère que les « philosophes » ont eu raison de chercher ce qu'était l'entendement humain, mais que leur méconnaissance de la chute d'Adam les a empêchés de comprendre l'origine du problème.
Jean Calvin fait donc la même chose que Maïmonide ou Thomas d'Aquin : il considère que les philosophes, normalement rejetés catégoriquement par les religions, ont posé des problèmes intéressants, mais qu'ils ne pouvaient comprendre authentiquement.
On voit ici que les religions ne pouvaient plus exister sous leur ancienne forme féodale ; elles devaient élever leur niveau technique, intellectuel, théologique, s'adapter aux nouvelles conditions...
 Jean Calvin, malgré sa défense de l'entendement, n'est donc pas un matérialiste : il ne peut pas assumer le matérialisme. Il n'appartient pas à une société dont le mode de production s'est émancipé de la soumission à l'environnement. Son appel à l'entendement tout puissant correspond aux exigences de la bourgeoisie qui veut transformer, qui a commencé à le faire, mais qui n'a pas encore transformé l'ensemble de la réalité.
Jean Calvin, malgré sa défense de l'entendement, n'est donc pas un matérialiste : il ne peut pas assumer le matérialisme. Il n'appartient pas à une société dont le mode de production s'est émancipé de la soumission à l'environnement. Son appel à l'entendement tout puissant correspond aux exigences de la bourgeoisie qui veut transformer, qui a commencé à le faire, mais qui n'a pas encore transformé l'ensemble de la réalité.
On se doute que, forcément, par la suite les enseignements de Calvin changeront de sens pour la bourgeoisie une fois arrivée au pouvoir. En tout cas, à l'époque où il écrit, Calvin a besoin du concept de Dieu; il parle donc ouvertement des épicuriens, c'est-à-dire pour lui les matérialistes ; il aborde ouvertement les thèmes d'Aristote, qu'il reconnaît partiellement pour les contrebalancer par les thèses idéalistes de Platon...
Dieu produit la piété qui produit la religion – mais pourquoi Jean Calvin ne pense-t-il pas, tels les philosophes, que les êtres humains peuvent utiliser l'entendement – la piété – sans la religion ?
C'est parce qu'il a constaté que les esprits faisaient un fétichisme de leur capacité à raisonner. Le calvinisme n'est pas une idéologie de l'individualisme bourgeois, mais de l'individualité bourgeoise au sein de la société bourgeoise. C'est radicalement différent...
Le calvinisme a une image de grande rigueur et de grande exigence, dans un esprit particulièrement austère. Une telle approche est erronée et ne s'intéresse qu'aux apparences.
Si l'on veut comprendre la démarche de Jean Calvin, et son importance, il faut se concentrer sur comment Jean Calvin formule une théorie de la connaissance où la conscience a un rôle majeur. C'est ici que Jean Calvin révèle sa nature de classe révolutionnaire, portant la bourgeoisie qui alors brise les chaînes de la féodalité...
Ce qui caractérise la pensée de Jean Calvin, c'est l'affirmation de l'individu en tant qu'être autonome disposant de l'entendement. A l’Église catholique qui interdit de lire la Bible, réservant l'interprétation de celle-ci à une caste, Jean Calvin oppose les larges masses étudiant et lisant la Bible.
L'être humain, chez Jean Calvin, est capable de discerner le bien et le mal. Voici ce qu'il dit dès le début de son ouvrage majeur, l'Institution de la religion chrétienne (au français relativement modernisé ici pour faciliter la compréhension)...
L’État turc ne peut pas reconnaître le génocide arménien, parce qu'à la base même de son existence en tant que régime, il s'est construit sur un mythe politique, forgé par Mustapha Kemal dit Atatürk, le « père des Turcs ».
La nature du kémalisme en tant qu'idéologie à la base de l’État turc forcément fasciste a été analysé par Ibrahim Kaypakkaya. Né en 1949 et mort sous la torture en 1973, il n'a pas eu le temps d'aborder directement la question du génocide arménien. Cependant, il en explique l'arrière-plan dans les textes fondamentaux qu'il a écrit...
Il y a 70 ans l'Allemagne nazie signait sa reddition, à une heure tardive permettant une modification de date pour l'URSS en raison du décalage horaire. Les représentants allemands signent la reddition sans conditions à 23h16, au soir du 8 mai, ce qui fait que pour l'URSS la date est celle du 9 mai à minuit et seize minutes.
Ce décalage doit être compris dans le cadre de la magouille précédente des forces américaines, qui avaient accepté que la reddition de l'armée allemande soit signée dès le 7 mai à Reims en France, alors que l'URSS exigeait, avec raison, qu'elle soit signée à Berlin même, ce qui fut le cas lors du 8-9 mai.
Que l'armée allemande signe la capitulation dans sa capitale était pourtant un signe fort. Cela fermait toute une période, cela indiquait un chemin nouveau...
Pourquoi Jean Calvin est-il une figure absolument française, la plus progressiste du XVIe siècle, qui soit si peu connue en France ?
La raison tient à la victoire de la réaction catholique en France, formant un obstacle au progrès qui reste encore à surmonter. L'image de Jean Calvin a été noirci au possible, comme en témoigne la présentation qu'en fait Honoré de Balzac dans son roman Sur Catherine de Médicis, par ailleurs fascinant et qui décrit justement la période décisive pour l'histoire de France où le calvinisme a été écrasé...
De toutes les figures de l'histoire de France, Jean Calvin est celle dont l'impact culturel et idéologique a été le plus puissant. Pourtant, on pense plutôt à Maximilien Robespierre et Napoléon, ou encore Charles De Gaulle, quand on se réfère aux grandes figures de l'histoire de notre pays.
La figure de Jean Calvin reste obscure, voire inconnue ; dans la plupart des cas, si elle est un tant soit peu connue elle sera reliée au sectarisme, à un puritanisme fanatique, bref à une mort de la pensée et à des raisonnements opposés à la joie et aux sentiments.
Tout cela a une origine : le triomphe des forces féodales sur les forces progressistes portées par le protestantisme dont Jean Calvin a été le héraut, la figure la plus aboutie, la plus conséquente...
En commençant à écrire le présent livre, je n’avais pas l’intention, Sire, d’écrire quoi que ce soit à Votre Majesté : mon but était seulement d’enseigner quelques éléments simples, destinés à alimenter la piété de ceux qui éprouveraient le désir de servir Dieu. Je voulais, principalement, que mon travail soit utile aux Français, dont je voyais plusieurs avoir faim et soif de Jésus-Christ et bien peu le connaître comme il fallait. Ce projet ressort clairement du livre dans lequel j’ai utilisé la forme la plus simple possible d’enseignement. Mais, voyant que l’opposition de quelques personnes malintentionnées avait été telle en votre royaume qu’elle n’avait laissé aucune place à la saine doctrine, il m’a semblé expédient d’utiliser ce présent livre à la fois pour l’instruction de ceux que, tout d’abord, j’avais délibéré d’enseigner, mais aussi comme confession de foi, afin que vous connaissiez quelle est la foi contre laquelle s’élèvent ceux qui, par le feu et par le glaive, troublent aujourd’hui votre royaume. Je n’aurai aucune honte à reconnaître que je présente, ici, une sorte de résumé de cette doctrine que certains estiment devoir être réprimée par la prison, le bannissement, la proscription et le feu, et qu’ils déclarent avec insistance devoir être totalement éradiquée...
« Ce n'est pas un seul d'entre vous que j'appelle pour être juge ni un nombre limité, ni une multitude non plus ; je vous appelle au contraire tous à la fois à former un tribunal ; ce n'est pas la sentence de plusieurs d'entre vous que j'attends, c'est la sentence de tous...
Et si je vous appelle en nombre illimité, ce n'est pas pour vous faire décider du sort d'un seul homme, mais du salut du monde entier ; je ne vous mène pas devant l'autel d'une divinité fictive, mais devant la face du vrai Dieu vivant ... qui n'est pas le roi des guerres et des meurtres, mais de la paix et de la vie, et qui vous a comblés de ses présents pour vous confier la direction des affaires humaines ...
Comenius est l'auteur d'un ouvrage intitulé La grande didactique. Il est difficile de comprendre la dimension révolutionnaire de cet appel démocratique pour l'éducation des masses, puisqu'entre-temps celle-ci s'est réalisée, même si le plan de la contenu bien sûr la bourgeoisie devenue réactionnaire a imposé ce dont elle avait besoin.
Cette combinaison d'esprit démocratique absolu et de sens pratique est précisément ce qui fournit à Comenius sa dimension historique. Il assume l'humanisme et ne laisse strictement personne derrière, et en même temps il affirme qu'un rythme éducatif est possible pour tous et toutes, un rythme amenant une harmonie intellectuelle en suivant des formes appropriées. La lassitude ne peut tout simplement pas exister quand on apprend, si l'enseignement est adéquat...
« On y arrivera si tous apprennent à user de livres non pas comme de canapés qu'on déplace à loisir et où il faut si bon sommeiller, mais comme de véhicules qui les transportent rapidement vers le lieu où ils doivent parvenir, vers la sagesse.
Comenius exprime de manière magistrale la position matérialiste de l'esprit de synthèse. Il y a là un point historique d'une importance transcendante.
Il est intéressant de savoir ici que Comenius a vécu à la même époque que Descartes, et qu'il l'a rencontré. Les quelques heures de discussion n'ont abouti à rien, et pour cause. Descartes considère qu'il faut partir de l'individu et étudier le monde morceau par morceau, en partant de l'élément le plus simple.
Comenius, lui, fait comme Spinoza : il part du tout. Il est d'accord pour aller du simple au complexe, sauf que lui reconnaît la nature de « tout » à ce qui est complexe...
On sait à quel point l'obscurantisme religieux est un obstacle à la science, car il affirme qu'il faut partir de la « révélation » comme base « scientifique ». On trouve bien sûr chez Comenius la position matérialiste inverse ; s'il reconnaît la religion, il le fait toujours en la considérant comme base morale finale, nullement comme socle clérical.
Il affirme ainsi que dans l'enseignement :
« Il faudra procéder graduellement, en commençant par les choses matérielles, en continuant sa route avec les choses de l'esprit, et en la terminant par les choses révélées. »...
« Puisse l'école cesser d'être un labyrinthe, un bagne, une prison et un lieu de détresse, et puisse-t-elle commencer à être un stade, un palais, un festin et un paradis ! »
Tel est l'appel de Jan Amos Komenský (1592-1670), dit Comenius, qui n'est pas moins que le fondateur de la pédagogie.
Il y a 100 ans, le 24 avril 1915, Talaat Pacha, le ministre de l'intérieur du gouvernement « Jeunes-Turcs » de l'Empire ottoman, donnait l'ordre de rafler tous les intellectuels arméniens de Constantinople (l'actuelle Istanbul), lançant ainsi le génocide des Arméniens.
A la fin du XIXe siècle, il y avait à peu près 3 millions d'Arméniens en Anatolie. En 1914, avant le génocide donc, ils n'étaient déjà plus que 2 250 000 suite aux vagues de massacres et à l'exil. Au recensement de 1927, on n'en comptait plus que 64 000...
La philosophie française, née avec René Descartes, a cette particularité de se placer à ce qu'elle pense être à mi-chemin de l'idéalisme et du matérialisme, et donc d'être authentiquement rationaliste. C'est là une illusion profondément ancrée dans la société française, et qui provient du statut particulier de la France par rapport au Vatican, ce statut de grande autonomie.
La France est ainsi catholique, mais travaillée largement par le rationalisme, voire le matérialisme, et l'idéologie dominante maintient cette triste fusion, dont l'une des expressions est la cohabitation de l'école publique et de l'école privée...
Il y a 100 ans, en avril 1915, débutait le génocide des Arméniens par le gouvernement nationaliste turc de l'empire ottoman. Connaître cet épisode dramatique de l'histoire et faire vivre sa mémoire est une tâche importante pour toute personne progressiste.
Le génocide arménien fut le premier grand génocide du XXe siècle, organisé de manière méthodique, répondant à des objectifs précis. Tout comme l'Holocauste juif de la Seconde Guerre mondiale par le fascisme, le génocide arménien est le produit du nationalisme réalisant ses perspectives politiques dans le cadre moderne du capitalisme développé...
Il restait à Bergson de faire en sorte de placer, comme Descartes, les mathématiques au centre de la question de l'esprit. La vision bornée, anti-matérialiste du monde, a besoin de voir les choses en termes de statistiques pour comptabiliser les ressources, pour transformer chaque élément de la réalité en marchandises.
Bergson explique alors simplement que le monde est mécanique et que l'intuition, en quête d'action, trouve de manière naturelle ou logique les mathématiques, puisque celles-ci permettent l'action. C'est une vision classiquement planiste à la française...
De la conception de « l'élan » de la vie et de « l'intuition » de l'individu, on aboutit à une vision anthropocentriste et individualiste en même temps : chaque individu est poussé en avant par la vie comprise de manière mystique, chaque individu est issu de « l'élan », et les individus s'affrontent, les espèces s'affrontent.
Au lieu que les êtres vivants soient considérés comme la vie elle-même, ils sont considérés comme le produit matériel de l'élan de la vie...
Une fois sa base affirmée, Henri Bergson publia en 1907 L'Évolution créatrice, son œuvre maîtresse dans la mesure où il part de sa thèse sur l'intuition pour tenter de formuler pas moins qu'une théorie de l'univers.
Il ne s'agit, en pratique et c'est logique, que d'une réponse au matérialisme dialectique, réponse bien entendu en inversant tous les repères. Le matérialisme dialectique considère que :
* la matière connaît des sauts qualitatifs, elle devient toujours plus complexe, elle ne peut pas revenir en arrière ;
* la matière est unifiée, reliée et composant un système unique et total...
Si on suit Henri Bergson, l'esprit est donc encadré par les sens d'un côté, le « disque dur » de l'autre. Il maintient une position, totalement fictive, entre la reconnaissance matérialiste des sens et l'idéalisme complet. A ses yeux :
« La mémoire est autre chose qu'une fonction du cerveau, et il n'y a pas une différence de degré, mais de nature, entre la perception et le souvenir. »
...
Quand on lit Henri Bergson, on se dit qu'au final ses constructions n'aboutissent à rien de concret, voire de compréhensible. Quel est l'intérêt de son travail ? Eh bien son influence est en fait telle, que l'on peut dire que l'idéologie dominante en France est traversée par le bergsonisme en la plupart des points.
La manière dont la science est considérée en France relève du bergsonisme ; on dit que les Français sont cartésiens, on devrait dire que la France relève du bergsonisme.
Nous avons vu que, selon Henri Bergson, le cerveau est une sorte de processeur utilisant un disque dur : l'être humain est un esprit qui vit dans l'immédiat, et que dans l'immédiat...
Henri Bergson considère en pratique le corps humain à peu près comme on conçoit un ordinateur personnel aujourd'hui. Dans ce dernier cas, il y a trois éléments : la mémoire vive qui consiste grosso modo en la capacité de calcul de mémorisation de l'ordinateur lors de ses activités, cette mémoire s'effaçant quand on l'éteint.
Il y a ensuite la mémoire morte, contenant les données de démarrage de l'ordinateur (aujourd'hui on peut réécrire ces données donc la mémoire n'est plus vraiment « morte »). Et enfin, il y a le disque dur qui stocke les données.
Il y a bien entendu tout le reste, avec notamment la carte-mère, le processeur, etc : c'est ce qui est en quelque sorte pour Henri Bergson l'esprit...
Tout cela n'aurait rien d'original, si Henri Bergson n'était pas en mesure de dresser le constat, soi-disant, comme quoi l'intuition est précisément ce qui caractérise la nature humaine. Car c'est bien là la conclusion logique de son double refus de « l'idéalisme » et du « réalisme ».
Henri Bergson compare, en effet, le cerveau à un bureau téléphonique central, qui à l'époque consistait en une personne déplaçant des câbles pour les placer de telle manière que deux personnes puissent se parler au téléphone.
Il rejette l'idéalisme, en disant que le cerveau ne peut pas « créer » de représentations, d'images. Mais en même temps, il rejette que la conscience ne soit que le reflet de la réalité, de ces « images »...
Après avoir établi la base de sa position idéaliste sur la « durée » et la primauté de la conscience sur la matière, Henri Bergson tenta de systématiser son approche dans Matière et mémoire, dont le sous-titre est « essai sur la relation du corps à l'esprit », publié en 1896.
On est là dans le refus catégorique du « monisme », du caractère uniquement matériel du monde...
Il va de soi que l'éloge du subjectivisme va forcément de pair avec celui du libre-arbitre. C'est un élément de base du rejet du matérialisme, et a fortiori du matérialisme dialectique. Henri Bergson considère qu'il va plus loin qu'Emmanuel Kant (et donc que René Descartes) dans sa défense de ce principe.
Il faut dire ici qu'Henri Bergson a fort à faire. D'un côté, il doit combattre le déterminisme sans jamais pour autant aborder le matérialisme dialectique (dont les principes sont bien entendu niés, comme son existence). Et de l'autre, il doit tout de même lier la conscience à la réalité pour ne pas basculer dans une abstraction mystique, métaphysique, qui n'aurait été d'aucune utilité pratique...
Henri Bergson s'évertue à justifier ce que René Descartes a justifié. Il parle ainsi d'un « moi fondamental », qui serait au plus profond de la conscience, formant la dimension réellement personnelle et créative alors qu'en surface on ne trouve que ce qui est réflexe, réflexions qu'il dit « solidifiées » et par conséquent codées dans le langage. Les mots sont considérés comme une forme insuffisante ne permettant pas de révéler la complexité de la conscience, on est plus que des mots: on touche ici la dimension anti-rationnelle typique du post-modernisme.
Le moi, comme dans le post-modernisme, se renouvelle de manière ininterrompue: les objets sont statiques dans l'espace, même s'ils changent parfois (et jamais de manière interne, jamais qualitativement) alors que dans le temps, à travers la durée, la conscience se modifie. Henri Bergson nous dit ainsi...
En accordant une dimension centrale à la conscience, Henri Bergson réalise un tour de passe-passe visant à supprimer tout espace théorique où l'on pourrait accorder à la matière un mouvement interne. Le temps n'existe plus pour les objets et les phénomènes, il ne s'y passe rien, en raison de ce que Henri Bergson interprète comme la loi de la conservation de l'énergie. Seule la conscience perçoit les changements, seule elle peut en définitive agir réellement.
Voici comment il formule sa vision du monde :
« Tandis que le temps écoulé ne constitue ni un gain ni une perte pour un système supposé conservatif, c'est un gain, sans doute, pour l'être vivant, et incontestablement pour l'être conscient. Dans ces conditions, ne peut-on pas invoquer des présomptions en faveur de l'hypothèse d'une force consciente ou volonté libre, qui, soumise à l'action du temps et emmagasinant la durée, échapperait par là même à la loi de conservation de l'énergie ? »...
La pensée de Henri Bergson se déploie au même moment où la classe ouvrière surgit et produit le matérialisme dialectique. Cette mise en perspective permet de comprendre sur quoi Henri Bergson met l'accent.
Si en effet il considère la conscience comme « prioritaire » dans la saisie de la réalité, il doit aller plus loin. Il doit systématiser le fait que la réalité a plusieurs aspects ou plutôt plusieurs vérités. Il doit rendre baroque la réalité, il doit la rendre kaléidoscopique, et surtout il doit rendre « spatial » ce qui est spirituel.
Voici une explication de Henri Bergson. Il parle de sons de cloche, que l'on peut soit distinguer un à un, ou bien considérer selon une perspective d'ensemble. Mais dans ce dernier cas, cela signifie qu'un son passé, n'existant plus, a maintenu son existence dans l'esprit, qui a pu ainsi le relier aux autres sons...
Henri Bergson, avec sa conception de la conscience toute puissante, inverse la théorie matérialiste dialectique du reflet. Ce n'est plus la conscience qui est imprimée par la réalité, mais l'inverse.
Cela signifie que ce qu'on appelle mémoire n'est pas une impression, comme dans le matérialisme dialectique où la conscience est imprimée, mais un simple outil pour l'intuition, pour l'action future de la conscience. Le monde consiste en l'avenir de la conscience agissante...
Le premier ouvrage d'Henri Bergson a un titre particulièrement évocateur : Essai sur les données immédiates de la conscience. Paru en 1889, cet ouvrage tente de maintenir l'équilibre qu'a réalisé René Descartes entre la religion et le matérialisme.
René Descartes avait tenté d'ouvrir un espace à la bourgeoisie pour qu'elle réalise la science, dans des conditions difficiles où la catholicisme prédominait. En Angleterre, Francis Bacon pouvait ouvertement revendiquer les cinq sens comme base de la connaissance, mais en France ce n'était pas possible. Cela permit à René Descartes d'émerger comme un penseur « radical » alors qu'il n'était en réalité qu'un penseur coincé entre deux eaux.
Henri Bergson va essayer de maintenir ce savant équilibre, qui tente de faire cohabiter le spiritualisme le plus intransigeant, avec une âme individuelle et un monde conçu par un Dieu tout puissant, et un matérialisme transformant la réalité...
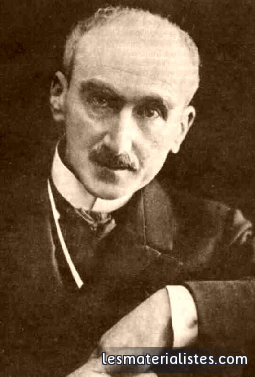 La France a connu de nombreux penseurs, et de grands auteurs de littérature. Leur grand point commun, c'est leur préoccupation pour le style et le mode de vie, c'est-à-dire, en fin de compte, pour une manière de vivre vertueuse, ou morale.
La France a connu de nombreux penseurs, et de grands auteurs de littérature. Leur grand point commun, c'est leur préoccupation pour le style et le mode de vie, c'est-à-dire, en fin de compte, pour une manière de vivre vertueuse, ou morale.
La France dite classique du XVIIe siècle, c'est celle des moralistes en quête de vertu, et celle des Lumières, c'est celle de la morale universaliste ; les auteurs réalistes, voire naturalistes, du XIXe siècle, se sont préoccupés de l'état d'esprit d'une époque où le capitalisme s'approprie toutes les initiatives.
Pour cette raison, la France n'a pas connu de philosophes en tant que tel. Les « philosophes des Lumières » sont des essayistes et des écrivains, nullement des philosophes en tant que tel. Aussi, l'élaboration de systèmes de pensée cohérents et complets est inconnue en France. Ni René Descartes ni Denis Diderot, ni Pierre-Joseph Proudhon ni Jean Jaurès n'ont cherché à systématisé leur pensée, à ériger une démarche complète, cohérente sur tous les plans...
Le paradoxe de la bataille pour la dignité est que Moïse, Jésus et Mahomet n'ont pas du tout été reconnus immédiatement et entièrement. Le matérialisme dialectique affirme que toute progression est non-linéaire, et étonamment pour une religion qui se veut forcément « droite » dans son parcours, on voit que les prophètes ont dû batailler ferme.
Cela ressemble bien plus à de la bataille politique qu'à la réalisation prophétique triomphale. Et justement le matérialisme dialectique montre que les progrès de la civilisation consistent en des sauts qualitatifs, l'histoire avançant en spirale, pas en ligne droite.
Qui dit droit et compassion dit en même temps dignité. Moïse, Jésus et Mahomet représentent une étape de civilisation, d'affirmation de l'humanité par rapport à elle-même, au moyen de Dieu servant de miroir.
C'est là le problème le plus épineux de la religion, qui s'est accaparé toute une vision du monde où l'être humain gagne en dignité grâce à Dieu, par l'intermédiaire du prophète.
Sans Dieu, sans la figure du prophète, il n'y a selon les religions monothéistes plus de dignité humaine. Il n'y a que l’infamie, l'ignorance, le paganisme. Le Coran utilise par exemple le terme de jâhilîya, qui vient du verbe jahala, signifiant être ignorant, agir stupidement...
Le droit ne peut s'imposer, s'il ne transporte pas quelque chose de supérieur par rapport à auparavant. C'est pour cela que la religion est un refuge ; Moïse, Jésus et Mahomet ont construit la religion comme projet politique très concret, comme modification juridique. Cependant, en même temps, ils devaient inévitablement également réfuter les difficultés de la vie matérielle, en tentant de souligner que le nouveau droit apporterait la justice.
C'est de là que vient « l'humanisme » que portent les religions ; c'est ce que Karl Marx a expliqué avec sa fameuse formule de « l'opium du peuple », sur le double caractère de la religion : protestation contre la dureté de la vie et expression en même temps de celle-ci...
Moïse, Jésus et Mahomet expriment un grand tournant historique. Par conséquent, il y a le droit qui fait irruption, comme superstructure nouvelle de la nouvelle infrastructure.
Les propos de Dieu relatés par Moïse sont ici très clairs dans l'expression de la nouveauté juridique désormais écrite :
12 L’Éternel parla ainsi à Moïse:
13 "Et toi, parle aux enfants d’Israël en ces termes : Toutefois, observez mes sabbats car c’est un symbole de moi à vous dans toutes vos générations, pour qu’on sache que c’est Moi, l’Éternel qui vous sanctifie...
Moïse, Jésus et Mahomet ont affirmé des valeurs : celle d'un Dieu éternel montrant sa toute puissance en montrant son contrôle du temps dans l'espace terrestre où vivent les humains profitant de la nature pour vivre.
Dieu est l'éternité et il intervient dans l'espace en jouant sur le temps. Lorsque Jésus marche sur l'eau, le temps de la chute est « bloqué », comme est bloquée l'eau de la mer rouge pour permettre le passage des Hébreux poursuivis par les troupes égyptiennes. Quant au Coran, il est un miracle intemporel pareillement puisqu'il est censé être co-éternel à Dieu.
Dans ces trois cas, on a à chaque fois un humain qui est là pour ce miracle, dans la mesure où il le porte, de par sa présence. C'est le statut de prophète qu'on retrouve ici, avec le judaïsme qui ne reconnaît que Moïse et les prophètes de la Bible juive, tandis que le christianisme reconnaît en plus Jésus Christ et l'Islam y ajoute Mahomet.
Cependant, qui est cet humain, de quoi témoigne-t-il ?...
Tant que Moïse, Jésus et Mahomet parlait de Dieu, ils pouvaient faire référence à l'éternité. Le problème est tout à fait différent si l'on se place sur le plan spatial. L'équivalent de l'éternité est l'infini. Or, si un humain peut dire que quelque chose a existé avant lui et existera après lui, le problème est tout autre avec l'espace, puisque là il est obligé non pas de parler, mais de montrer l'infini.
C'est ici très précisément ce que font les « super-héros », parce que leurs réserves d'énergie semblent inépuisables, infinis : Superman n'est jamais fatigué, l'homme-élastique conserve sa plasticité, etc...
Il existe de très nombreuses manières de lire les récits concernant la vie de Jésus fait par les apôtres (les Évangiles ou Nouveau Testament), tout comme le Coran ou encore les écrits de la Bible juive (appelée Tanakh en hébreu et correspondant en partie à ce qui est appelé Ancien Testament par les chrétiens). Habituellement, deux approches se présentent, se contredisant : la première admet que les textes ont ici une dimension sacrée, divine, relevant de ce qui est révélé par une entité parfaite, omnisciente, omnipotente (résumée sous le concept de Dieu).
Quant à la seconde, elle considère que ces textes sont une retranscription historique d'événements uniquement humains, avec des ajouts surnaturels propre aux superstitions de l'époque dans un endroit donné...
Cette question de l'accumulation est indéniablement difficile et il est facile de se tromper. Rosa Luxembourg est dans ce cas ; son monument qu'est L'accumulation du capital consiste justement en la critique de la position de Karl Marx sur l'accumulation.
Aux yeux de Rosa Luxembourg, ce qu'explique Karl Marx est insuffisant. La richesse ne peut pas provenir du capitalisme lui-même. Ne voyant pas l’élévation des forces productives, le progrès qualitatif, elle va chercher un progrès quantitatif...
L'une des caractéristiques de l'anticapitalisme romantique est de penser que le capital financier « triomphant » dans le capitalisme revient à un capital usuraire médiéval. C'est là une très lourde erreur. En effet, le profit ne peut venir que de l'exploitation des prolétaires. Par conséquent, le capital financier n'existe pas de manière autonome au capital industriel, l'impérialisme est justement la fusion de l'un et de l'autre.
Nous avons vu comment le capitalisme naissait, mais pour s'agrandir, comment fait-il ? Sur le plan de l'accumulation du capital une fois le capitalisme élancé, que nous dit Karl Marx ?
Il constate déjà un paradoxe apparent. Si en effet il faut mettre de l'argent de côté afin de pouvoir investir plus tard, alors qui consomme ?...
Le fermier capitaliste ne suffit pas à donner le véritable élan au capitalisme, il faut l'industriel capitaliste. Il faut davantage de moyens, et ceux-ci ne pouvaient être fournis que par la société passée, aussi faut-il regarder dans la féodalité où est-ce qu'on trouve du capital, c'est-à-dire du travail accumulé.
Karl Marx constate ainsi que :
« Le moyen-âge avait transmis deux espèces de capital, qui poussent sous les régimes d'économie sociale les plus divers, et même qui, avant l'ère moderne, monopolisent à eux seuls le rang de capital. C'est le capital usuraire et le capital commercial...»
Nous avons vu quelle a été la base de l'accumulation primitive : le fait que des paysans aient été chassés de leur ancien mode de vie, et ainsi rendus disponibles pour le capital. Mais cela ne suffit pas ; comme Karl Marx le constate :
« Après avoir considéré la création violente d'un prolétariat sans feu ni lieu, la discipline sanguinaire qui le transforme en classe salariée, l'intervention honteuse de l'État, favorisant l'exploitation du travail - et, partant, l'accumulation du capital - du renfort de sa police, nous ne savons pas encore d'où viennent, originairement, les capitalistes. Car il est clair que l'expropriation de la population des campagnes n'engendre directement que de grands propriétaires fonciers. »
Or, les grands propriétaires fonciers sont des féodaux, pas des capitalistes. Cependant, ces propriétaires fonciers vont en Angleterre utiliser d'anciens serfs comme « fermiers » devant gérer les terres, et pour cela employant des travailleurs journaliers. Très vite, il devient indépendant, payant un loyer au propriétaire...
La compréhension de la nature du rapport entre les deux contraires accumulation du capital et accumulation des prolétaires – ayant comme contradiction interne le paupérisme – permet de saisir d'où vient l'accumulation du capital.
En effet, pour qu'il y ait capital, il faut des prolétaires, et donc tout doit venir de là. Or, d'où viennent les prolétaires ? Ils viennent des campagnes. Or, s'ils n'y sont pas restés, c'est qu'ils ont été obligés de partir, et d'être dans un statut où ils pouvaient passer sous la coupe du capital...
Tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés pour comprendre l'accumulation du capital disparaissent quand on a compris la loi générale de l'accumulation capitaliste. Et cette loi, qui permet de comprendre l'identité des contraires accumulation du capital / accumulation du prolétariat, c'est celle du paupérisme.
En fait, nous avons constaté des contradictions... mais il nous en manquait une. Nous avons en effet vu que, d'une certaine manière, on pouvait constater que plus le capital s'accumule, plus il emploie des prolétaires, mais plus il en emploie, plus la part dédiée aux moyens de production devient importante, et moins il y a de prolétaires !
Tout prend un sens si on comprend que les prolétaires ne sont qu'une variable de la production, et que, qui plus est, il existe un formidable accroissement du rendement individuel de chaque prolétaire, au fur et à mesure de l'accumulation du capital...
Pour comprendre l'accumulation du capital, il faut se rappeler que le capital est du travail accumulé. Ainsi, si le capital s'accumule, alors les forces de production s'accumulent également - pas seulement le prolétariat, les forces productives aussi.
C'est précisément ce que ne voient pas les idéalistes raisonnant seulement en termes de salaires (et par conséquent Léon Trotsky, dans le Programme de transition, était obligé de prétexter que les forces productives auraient cessé de croître, afin de justifier sa propre position)...
Comment le capitalisme a-t-il commencé ? C'est là une question essentielle, qui détermine également comment il fait pour grandir, pour s'élargir, pour s'approfondir, pour s'intensifier ou, plus précisément sans doute, pour se dilater.
Cette question, c'est celle de l'accumulation du capital. Le problème évident étant ici que si on peut comprendre que le capital s'accumule une fois qu'il est lancé, comment a-t-il fait justement pour se lancer ? Comment quelque chose de non capitaliste a-t-il pu donner naissance au capital ?
Et si c'est le cas, pourquoi ne pas penser, comme le fit Rosa Luxembourg dans son ouvrage L'accumulation du capital, que le capital a besoin pour grandir de zones non capitalistes à intégrer ?...
C'est un épisode qui témoigne de l'intense complexité de la bataille qui s'est joué au tout début des années 1950 entre les communistes et les révisionnistes. Nous sommes à Prague, le premier mai 1955 : un immense monument dédié à Staline est inauguré.
Le paradoxe est que Khrouchtchev est présent, alors que depuis la mort de Staline en 1953 il a réorganisé tout le Parti Communiste d'Union Soviétique, dans un coup d’État dont le point culminant victorieuxsera le « rapport secret » du 20e congrès de ce parti. Mais nous sommes alors en Tchécoslovaquie, pays où proportionnellement à la population, les communistes ont leur bastion mondial...
Auferstanden aus Ruinen (« Ressuscité des ruines ») fut l'hymne national de la République démocratique allemande à sa fondation en 1949.
Le texte reflétant l'idéologie et la démarche du principe de Démocratie populaire, le régime interdisa son utilisation officielle, l'hymne devenant purement instrumental. On peut écouter l'hymne ici...
Les audiences de l'affaire du complot de Laszlo Rajk et de ses complices ont éveillé, à juste titre, un écho puissant dans notre peuple travailleur, chez nos amis étranger et chez nos ennemis étrangers aussi.
Ce procès a une très grande importance. Je puis affirmer sans exagérer : ce procès est d'importance internationale. En effet, il faut juger des accusés qui n'ont pas seulement levé la main sur le régime de notre République populaire, sur les grandes conquêtes de notre démocratie, mais qui ont été, dans leur activité de conspirateurs, des instruments, des pantins tirés par les ficelles des impérialistes étrangers, ennemis de notre peuple hongrois qui édifie le socialisme...
« Zdrobite cătușe » (« Brise les chaînes ») fut l'hymne de la République Populaire de Roumanie, de 1947 à 1953.
L'hymne roumain fut ensuite modifié en 1953, devenant la chanson « Te slăvim, Românie » (« Nous te glorifions, Roumanie »), au texte patriotique bourgeois, à part une seconde strophe faisant référence au léninisme et à la fraternité exprimée au peuple soviétique, qui ne fut plus chantée dès les années 1960. A partir de 1965, Ceausecu instaura un nouvel hymne, intitulé « Trei culori » (« Trois couleurs »).
On peut écouter la version instrumentale de Zdrobite cătușe ici...
Discours prononcé le 16 juillet 1950 à la Ve session plénière du Comité Central du Parti Ouvrier Polonais Unifié
Les délibérations de la Ve Session plénière du CC sur le plan de six ans et la formation des cadres nécessaires à sa réalisation ont clos la longue période des travaux préparatoires, commencés encore avant le Congrès d'Unification, c'est-à-dire il y a de cela deux ans.
Des délibérations de cette Session plénière, il ressort que le plan de six ans est un plan prêt, un plan étudié, vérifié et entièrement préparé pour quo l'on puisse...
Loi du 13 janvier 1949 de la République Populaire de Roumanie.
Art. I : Les crimes suivants sont soumis à la peine de mort :
a) Trahison du pays, activité en faveur de l'ennemi, action préjudiciable au Pouvoir de l’État ;
b) Transmission. de secrets d'Etat à un pays ennemi ou étranger ;
c) Complot contre la sécurité intérieure ou extérieure de la République Populaire Roumaine...
Pourquoi posons nous dans la situation internationale actuelle la question du Front National au premier plan de la lutte pour la paix et pour le Plan de six ans? Nous le faisons pour les raisons suivantes :
Premièrement : la situation internationale actuelle — alors que l'impérialisme mobilise toutes ses forces pour une nouvelle agression nous impose de nouvelles tâches importantes et exige la plus grande concentration de tous nos efforts et la mobilisation de toutes nos réserves.
Deuxièmement: l'agression impérialiste menace les conquêtes et les acquisitions des masses laborieuses, l'existence même de la nation polonaise et son indépendance...
La première année de notre grand Plan Sexennal, de notre plan de relèvement, de consolidation et de renforcement des forces politiques, économiques, culturelles et spirituelles de la Pologne Populaire, est écoulée.
Les tâches de cette première année ont été réalisées avec succès et considérablement dépassées par les travailleurs de notre pays.
Nous entrons actuellement dans la deuxième année de notre Plan Sexennal. Il n'est que juste qu'au seuil de cette année nous nous rappe-lions l'étendue, l'importance et le caractère des tâches qui nous attendent pendant cette deuxième année de notre plan qui, avec l'année suivante, est l'une des plus importantes car elle constituera l'étape décisive pour la réalisation de l'ensemble du Plan Sexennal et pour sa victoire...
Le baroque se confond avec la contre-réforme, avec l'esprit de la réaction: c'est la règle générale. Cependant, dans certains cas, comme la Belgique et l'Autriche, le baroque a été prolongé y compris dans une phase d'affirmation nationale, ce qui lui confère une dimension populaire certaine, la difficulté étant de scinder l'aspect réactionnaire de l'aspect culturel authentique.
Cela ne saurait toutefois être le cas pour la Bohême-Moravie, pays dominé par l'Autriche et connaissant une colonisation idéologique dans le cadre de l'oppression nationale. Si Prague est une ville baroque, ce baroque ne saurait avoir le même sens celui de Vienne, où la bourgeoisie parvient lentement à s'affirmer aux côtés de la monarchie essayant de devenir absolue...
La République Populaire de Pologne est une république du peuple travailleur. La République Populaire de Pologne continue les plus nobles traditions progressistes du peuple polonais et met en pratique les idées libératrices des masses travailleuses polonaises.
Le peuple travailleur de Pologne, sous la direction de l'héroïque classe ouvrière, et s'appuyant sur l'alliance des ouvriers et des paysans, a lutté pendant des dizaines d'années pour se libérer de l'asservissement national imposé par les annexionnistes et colonisateurs prussiens, autrichiens et russes, de même qu'il a lutté pour l'abolition de l'exploitation des capitalistes et des grands propriétaires fonciers polonais...
Mesdames, Messieurs, Les membres du gouvernement pour les partis socialiste national, populiste et démocrate slovaque ont démissionné le 20 février 1948. Par ce fait fut ouverte la crise gouvernementale.
Trente est une ville au nord de l'Italie, très connue pour son « concile », réunion des évêques de l'Église catholique romaine. Ce concile s'est tenu alors que le protestantisme s'affirmait, et le Vatican disposait de deux options principales :
- « mettre de l'eau dans son vin », en s'adaptant au protestantisme : ce sera la ligne du jansénisme, théorisé dans des zones marquées par la pression protestante ;
- aller à l'affrontement : ce sera la ligne des jésuites.
Pour comprendre la dynamique autonome de l'Église catholique et de ses « saints », il faut saisir qu'au cœur du baroque, on a un mouvement extrêmement bien organisé, une sorte d'élite, une armée prête à mener la bataille idéologique : la « Compagnie de Jésus ». Ses membres sont appelés les « jésuites » et ce sont eux qui sont à l'origine de la première église baroque, l'église du Gesù à Rome.
Outil essentiel de la « reconquête » idéologique des masses, les jésuites sont des cadres formés au cours d'un long processus – une quinzaine d'années –, dans un parcours extrêmement dur sur le plan des enseignements (sciences, religion, etc.) et humain, les trois « vœux » consistant en l'occurrence en la pauvreté, la chasteté et l'obéissance au supérieur.
On est là dans une abnégation complète, et ces trois « vœux » sont d'ailleurs symbolisés par pas moins que trois clous perçant un cœur, sous le monogramme latin Jesus Hominum Salvator (Jésus sauveur des hommes), surmonté d'une croix, le tout servant de symbole des jésuites...
[Le texte a été approuvé par Paul III le 31 juillet 1548 et édité pour la première fois la même année]
Traduction du texte espagnol par le Père Pierre Jennesseaux de la Compagnie de Jésus
Numérisation de l'édition de 1913 par le Frère Jérôme novice de la même Compagnie
Namur 2005
Propres à faciliter l'intelligence des Exercices spirituels qui suivent: utiles à celui qui doit les donner, et à celui qui doit les recevoir.
Du temps même du Christ, il existait une telle ferveur populaire que les gens étaient transcendés et arrivaient à disposer de volonté et d'engagement qu'ils n'osaient pas auparavant. Nulle magie ici, simplement l'importance de la capacité à prendre des décisions, avec, inévitablement et c'est un aspect de grande importance, l'hypothèse absolument nécessaire que Jésus était en fait médecin.
Soins réels, ferveur permettant d'aller de l'avant, voilà ce qui a aidé Jésus comme figure révolutionnaire anti-romaine et, partant de là, opposé aux rabbins entrés politiquement en collaboration avec l'occupant...
Il fallait, en quelque sorte, réimpulser la religiosité du Moyen-Âge. Cependant, l’Église avait besoin pour cela d'intermédiaires entre les gens et Dieu, afin d'empêcher tant les soulèvements mystiques incontrôlés que les éventuels choix raisonnables se passant de l’Église elle-même.
Il y eut alors à la généralisation théologique des « intercesseurs » : les « saints ». Le culte des « saints » est par conséquent une composante essentielle du baroque. Le Vatican a dépensé une énergie importante pour disposer de « saints » locaux sur lesquels s'appuyer pour évangéliser et reconquérir les zones perdues aux protestants...
Les vanités ne forment qu'une approche du baroque et de l'esprit de la Contre-Réforme. Il ne suffisait pas de montrer que toute activité intellectuelle était vaine : il fallait également, pour les forces réactionnaires, présenter le monde comme directement incompréhensible.
De la même manière que la bourgeoisie, au XXe siècle, a utilisé les principes de l'existentialisme, de la phénoménologie, la micro-économie, la mécanique quantique, etc., au XVIIe siècle la réaction cléricale et aristocratique a cherché à présenter le monde comme sans cesse changeant, comme insaisissable, comme incompréhensible...
Comme nous l'avons vu, Noël est donc une fête de la nature liée au solstice d'hiver. Mais cela n'est pas son seul aspect.
Le fait que Noël soit la fête la plus importante dans la culture des masses de France provient aussi de son autre aspect : Noël est une fête de la générosité et de la famille. Cela est d'ailleurs visible dans toutes les cultures fêtant Noël avec chacune ses propres rites et coutumes.
Cette centralité de la générosité comme cœur de « l'esprit de Noël » renvoie d'ailleurs là aussi à la Nature qui est perçue par les êtres humains comme étant généreuse puisque prodiguant nos moyens de survie...
Nous avons vu que Noël est une fête liée au solstice d'hiver. Elle tombe donc au moment le plus sombre de l'année. Mais pas seulement.
Lorsque Noël arrive, fin décembre donc, l'hiver s'installe dans l'hémisphère nord de notre planète (de manière plus ou moins avancée selon les latitudes). La France se situant relativement au nord de l'hémisphère nord, les saisons y sont bien marquées ; en hiver, il fait donc froid.
Noël est donc une fête de l'hiver, de la nature d'hiver pour être exact. C'est la fête de la Nature se mettant au ralenti pour mieux relancer le cycle de la vie le printemps venu.
Le principe du baroque était le suivant : la vie sur Terre ne pouvait être que brève et troublée, alors que la vie après la mort était éternelle et marquée par le bonheur divin ; se préoccuper du paradis avait un sens, s'attarder sur la vie matérielle n'en avait pas.
La quête de science prônée par l'humanisme, la volonté de compréhension prônée par la Réforme protestante, tout cela devait laisser indifférent qui avait compris que la priorité, c'était la vie après la mort. Le baroque consista ainsi en une offensive relativiste.
Voici un exemple avec un poème de Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635), où le cadavre grouillant de vers, en mouvement donc, est opposé à la seule chose justement jamais en mouvement, et seul refuge selon lui: Dieu...
Le terme de « baroque » permet de désigner un mouvement intellectuel, culturel et artistique qui s'est imposé dans de nombreux pays d'Europe au XVIIe siècle. Sa vigueur a été exceptionnelle, et son impact a été si grand qu'il a profondément marqué de nombreuses cultures nationales apparaissant justement précisément en cette période.
Au sens strict, le mot « baroque » vient du portugais « barrocco » et désigne une perle irrégulière. S'arrêter cependant à une question de forme serait profondément erroné. En effet, le baroque est la forme historique qu'a prise la contre-réforme, c'est-à-dire la réaction s'opposant à l'humanisme et à la Réforme protestante du 16e siècle, dans le cadre de la bataille pour l'opinion publique...
La fête de Noël est intimement liée au solstice d’hiver qui est une date remarquable dans la rotation de notre planète la Terre autour de notre étoile le Soleil.
L’axe de rotation la Terre étant incliné par rapport au plan de l’ellipse que constitue sa course autour du Soleil, c’est au moment de ce solstice que l’hémisphère nord de notre planète est le moins incliné vers le Soleil (et l’hémisphère sud le plus incliné). La situation inverse se passe au moment du solstice d’été. Ainsi, au moment du solstice d’hiver, le jour est le plus court de l’année et les rayons du soleil frappent l’hémisphère Nord avec l’angle le plus grand. Il fait donc plus froid et moins longtemps jour...
Jean Jaurès a été une catastrophe sur toute la ligne. Il a empêché la réception du marxisme en France, il a théorisé un « socialisme » comme généralisation de la petite propriété, il a mis en place un parti parlementariste et légaliste tentant de « conduire » la République au socialisme.
Deux conséquences majeures, demandant une analyse très approfondie, apparaissent ici...
Dans la social-démocratie, le syndicalisme est imbriqué dans le mouvement et est secondaire par rapport au Parti, à la théorie. En France, le syndicalisme s'est justement, à l'inverse, autonomisée. La charte d'Amiens est le produit catastrophique du refus de la politique par la classe ouvrière, au nom des nécessités pragmatiques du syndicat.
Voici comment Jean Jaurès soutient l'esprit du congrès de Rennes de 1898 de la Confédération Générale du Travail (née en 1895), dans une démarche pleine de complaisance...
Le problème de fond de la démarche de Jean Jaurès, c'est que tout comme chez Pierre-Joseph Proudhon, on est dans l'éclectisme le plus complet. Tout se mélange, de manière incohérente, et est même justifié, comme chez Pierre-Joseph Proudhon, par le principe de deux devient un : il serait intelligent d'allier, d'unir les deux aspects de la contradiction.
Cela n'a aucun sens : pour Karl Marx, la pensée est le reflet du mouvement de la matière, elle est de la matière grise. Or, Jean Jaurès dit qu'il accepte cette thèse, puis il tente de la combiner à la thèse contraire, et cela au nom de la « synthèse des contradictoires »...
Jean Jaurès parlait allemand, suffisamment donc pour étudier les documents de la social-démocratie allemande, pour donner son point de vue sur les oeuvres de Karl Marx et Friedrich Engels. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais popularisé le marxisme, et pour cause !
Pour autant, Jean Jaurès doit tout de même se positionner par rapport à l'interprétation du marxisme. Il ne défend pas le marxisme, mais il doit se positionner de par la vigueur de la confrontation au sein de la social-démocratie internationale. On a ainsi Karl Kautsky qui défend l'orthodoxie, alors qu'Eduard Bernstein la réfute (au nom du fait que le mouvement est tout, le but n'est rien)...
Jean Jaurès est ainsi à l'origine d'une mystique, où le « socialisme » agit miraculeusement sur le capitalisme, au moyen de la « République ».
Voici comment Jean Jaurès voit les choses stratégiquement, expliquant que la classe ouvrière... doit être introduite dans la propriété ! Il attribue même à Karl Marx, ce qui relève de l'escroquerie et Jean Jaurès ne pouvait pas ne pas le savoir, le concept d'« évolution révolutionnaire » !..
Si l'on comprend bien la démarche de Jean Jaurès, alors on voit forcément que pour lui, le statut de prolétaire est une malédiction. L'idéal c'est le bourgeois, cultivé et humaniste, et tout le monde doit pouvoir l'être.
Le statut du prolétariat est pour l'instant d'être « déshérité », les prolétaires sont « dépouillés et nus », l'humanité est en « lambeaux », et par conséquent il faut une grande réconciliation. Jean Jaurès parle des arts, et logiquement il explique que cette sorte d'unification par le « socialisme » est nécessaire afin d'universaliser l'art...
Le socialisme est pour Jean Jaurès non pas l'abolition de la propriété privée, mais sa généralisation : la bourgeoisie cesse d'en avoir le « monopole ». Jean Jaurès raisonne en termes d'individu, pas de classe ; il raisonne toujours du point de vue individuel, jamais selon les modes de production.
Par conséquent, le communisme est chez Jean Jaurès une unification des antagonismes, comme chez Pierre-Joseph Proudhon pour qui deux devient un, à l'opposé de la dialectique. Au lieu d'avoir un qui devient deux, on a deux qui deviennent un, par un mouvement de réconciliation. C'est typiquement l'erreur française sur la dialectique, que Karl Marx notait de manière acerbe au sujet de Pierre-Joseph Proudhon...
Faisant l'apologie de l'enseignement comme base morale et idéologique du socialisme, Jean Jaurès prônait la fondation d'universités, de formations permanentes ; il voulait que les officiers ne passent pas que par des institutions militaires, mais par l'armée également.
Cependant, cette conception montre la dimension inter-classiste de son « socialisme ». Inévitablement, Jean Jaurès est obligé d'élargir le champ de ceux qui profiteraient de son « socialisme ». Ce dernier est en effet un concept, une morale, un style, une approche, pas une idéologie ni la dictature du prolétariat et encore moins un mode de production.
Le « socialisme » de Jean Jaurès est une évolution naturelle à une société « plus rationnelle ». Par conséquent, l'ennemi a tendance à être non pas la bourgeoisie (en tant que composante d'un mode de production), mais des forces obscures...
Jean Jaurès croit donc en la « République » comme forme neutre, utilisable pour le socialisme. Mais comment voit-il les choses concrètement, à défaut d'en élaborer la théorie ? Tout simplement, il s'imagine que cela se réalisera par l'enseignement; dans la même démarche que Victor Hugo, il voit la solution en l'éducation.
Or, le problème est bien entendu que l'éducation dépend jusqu'à présent de couches sociales liées à la bourgeoisie et à l'aristocratie, à l'Eglise. D'où les campagnes de Jean Jaurès : d'abord celle, qui triomphera, en faveur de la laïcité à l'école. Ensuite, mais la démarche échouera, en faveur de la liaison organique des écoles primaires avec les communes, afin de casser l'hégémonie de l'idéologie cléricale-réactionnaire...
Jean Jaurès n'est pas un intellectuel organique, un dirigeant révolutionnaire né sur le terrain de la lutte des classes, en se fondant sur les principes prolétariens scientifiques les plus avancés de son époque. Il le dit lui-même, ce qu'il veut c'est un « socialisme français ».
Jean Jaurès fut ainsi quelqu'un à gauche de Georges Clémenceau : ce dernier voulait gérer au mieux, Jean Jaurès comptait lui pousser le mouvement vers un « idéal » socialiste – sans pour autant avoir jamais donné de base scientifique à sa conception...
Jean Jaurès n'a jamais dit « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». C'est une citation erronée, doublement même puisque non seulement elle ne résume pas la pensée de Jean Jaurès, mais exprime même le point de vue contraire de celui-ci. L'erreur provient de l'assassinat de Jean Jaurès, devenu un martyr pour la paix.
Voici déjà ce qu'a en réalité dit Jean Jaurès...
Jean Jaurès est entré au Panthéon en 1924 : c'est tout un symbole. Logiquement, comme symbole du pacifisme et du socialisme, il aurait dû être condamné par l'opinion publique outrancièrement nationaliste suite à la victoire de 1918.
Son meurtrier Raoul Villain, fut d'ailleurs acquitté lors de son procès en 1919, après cinquante-six mois de détention préventive ; ce fut par conséquent la veuve de Jean Jaurès qui dût payer les frais du procès.
Comment se fait-il alors que, dans le même contexte, Jean Jaurès put être porté aux nues par le même régime qui laisse libre son assassin ? C'est là une contradiction absolue qui, en fait, puise dans la figure même de Jean Jaurès, pour qui le socialisme consiste en la généralisation de la petite propriété privée à travers le capitalisme, par l'intermédiaire de la République...
Le programme de Hainfeld est un véritable bijou de la social-démocratie de sa période révolutionnaire, une synthèse d'un développement historique remarquable. On est ici dans la véritable social-démocratie, qui combine idéologie, culture et politique, et qui ne résume pas son combat à une approche sociale ou une simple perspective économique.
La chute du mur de Berlin, et plus globalement du bloc soumis aux social-impérialisme soviétique, voilà qui fut une source de joie pour les progressistes. C'était la fin d'une exploitation et d'une oppression mises en place par les « nouveaux tzars » ; comme nous l'avions formulé en 2009, la chute du mur de Berlin, c'est le symbole de la chute des nouveaux tzars.
Les pays de l'Est européen étaient soumis au joug fasciste maquillé en « socialisme » ; il s'agissait ni plus ni moins de pays semi-coloniaux, inféodés à l'URSS devenu un social-impérialisme en 1953...
Au tout début des années 2000, les trotskystes sont à leur apogée. Leur influence sur la société française est au plus haut ; parler d'extrême-gauche politique, c'est parler d'eux.
Le pic sera atteint aux élections présidentielles de 2002 : Olivier Besancenot du courant frankiste-pabliste fait 4,25 %, Arlette Laguiller du courant Lutte Ouvrière 5,72 %, les deux dépassant le candidat « communiste », Robert Hue, qui n'obtient que 3,37 % des voix...
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les trotskystes se retrouvent très peu nombreux, et qui plus est, ils vont être en désaccord profond sur les forces à choisir pour leur « entrisme ». Les uns considèrent que ce sont les « staliniens » qui vont l'emporter, et il faut par conséquent les infiltrer. Les autres considèrent qu'il ne faut pas hésiter à s'allier avec les anti-communistes.
Cette scission entre forces trotskystes est vrai par ailleurs au niveau international. Ainsi, les forces cherchant à mener l'entrisme chez les « staliniens » se retrouvent dans le « secrétariat unifié de la quatrième Internationale », tandis que les partisans des alliances ouvertement anti-communistes forment le « Comité international pour la reconstruction de la IVe Internationale »...
Les trotskystes ont tous étudié le Programme de transition, et toutes leurs stratégies sont fondées dessus. Mais les différences d'interprétation modifient les démarches.
Les partis trotskystes sont ainsi des agrégats de tendances, pas un parti communiste organique fondé sur une idéologie.
Les partis trotskystes sont des « centres » d'agitateurs syndicaux, car la révolution selon Trotsky passe nécessairement par les syndicats au départ, d'où la bataille pour le contrôle des syndicats par les trotskystes et les appels à la « démocratie prolétarienne »...
Si les planistes veulent « encadrer » l'économie de l'intérieur de l'État, les trotskystes quant à eux veulent la même chose, mais en puisant en-dehors de l'État. Tout le discours des trotskystes français tient à un seul raisonnement de fond : les capitalistes ne savent pas gérer correctement l'économie, il faut le « contrôle ouvrier ».
Il s'agit, derrière le discours en apparence révolutionnaire, d'un simple planisme, mais appuyé sur les syndicats, et cette conception a été théorisée par Trotsky lui-même, dans le document principal du trotskysme : Programme de transition ou l'agonie du capitalisme et les tâches de la IVe Internationale...
Les gens issus de l'école d'Uriage ont soutenu totalement Le Monde. Lors d'une crise en 1951, où Hubert Beuve-Méry faillit perdre la direction du journal au profit de René Courtin et d'une fraction libérale-démocrate, il y eut d'ailleurs une vague de soutien, d'un côté par Charles De Gaulle, de l'autre avec un appel signé par 350 personnes dont 31 professeurs à la Sorbonne, au Collège de France, aux facultés, 36 membres du Conseil d’État, de la Cour des Comptes, de l’Inspection des finances et de la magistrature.
L'Etat lui-même soutient Le Monde. C'est Charles De Gaulle qui a amené Hubert Beuve-Méry à devenir le dirigeant, quant au papier et son prix, aux salaires, l'impression elle-même, le prix de vente, la dimension du tirage, etc. tout cela est décidé directement par les ministères...
L'existence même du journal Le Monde et de son idéologie catholique de gauche tient à l'école d'Uriage. Le directeur du Monde, fondé à la fin 1944, est ainsi Hubert Beuve-Méry, un des principaux acteurs de l'école d'Uriage.
Beuve-Méry est issu du journal Le Temps, fondé en 1862 et qui dans les années suivant la première guerre mondiale, était porté par une union des organisations patronales (Comité des forges, Comité des Houillères, Union des industries métallurgiques et minières, Confédération générale du patronat français), devenant pas moins que l'expression officieuse du ministère des affaires étrangères...
En juin 1945 parut un ouvrage au titre étrange : Vers le style du XXe siècle. C'est en effet le manifeste de « l'équipe d'Uriage », supervisé par Gilbert Gadoffre.
Pour comprendre la nature de ce dernier, il suffit de mentionner que lorsqu'il participa à la bataille portée jusqu'en Allemagne avec les armées alliés, se permit même d'aller rendre visite au philosophe allemand ultra-réactionnaire Heidegger, à Fribourg, pour lui parler de sa pensée, de l'existentialisme, de Jean-Paul Sartre et Merleau-Ponty !..
Le problème théorique des intellectuels bourgeois concernant l'école d'Uriage est qu'ils ont cherché une extrême-droite déjà synthétisée, comme le fascisme italien ou le national-socialisme allemand. Or, l'école d'Uriage se situe idéologiquement au début de la synthétisation, et qui plus est son point de vue est celui de la « révolution conservatrice ».
Les membres de l'école d'Uriage, en grande majorité des jeunes de moins de 30 ans, sont des traditionalistes. Ils viennent de milieux liés à l'aristocratie, à l'armée, et surtout à l'Église catholique...
L'école d'Uriage a une importance historique considérable en France. Elle fut largement inconnue du grand public, jusqu'à l'accusation d'avoir été au cœur du dispositif de l'idéologie fasciste française, accusation faite une première fois par l'intellectuel polémiste libéral Bernard-Henri Lévy, dans L'idéologie française en 1981, puis par l'historien social-démocrate israélien Zeev Sternhell dans L'idéologie fasciste en France, en 1983.
Les réactions furent extrêmement nombreuses en défense de l'école d'Uriage, car cette école est au cœur de l'idéologie de la république française d'après 1945, marquée par un État fort et interventionniste, pratiquant une sélection et une formation drastique de hauts fonctionnaires, développant une mystique sociale communautaire et une cogestion massive, etc...
Les années 1930 ont été marquées par l'influence très importante des technocrates. La moitié des étudiants en droit ou en médecine, des étudiants de polytechnique, etc. étaient sous l'influence de l'extrême-droite, manifestant et militant, se structurant intellectuellement par ce biais.
De manière plus populaire, les « Croix-de-feu » rassemblaient des centaines de milliers de combattants nationalistes et conservateurs, prônant une remise en ordre musclée, étant un strict équivalent du parti allemand DNVP, qui lui était encore plus massif avant 1933, où il agissait de conjoint avec le parti nazi.
Tout comme le néo-socialisme, il s'agit là de courants prônant des solutions « par en haut », par l'administration forte, par le coup de force. Le Parti Populaire Français est la seule structure assumant ce principe jusqu'au bout, jusqu'au fascisme, et encore n'assumera-t-il pas ouvertement le projet de dictature complète avant la défaite de 1940...
Ainsi, le Parti Populaire Français a comme objectif un fascisme français, la réconciliation des classes au nom du seul intérêt national, et cela de manière agressive. Jacques Doriot exprimera ainsi, en 1938, sa fascination pour Adolf Hitler et sa « révolution », dans « Refaire la France » :
« La révolution hitlérienne a redonné à l'Allemagne son autorité, son prestige, sa liberté, sa force (…). Cette révolution nationale populaire, comme toutes les révolutions, est fière de son œuvre (…).
Il semble que la France n'ait pas réalisé complètement l'événement considérable qu'a été l'arrivée au pouvoir des nazis : victoire contre le bolchevisme, victoire plus lente, mais non moins décisive, contre les vieilles forces traditionnelles de l'Allemagne ; victoire pacifiste contre les traités de paix et leurs défenseurs (…)... »
Une fois le « Parti Populaire Français » lancé, Jacques Doriot modifia lentement mais sûrement son discours officiel. Il passa du « soutien » aux revendications ouvrières de 1936 à la critique d'une manipulation par les communistes. Il se posa en défenseur des classes moyennes ; en juin 1936, il avait déjà appelé à protéger les petites entreprises, et s'était posé en « intermédiaire » pour les négociations. Les adhérents du « Parti Populaire Français » lui doivent un « serment de fidélité », que voici :
« Au nom du peuple et de la patrie, je jure fidélité et dévouement au « Parti Populaire Français », à son idéal, à son chef. Je jure de consacrer toutes mes forces à la lutte contre le communisme et l'égoïsme social. Je jure de servir jusqu'au sacrifice suprême la cause de la révolution nationale et populaire d'où sortira une France nouvelle, libre et indépendante. »...
Jacques Doriot profite des événements de février 1934 pour rompre avec le Parti Communiste. Il se lance en effet dans une campagne pour un comité d'action avec le Parti Socialiste, sur une base antifasciste.
Cela reviendrait à liquider l'identité du Parti, ce qui arrangerait Jacques Doriot qui doit faire face à la bolchevisation du Parti et à sa progression idéologique. Déjà, deux autres opportunistes ont été éjectés au début des années 1930, qui auront le même parcours que lui par la suite mais feignaient de leur côté l'accord idéologique avec l'Internationale Communiste, Henri Barbé (qui dirigeait le Parti) et Pierre Celor (s'occupant de l'appareil)...
La figure de Jacques Doriot est très connue ; elle est présentée le plus communément de la manière suivante : figure communiste, il aurait prôné l'unité antifasciste entre communistes et socialistes, ce qui l'aurait amené à être exclu. Déçu, il devint anti-communiste, chef d'une troupe de « collabos », lui-même n'hésitant pas à participer militairement à la lutte de l'armée allemande contre l'URSS.
Une telle vision est, bien entendu, typiquement bourgeoise, et malheureusement, il n'y a pas eu d'analyse matérialiste dialectique jusqu'à présent. En fait, le premier point à noter est qu'il est absurde de prétendre que Jacques Doriot voulait l'unité antifasciste. En réalité, il voulait liquider le Parti Communiste dans une unité avec les socialistes, au nom de l'antifascisme...
Les néo-socialistes, une fois quittée la SFIO, formèrent le « Parti Socialiste de France – Union Jean Jaurès ». C'est tout à fait cohérent avec l'idéologie de Jean Jaurès, sauf que bien évidemment l'idéal socialiste devenait une réalisation purement technocratique.
Cela ne permettait pas de construire un large parti « populaire ». Les néo-socialistes disposaient de 23.000 membres en mai 1934, et seulement 12.000 six mois plus tard, et 7.400 à la fin de l'année 1936. D'ailleurs, la notion même de parti disparaissait...
Le néo-socialisme veut tout comme le fascisme nier les contradictions travail manuel / travail intellectuel et villes / campagnes. Il rejette le matérialisme dialectique qui affirme qu'il faut dépasser celles-ci, et par conséquent il n'accepte pas le principe de révolution : c'est par les réformes que ces objectifs doivent être atteints.
Les thèses néo-socialistes furent formulées historiquement en 1931 par Marcel Déat dans son document Perspectives socialistes. L'idée de base était très simple : puisque de toute façon la SFIO a rejeté le marxisme depuis le départ, alors il faut assumer plus qu'un simple réformisme, davantage que la forme d'une social-démocratie allemande sans marxisme et de taille plus réduite...
On a appelé « planisme » l'idéologie mettant en avant le principe du « plan » comme donnant des « impulsions » - et non des directives comme dans le matérialisme dialectique – à une société par ailleurs restant fondée sur la propriété privée.
Il y a ici deux idées essentielles, que l'on retrouve parfaitement résumées par Pierre Drieu La Rochelle dans « Socialisme fasciste ». Tout d'abord, il y a l'idée que le plan étatique est la conséquence logique du capitalisme lui-même...
Les trotskystes ne sont pas les seuls à s'opposer au Front populaire et à la Résistance : à la même époque, on trouve les « néo-socialistes ». Ceux-ci sont issus de la SFIO, et leur chef de file est Marcel Déat, auteur notamment de Perspectives socialistes publié en 1930.
Mais on trouve également tout le courant porté par Paul Faure au sein de la SFIO, et formant à peu près 40 % de ce parti. A cela s'ajoute tout un courant ayant quitté le Parti Communiste français sous l'impulsion de Jacques Doriot...
Bien entendu, l'analyse de Trotsky étant totalement fausse, l'entrisme trotskyste dans la SFIO échoua. L'unité du Front Populaire s'élevant comme inéluctable suite aux événements de février 1934, la ligne « ultra » des trotskystes apparaissait comme totalement décalée et ceux-ci furent exclus de la SFIO en 1935.
Trotsky modifia alors totalement sa ligne, de manière historiquement inverse du communisme. Lorsque les communistes tentaient d'arracher la base de la social-démocratie, Trotsky soutenait celle-ci en prônant l'entrisme en son sein. Inversement lorsque les communistes étaient parvenus à obliger la social-démocratie à assumer l'antifascisme, Trotsky soutint de quitter la social-démocratie...
Les trotskysmes français sont historiquement des réformismes « durs » s'opposant à l'utilisation de concept de « république » par la social-démocratie. Le trotskysme n'est nullement « communiste » ; sa base idéologique est une sorte d'indépendantisme de la social-démocratie.
Pour cette raison, la dynamique des trotskysmes français s'appuie sur cette volonté de « rupture » de la social-démocratie avec les nécessités pratiques gouvernementales. Le pouvoir est censé revenir aux organisations ouvrières, partis comme syndicats, s'unifiant pour un nouveau régime issu des luttes économiques « maximalistes »...
Le fait que la social-démocratie française n'ait été qu'une pâle copie, vide de contenu, de la social-démocratie allemande, a amené un résultat aux conséquences politiques immenses pour le mouvement ouvrier de notre pays.
En Allemagne, la social-démocratie c'est une série d'organisations de masse, organisées autour d'une idéologie bien déterminée : le marxisme. L'objectif se veut la prise du pouvoir d'Etat, par la lutte des classes, et cela reste le cas même lorsque les forces électoralistes triomphent complètement...
Il y a lieu de préciser, pour conclure, les caractéristiques générales du national-socialisme.
1. Le national-socialisme n'est pas une rencontre du nationalisme et du socialisme, mais une perspective idéaliste de réponse « nationale » aux questions sociales. Pour cette raison, l'anticapitalisme romantique est nécessaire, afin de « compenser » la non-remise en question du capitalisme.
2. La réponse « nationale » à la question sociale présuppose le fait que la nation ne connaîtrait pas de contradictions internes ; la base est ainsi la négation de la lutte des classes et du principe de dialectique en général...
La date du 25 juin 1934 est davantage connue pour la liquidation, en même temps que les putschistes de la « révolution conservatrice », de nombreux dirigeants de la S.A.. Officiellement, du côté nazi, c'est une réponse à la tentative de putsch du dirigeant de la S.A., Ernst Röhm. L'expression la « nuit des longs couteaux » n'a jamais été employée en Allemagne, seulement en France, en Angleterre, etc. comme surnom donnée à une opération qui aurait servi à liquider la « gauche » nazie.
Ce n'est pas le cas. Preuve en est que nulle part le programme du parti nazi ne prévoyait d'expropriations, à part dans le cas d'activités dites anti-nationales, et que de plus le responsable de la S.A. à ce moment-là était Ernst Röhm, placé en réponse aux agissements populistes de Walter Stennes.
Quant à l'arrêt des violences de la S.A. comme prétexte, une telle interprétation n'a pas de sens, alors que l'Allemagne passe sous la coup de bouchers...
L'Allemagne nazie connut bien entendu des contradictions, en fait elle ne connut que cela : contradictions entre elle et les pays conquis et opprimés, contradictions entre les larges masses et la grande bourgeoisie, contradictions entre l'armée allemande et les nouvelles factions dans l'appareil d’État, contradictions entre les factions nazies elle-même, etc. etc.
La première grande contradiction visible fut celle entre la haute bourgeoisie et l'aristocratie partisanes de la « révolution conservatrice » et le parti nazi. Elle s'exprima par l'intermédiaire de Franz von Papen, qui avait lui-même joué un rôle essentiel pour qu'Adolf Hitler accède au rôle de chancelier...
Les S.A. ne connurent pas de réel bouleversement à partir de 1933. Cela peut sembler paradoxal, et ce problème théorique a été « résolu » de manière totalement idéaliste au moyen d'une interprétation fondamentalement erronée de la « nuit des longs couteaux » en juin 1934.
La liquidation de dirigeants S.A. qui a eu lieu alors ne tient pas spécifiquement à la base de la S.A., et d'ailleurs la répression frappe autant les milieux de la « révolution conservatrice ». La thèse d'une « gauche » de la S.A. se révoltant et exigeant une « seconde révolution » n'a pas de fondements.
La base des S.A. n'était pas unifiée, même si elle provenait de couches populaires. Dans les zones ouvrières les S.A. étaient en bonne partie eux-mêmes d'origine ouvrière, alors que dans les grosses villes du sud comme Munich ou Francfort sur le Main, il n'y avait pratiquement pas de S.A. faisant partie de la classe ouvrière...
Lors de la destruction de la population juive d'Europe par les nazis, seulement la moitié environ des personnes assassinées le furent de manière industrielle, au moyen des camps d'extermination, les sinistres Auschwitz, Treblinka, Bełżec, Sobibor, Chełmno, Majdanek.
Les nazis procédèrent à la « Shoah par balles », sur le tas, parallèlement à leurs conquêtes militaires. Cet aspect est totalement négligé et incompris en France, ce qui fut largement employé par les négationnistes niant qu'il y ait eu un « plan » d'extermination et niant les chambres à gaz, sans jamais parler et pour cause de la « Shoah par balles ».
Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que les S.A. avaient comme base idéologique un « socialisme national » prônant l'unité de l'Allemagne sur une base pangermaniste et sa « purification » du pouvoir de « l'argent ». Les choses s'arrêtaient là en termes de dynamique idéologique ; il s'agissait d'un anticapitalisme romantique, d'une sorte de « repli sur soi » absolu...
Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg, le 30 janvier 1933, à la suite d'un long processus de tractations. Le parti nazi était alors financièrement exsangue et la base des S.A. toujours plus pressée d'obtenir des résultats concrets.
En pratique, il s'agit donc d'une alliance entre le parti nazi et la fraction ultra-conservatrice, regroupant notamment le DNVP (Deutschnationale Volkspartei – Parti national-allemand du Peuple) et la « Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten » (« Casque d'acier », ligue des soldats du front).
Le DNVP faisait grosso modo entre 9 et 15 % des voix aux élections, quant au Stalhelm, c'était une milice d'un million de personnes. Ces structures, avec d'autres, s'étaient déjà alliées aux nazis dans le « Front de Harzburg » en 1931...
Le parti nazi disposait en réponse à cette tendance à la guerre et à la réaction de pas moins de trois organisations concernant l'économie, tissant des liens avec les grands capitalistes.
Le 31 janvier 1931 avait été fondé le « département de politique économique du NSDAP » (Wirtschaftspolitische Abteilung der NSDAP), où l'on retrouvera à la fois le directeur général de la Deutsche Bank Emi..l Georg von Stauß et le théoricien nazi de l'usure Gottfried Feder...
De cette structure sortit, d'octobre 1930 à octobre 1931, un « service de presse de politique économique » du NSDAP, à destination de 60 grands industriels, dont Fritz Thyssen, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Peter Klöckner, ou encore le responsable d'IG Farben Carl Duisberg par ailleurs chef de l'association nationale des industriels de 1925 à 1931...
« L'ennemi est à gauche ! », tel était le titre du « journal des employeurs allemands » du 17 octobre 1929. Si en 1918 le régime monarchique s'était effondré, l'appareil d’État était lui resté le même et les généraux pesaient de tout leur poids sur le régime républicain, dans une sorte d'alliance contre-nature avec la social-démocratie qui avait été aux premières loges pour écraser la révolution de 1918 dirigée par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg.
Les dirigeants de la social-démocratie étaient aux premières loges de la répression contre les communistes, avec notamment le ministre national de l'intérieur Carl Severering, le ministre prussien de l'intérieur Albert Grzesinski, le chef de la police berlinoise Karl Zörgiebel...
Lorsque nous pensons au féodalisme, nous pensons aux châteaux des chevaliers entourés des serfs. Cela est vrai pour le féodalisme du début, mais cela ne serait pas voir que le féodalisme s'est développé par la suite, pour atteindre la monarchie absolue.
Entre la phase initiale des châtelains isolés et celle finale du monarque absolu, il existe une longue phase où l'aristocratie est divisée en couches plus ou moins riches, plus ou moins propriétaires...
Gottfried Feder a « découvert » une « clef » pour que le national-socialisme ne soit pas simplement un nationalisme allemand opposé aux autres pays, mais également une force capable de mobiliser à l'intérieur du pays même, dans un sens de « réconciliation » des classes sociales.
L'ajout de Gottfried Feder, essentiel pour le national-socialisme, est le proudhonisme, c'est-à-dire l'affirmation qu'il existe un capital, même petit, dont l'activité est purement parasitaire. Que le capitalisme, en soi, n'est pas mauvais, s'il est relié au travail, alors que s'il existe de manière « autonome », alors il relève de l'usure...
C'est Carl von Clausewitz (1780-1831) qui théorisa toute la conception militaire prussienne, dans son ouvrage De la guerre, écrit surtout pendant les guerres napoléoniennes. Lorsque Carl von Clausewitz y affirme que « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens », il souligne l'importance de la fusion de l'armée et de la direction politique, de l'offensive militaire et de la société toute entière.
Lorsqu'il explique que « La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté », il exprime la vision aristocratique du principe hiérarchique.
C'est une conception directement pré-fasciste, directement issue de la Prusse où l'aristocratie s'est octroyée l'ensemble des postes de direction de l'armée, formant une sorte de caste, alors que pareillement le capitalisme était imposé par le haut...
Lors de la révolution française, la Prusse pensait profiter de son armée très organisée pour écraser ce qu'elle considérait comme des troupes éparpillées. La marche sur Paris fut cependant écrasée lors de la fameuse bataille de Valmy en 1792 : la levée en masse avait permis une gigantesque progression qualitative et quantitative.
Ce traumatisme fut suivi des guerres napoléoniennes, qui profitaient de l'élan républicain initial pour disposer d'armées puissantes. L'armée prussienne devait absolument se moderniser si elle voulait se maintenir, et elle le fit en organisant, par en haut, dans un esprit anti-démocratique, la levée en masse...
Les thèses de Rudolf Jung dans « Le socialisme national. Ses fondements, son devenir et ses buts » posent les bases de l'idéologie national-socialiste telle qu'elle a existé au départ.
Tout le début de l'oeuvre consiste en une histoire idéalisée du moyen-âge depuis Charlemagne. Rudolf Jung utilise ici en fait de manière démagogique le très haut niveau culturel des pays allemands et de la Bohème qui leur sont reliés durant la fin du moyen-âge, avec le formidable développement des villes et le grand élan humaniste...
Les positions de la « révolution conservatrice » n'ont pas directement influencé le national-socialisme, du moins pas avant la prise du pouvoir, puisque là l'intégration des forces ultra-conservatrices à ses propres forces a amené une synthèse aristocratique – national-socialiste.
Avant cette arrivée au cœur de l’État, et de la société allemande, le national-socialisme est une idéologie de la périphérie. L'Allemagne ne rassemblait en effet à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'au début du XXe siècle, pas du tout l'ensemble du peuple allemand. Des parties importantes existaient en dehors, commençant tendanciellement ou franchement à vivre une destinée nationale différente, au sein de la Bohême et de l'Autriche notamment...
 Y a-t-il une pensée Charu Mazumdar ?
Y a-t-il une pensée Charu Mazumdar ?
C'est l'une des questions les plus importantes dans le monde aujourd’hui. Y a-t-il une pensée Charu Mazumdar ? La révolution indienne, dans les années 1960, a-t-elle produit une pensée guide, par un dirigeant révolutionnaire ayant compris la nature de la société indienne ?
De nos jours, les révolutionnaires indiens disent que non, étant donné qu'ils rejettent le principe lui-même de pensée guide. Est-ce correct ? Regardons cela, comme c'est, ce 21 septembre, le dixième anniversaire de la fondation du Parti Communiste d'Inde (Maoïste)...
Ce qui est notable dans les S.A. était la division hiérarchique selon l'origine sociale. La base des S.A. était peuplée des classes les plus basses socialement, les cadres intermédiaires provenaient plutôt de la petite-bourgeoisie. Mais les dirigeants provenaient souvent de l'armée, à laquelle ils avaient appartenu avant même la guerre impérialiste de 1914-1918, et étaient d'origine aristocratique.
Cela n'est pas étonnant, car l'aristocratie, avec l'effondrement de la monarchie, s'est élancée dans une grande campagne idéologique anticapitaliste romantique, prônant une société « organisée » face au chaos capitaliste. Le terme employé pour désigner pour cette organisation sociale fut celui de « socialisme », désignant par là en réalité une société divisée en corporations avec l'armée comme colonne vertébrale...
Les S.A. avaient une démarche particulièrement agressive, principalement dans les années 1931-1932, années de guerre civile larvée. Un exemple parlant est la situation à Berlin en juin 1930 : en une semaine il y eut pas moins de 25 attaques par les S.A., avec comme bilan 5 morts, 38 grièvement blessés, 75 légers. Par la suite, la situation ne fit que s'envenimer.
Un autre exemple berlinois fut, le 12 septembre 1931, à l'occasion du nouvel an juif appelé Rosh Hashana, lorsque les S.A. menèrent une grande opération antisémite dans le quartier chic de l'avenue Kurfürstendamm (qui fait 3,5 kilomètres de long), dont un quart des personnes y vivant étaient juives...
D'où provient l'attribution à « Mein Kampf » d'une telle importance pour le national-socialisme, au lieu de voir les S.A. comme élément central ? En fait, la confusion a eu lieu car la bataille politico-militaire de la S.A. a été d'une violence inconnue pour la plupart des autres pays. On prétend ainsi encore en France qu'Adolf Hitler a été élu « démocratiquement », alors que les dernières élections de la république de Weimar en mars 1933 ont été marquées par une violence extrême des S.A..
Un autre aspect très important qui n'a pas été vu est que, justement, « Mein Kampf » traite notamment des S.A., dans le chapitre 9 de la seconde partie. C'est-à-dire que « Mein Kampf » pose justement les S.A. comme élément moteur du national-socialisme. Voici ce que dit Adolf Hitler...
La dimension paramilitaire, voire militaire, des formations politiques est une donnée essentielle des luttes de classe en Allemagne après 1918. A l'opposé de la France victorieuse, le pays est marqué par un changement de régime puisque la monarchie s'est effondrée, et doit de très importantes « réparations » de guerre.
Les forces réactionnaires sont très puissantes et tentent des coups d’État, alors que du côté révolutionnaire depuis l'échec de la révolution de 1918, c'est une lente et patiente réorganisation des très larges mouvements de masse qui a lieu, pavant la voie à un puissant Parti Communiste.
Dans ce contexte, Adolf Hitler donna l'ordre de formation de la S.A. dès le 3 août 1921. Depuis ce moment-là, les S.A. se considéreront toujours comme ayant une place à part, et ce même après 1933. Les S.A. se voyaient comme les soldats politiques du national-socialisme ; à leurs yeux, ce n'était pas les élections, mais leur propre mouvement qui avait permis l'avènement du régime hitlérien.
Versions pdf de la revue mensuelle L'Internationale de la première partie des années 1980.
L'idéologie national-socialiste est synthétisée le mieux dans la chanson de la S.A., intitulée chanson de Horst Wessel. Cette chanson n'a d'ailleurs pas été que l'hymne de la S.A., mais celle du parti nazi lui-même ; elle fut systématiquement chantée, de 1933 à 1945, après l'hymne allemand dans les cérémonies officielles.
Horst Wessel rejoignit le parti nazi en 1926 et devint une des principales figures de la S.A. berlinoise, extrêmement violente et étant dans une situation extrêmement difficile dans une ville étant un bastion communiste. Il fut par la suite exécuté dans des conditions obscures, liées plus ou moins à la prostitution, mais son histoire fut récupérée comme symbole par le parti nazi, qui en fit un martyr ; il fut même raconté que les autres S.A. refusèrent à un médecin juif d'intervenir alors qu'il était grièvement blessé, etc...
Le « national-socialisme » est un phénomène propre au capitalisme en crise : il s'agit d'une réponse qui lui est immanente, naturelle. Tentant de prolonger son existence, le capitalisme tente de s'unifier intérieurement, ce qui signifie nier les luttes de classe au sein de la société. A côté de cela, il s'agit de satisfaire ses propres besoins, et cela signifie la guerre.
Ces deux aspects ont besoin d'une idéologie qui soit commune, qui permette tant un aspect que l'autre, et tel est le sens du national-socialisme. La version la plus connue, car la plus aboutie, est bien entendu le national-socialisme qui a existé en Allemagne, avec Adolf Hitler à sa tête...
Le « Cercle Proudhon » fut une source d'inspiration pour le fascisme tentant de cimenter après 1918 en France, mais il n'a pas fourni de cadre idéologique bien déterminé. Tel était le prix à payer pour le proudhonisme.
Cependant, l'antisémitisme comme anticapitalisme romantique était tout à fait conceptualisé. Le premier article des « Cahiers », qui suit la « Déclaration », commence immédiatement par un antisémitisme très net. On lit ainsi :
Les « Cahiers » du « Cercle Proudhon » ne sont pas parvenus à une synthèse fasciste à laquelle sont parvenus en Italie le fascisme et en Allemagne le national-socialisme. Ces synthèses fascistes possédaient par ailleurs un tiraillement profond entre des tendances conservatrices et plébéiennes.
C'est précisément cet aspect qui a posé problème au fascisme français. Ce dernier a été incapable de dépasser la dynamique anti-démocratique pour arriver à proposer un projet de société. Le nationalisme a été proposé comme seul horizon, sans que soit proposé l'idéologie conséquente d'une société organique...
A partir du moment où Pierre-Joseph Proudhon proposait un romantisme économique, il était inévitable qu'il serve les utopistes et la bourgeoisie au XIXe siècle, et le fascisme au début du XXe siècle. Sa conception d'un « retour en arrière » coïncide avec l'exigence de la bourgeoisie de prétendre faire partir en arrière la roue de l'histoire, face au communisme.
De la même manière, l'ultra-modernisation de la fraction la plus agressive de la bourgeoisie ne pouvait avoir l'accord des masses, ainsi même qu'une mobilisation de soutien, que s'il existait idéologiquement un projet de société protectrice, et pas seulement conquérante...
Pierre-Joseph Proudhon a finalement la même conception que Eugen Dühring : il pense que des gens se sont imposés politiquement et qu'ils ont façonné l'économie selon leurs désirs. Il n'a pas compris le principe du mode de production. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'à gauche, soit on comprend au moins au minimum le principe du mode de production, soit on bascule dans le « socialisme français » de type fasciste.
Voici comment Karl Marx critique Pierre Joseph Proudhon sur ce plan...
Karl Marx constate dans Misère de la philosophie que Pierre-Joseph Proudhon a une analyse toute particulière du rôle de la machine. Proudhon est un petit-bourgeois, pour lui la machine équivaut à l'atelier, et par conséquent tant à l'existence d'un contre-maître que d'emplois circonscrits à une fonction bien précise.
Pierre-Joseph Proudhon ne veut pas de cela, car il a en tête l'artisan du moyen-âge, qui n'a personne au-dessus de lui et qui réalise lui-même toutes les étapes de la production d'un objet.
Voici comment Karl Marx résume le point de vue de Pierre-Joseph Proudhon...
Pierre-Joseph Proudhon entend réformer le capitalisme, par en quelque sorte le principe de la coopération des petits propriétaires. Personne ne doit en quelque sorte « arnaquer » personne et tout le monde doit payer une sorte de « juste prix ». C'est là une vision idéalisée des échanges directs, du troc.
Cette idéologie est de fait extrêmement puissante en France (Notre-Dame-des-Landes, la décroissance, etc.).
Ce « mutuellisme » dispose de forces permettant de réguler en quelque sorte le système. Il faut ainsi des mutuelles fournissant des crédits pour les investissements. Dans la logique de Proudhon, ces prêts se font sans intérêt, ou bien minime pour les frais d'administration. Il faut par contre fournir une caution, une hypothèque, etc. pour obtenir ce prêt. Pour les plus pauvres, il y a ainsi une « banque du peuple », échangeant des outils, des crédits, contre des heures de travail.
Quels sont les remèdes dont parle Karl Marx, et que Pierre-Joseph Proudhon prétend avoir trouvé ? Quels sont les antidotes que Pierre-Joseph Proudhon considère avoir découvert, afin de gommer les aspects mauvais de la propriété ?
Il vise, de fait, la fusion des travailleurs et de la bourgeoisie...
Mao Zedong a résumé la dialectique par la célèbre formule « un devient deux ». En Chine populaire, la lutte contre le révisionnisme a coïncidé avec celle contre ceux suivant la méthode « deux devient un ».
Pierre-Joseph Proudhon est en fait quelqu'un appliquant cette méthode du « deux devient un ». Il reconnaît la dialectique, mais la solution qu'il propose est de gommer le mauvais côté, au lieu de dépasser les deux aspects.
Toute sa démarche est celle du petit-bourgeois qui reconnaît les défauts de la propriété, mais considère qu'on peut effacer ceux-ci...
Comment Pierre-Joseph Proudhon argumente-il en faveur de son romantisme économique ? Dans Misère de la philosophie, Karl Marx constate, au départ, l'une des incroyables prétentions de Proudhon, qui, par ailleurs, a toujours été porteur d'une grande mégalomanie. En l'occurrence, Pierre-Joseph Proudhon prétend avoir « découvert » le premier l'opposition entre la valeur d'usage d'une chose, son utilité en quelque sorte, et sa valeur d'échange, c'est-à-dire sa valeur en tant que marchandise.
Or, Karl Marx note que David Ricardo l'a déjà dit...
On sait que l'un des premiers écrits de grande importance de Karl Marx, qui est né en 1818, consiste en les Manuscrits économico-philosophiques de 1844, qui seront publiés malheureusement bien après sa mort. On peut donc comprendre tout de suite l'importance de la lutte de Karl Marx contre Pierre-Joseph Proudhon en voyant qu'il a écrit une oeuvre directement en français, en 1847, pour attaquer celui-ci.
Le titre même, Misère de la philosophie, est une réponse à celui d'une œuvre de Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie de la misère, encore titré Contradictions économiques, et publié en 1846...
Conformément à l'idéologie ultra-libérale du fascisme, Proudhon est contre la démocratie. Tant le fascisme et le national-socialisme ont exprimé la toute-puissance de l’État, mais justement comme structure supérieure, au-delà des classes, au-delà du peuple, légitimant la division en corporations, s'appuyant sur des individus.
C'est le contraire du communisme s'appuyant sur le matérialisme, sur le fait que les être humains sont le produit de la nature, que leur pensée est le reflet du mouvement de la matière. Pierre-Joseph Proudhon est ici un théoricien du fascisme, niant l'humanité au nom des individus...
Pierre-Joseph Proudhon se fonde sur l'individu ; sa vision du monde ne dépasse pas l'individu, qui est ici présenté comme irréductible, capable de choix rationnel, de solidarité, mais qui reste centré sur son propre égoïsme.
Voici comment Pierre-Joseph Proudhon rejette le collectivisme...
Pierre-Joseph Proudhon est coincé à la base : d'un côté, il veut dénoncer la propriété. Mais à ses yeux, le problème concret est la propriété trop puissante. A ses yeux, le communisme n'est d'ailleurs qu'une propriété toute puissante, et donc tyrannique par définition.
La seule perspective qu'il lui reste est ainsi de proposer une une société de petits propriétaires. C'est le point de vue petit-bourgeois, s'exprimant par la notion d'esclavage individuel et l'exigence d'autonomie.
L'idéal de Pierre-Joseph Proudhon, c'est un « socialisme » d'individus disposant d'une propriété, c'est-à-dire une société décentralisée de petits propriétaires...
Proudhon est en quelque sorte quelqu'un admettant les thèses de Rousseau, mais en étant confronté à la réalité du capitalisme conquérant. Sa démarche est donc simple, voire franchement simpliste : l'organisation naturelle a été « perdue » en raison de la propriété, dont le féodalisme est une variante. Le capitalisme, quant à lui, est une accentuation de ce phénomène de « déperdition ».
Voici comment il exprime sa démarche...
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) est le Eugen Dühring français ; il est un socialiste qui ne considère pas le capitalisme comme un mode de production, avec une contradiction interne, mais comme un phénomène « isolé » dans l'histoire du monde.
Par conséquent, Pierre-Joseph Proudhon a formulé toute une vision du monde pour expliquer les sources de « l'oppression », et cela sur des bases idéalistes faisant lui un ennemi juré de Karl Marx et de Friedrich Engels...
L'une des conséquences de l'Anti-Dühring sera la demande de Paul Lafargue à Friedrich Engels de la rédaction d'un document fondé sur les derniers chapitres de l'oeuvre, qui sont une présentation du socialisme. La traduction de Paul Lafargue est publiée en en 1880 sous le titre de « Socialisme utopique et socialisme scientifique » et son succès est immense : dès 1895, l'ouvrage est déjà traduit en 14 langues, pour 57 éditions.
Cet ouvrage est de fait devenu un classique du mouvement ouvrier, une oeuvre incontournable pour toute personne désireuse de connaître le socialisme. Cependant, son importance historique témoigne des différences entre l'Allemagne, qui a une véritable social-démocratie, et la France ainsi que de nombreux pays...
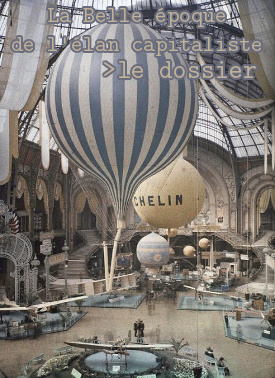 Nous avons vu que Eugen Dühring raisonnait en terme de vérités « éternelles » et qu'il s'appuyait sur l'esclavage pour tenter d'expliquer l'existence de la bourgeoisie. Il y a ici un point très important, car le matérialisme dialectique considère que le passage d'un mode de production à un autre est inévitable.
Nous avons vu que Eugen Dühring raisonnait en terme de vérités « éternelles » et qu'il s'appuyait sur l'esclavage pour tenter d'expliquer l'existence de la bourgeoisie. Il y a ici un point très important, car le matérialisme dialectique considère que le passage d'un mode de production à un autre est inévitable.
Or, justement, l'anticapitalisme romantique réfute cela. Historiquement, les variantes d'anticapitalisme romantique ont toujours combattu le matérialisme dialectique en affirmant que des formes anciennes, dépassées, étaient justement modernes, aboutissant au socialisme.
C'est le principe du romantisme, qui exprime la négation de la dimension progressiste historique du capitalisme, en prétendant que le moyen-âge, voire d'autres périodes précédentes, contiendraient les germes réels du socialisme...
« L'être et le néant » est un ouvrage de plus de 700 pages écrit par Jean-Paul Sartre et dont la date de parution, 1943, révèle immédiatement la nature. Au lieu de participer à la Résistance, Jean-Paul Sartre publie de manière tranquille un ouvrage philosophique idéaliste traitant de l'existence humaine dans des termes vagues et obscurs, à l'opposé de ce qui était nécessaire historiquement.
Le fond de la démarche est ainsi précisément le même que pour « Être et temps » de Martin Heidegger : il s'agit de contrer le matérialisme dialectique. En 1938, Jean-Paul Sartre avait déjà publié un roman exprimant le même état d'esprit individualiste et subjectiviste, La nausée. Après 1945, il sera une figure de proue, avec Albert Camus, de la gauche anarchisante à gauche du Parti Socialiste, feignant la radicalité révolutionnaire, notamment avec la revue Les temps modernes...
« Être et temps », écrit par Martin Heidegger en 1927, a eu une importance capitale pour la pensée bourgeoise française. Le paradoxe est qu'en France on s'imagine alors toujours que si c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, mais en réalité ni René Descartes, ni Henri Bergson, ni même Martin Heidegger n'ont eu d'impact mondial initialement. C'est justement par l'intermédiaire de Sartre et des auteurs post-modernes, tels Michel Foucault, Jacques Derrida, etc. que « Être et temps » va obtenir une renommée mondiale.
On a ici un exemple très expressif avec la page wikipedia consacré à l'ouvrage qui dans la version française explique que « Être et temps » est « le livre qui a le plus influencé la pensée du XXe siècle », alors que les versions anglaise et allemande expliquent sobrement que l'oeuvre a marqué la base pour l'existentialisme, le structuralisme et les auteurs post-modernes, qui d'ailleurs sont des courants français...
Le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès rappelle un événement historique marqué par de très nombreuses contradictions, permettant à tout le monde de se revendiquer de cette figure socialiste, et cela de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Il y a lieu de souligner l'importance de ce phénomène, fruit de l'histoire de notre pays.
Pourquoi Nicolas Sarkozy, le Front National, François Hollande, le Parti « Communiste » français... peuvent-ils se prétendre représenter l'esprit de Jaurès ?...
Ce qui est frappant dans le roman L'étranger, c'est que le personnage n'a aucun intérêt à part lui-même dans son existence immédiate. Lorsque sa petite-amie lui propose de se marier, il est d'accord de manière vague, car en fait il ne se projette jamais. De la même manière, il apparaît « indifférent » à la mort de sa mère, ou lorsqu'il tue une personne sur la plage. Tout cela lui semble abstrait. Albert Camus, en fait, dresse ici le portrait de ce que Martin Heidegger a appelé le « dasein » et Edmund Husserl, avant lui, l'intentionnalité.
Pourquoi est-ce que, en France, Martin Heiddegger est si connu dans les milieux bourgeois, bien plus que Edmund Husserl ? Cela tient à ce que Martin Heidegger a résolu des problèmes inhérents à la démarche d'Edmund Husserl ; il a comblé les manquements rendant inopérants l'ensemble. Sa principale trouvaille tient à un concept, appelé « dasein », exposé dans l'oeuvre appelé Être et temps, publié en 1927.
Dans ce Être et temps, Martin Heidegger tente d'aller plus loin qu'Edmund Husserl, de combler ce qui pose un problème fondamental : le rapport entre la conscience et le fait de vivre. En effet, Edmund Husserl a fait comme René Descartes, acceptant de séparer l'esprit du corps. On en arrive à une conscience pure, cela est clair pour tout le monde. Cela renforce l'idéalisme, c'est très bien pour la bourgeoisie.
La démarche d'Edmund Husserl ne tombe, bien entendu, pas du ciel sur le plan intellectuel. En fait, Edmund Husserl reprend directement la méthode de Descartes. C'est cela qui fait que les conséquences de la phénoménologie – l'existentialisme, le « queer », etc. - seront massivement présentes en France, tant sur les plans intellectuel que culturel.
Voici ce que dit Edmund Husserl à ce sujet dans l'introduction de ses Méditations cartésiennes, dont le sous-titre est « Introduction à la phénoménologie ». L'oeuvre en elle-même est issue de deux conférences sur la phénoménologie faites à la Sorbonne, en février 1929...
Juste après la fin de la citation précédente de Jean-Paul Sartre, on trouve un passage très parlant puisque celui-ci se revendique de Pierre Duhem, que Lénine avait justement critiqué.
Jean-Paul Sartre dit ainsi :
« L'essence d'un existant n'est plus une vertu enfoncée au creux de cet existant, c'est la loi manifeste qui préside à la succession de ses apparitions, c'est la raison de la série.
Au nominalisme de Poincaré, définissant une réalité physique (le courant électrique, par exemple) comme la somme de ses diverses manifestations, Duhem avait raison d'opposer sa propre théorie, qui faisait du concept l'unité synthétique de ces manifestations. »
 Il existe deux œuvres « classiques », au cœur du véritable mythe idéologique créé par la bourgeoisie autour de la phénoménologie. La première est Être et temps de l'allemand Martin Heidegger, la seconde est L'être et le néant de Jean-Paul Sartre.
Il existe deux œuvres « classiques », au cœur du véritable mythe idéologique créé par la bourgeoisie autour de la phénoménologie. La première est Être et temps de l'allemand Martin Heidegger, la seconde est L'être et le néant de Jean-Paul Sartre.
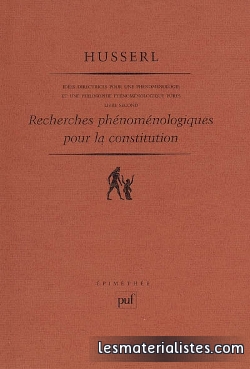 L'existentialisme et le pessimisme ont une base idéologique très bien organisée, avec une place-forte universitaire ; celle-ci a le nom de « phénoménologie ». Tant l'existentialisme de Jean-Paul Sartre que la philosophie de Martin Heidegger, au cœur du « pessimisme », s'appuient directement sur la phénoménologie.
L'existentialisme et le pessimisme ont une base idéologique très bien organisée, avec une place-forte universitaire ; celle-ci a le nom de « phénoménologie ». Tant l'existentialisme de Jean-Paul Sartre que la philosophie de Martin Heidegger, au cœur du « pessimisme », s'appuient directement sur la phénoménologie.
L'idéologie de la bourgeoisie développée reflète nécessairement le pessimisme d'une classe condamnée par l'histoire. Pour cette raison, la bourgeoisie a développé toute une réflexion sur l'existence, s'exprimant dans l'approche de la vie par l'existentialisme, en philosophie par la phénoménologie, dans les arts et les lettres par l'art contemporain et le « nouveau roman ».
Cette putréfaction de la bourgeoisie en tant que classe contamine nécessairement, de par les formidables moyens de celle-ci tant intellectuellement que matériellement, l'ensemble de la société. Cela est particulièrement flagrant lorsqu'on regarde tel ou tel scénario d'une superproduction cinématographique, ou bien les attitudes générales qui existent sur internet.
Aristote a laissé un œuvre très précise au sujet de la question de la constitution et du droit. Dans La politique, il exprime la thèse très connue selon laquelle l'homme serait un « animal politique ». Mais cela va de pair avec sa vision du monde, où toutes les choses sont « ordonnées ».
L'oeuvre aura un grand retentissement, car c'est pas moins qu'Alexandre le grand qui sera le disciple d'Aristote, témoignant des richesses de la démarche. Il connaîtra également justement un « faux », le Secretum Secretorum, qui va être le document peut-être le plus connu au moyen-âge.
Sans doute d'origine arabe et datant du Xe siècle, on y trouve de prétendues lettres d'Aristote à Alexandre le Grand, expliquant la politique, la santé, l'astronomie, et même parfois l'alchimie, avec la fameuse « Table d'émeraude » (« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »)...
Aristote a posé le principe de « Dieu » de la manière la plus développée. Tant le judaïsme que le christianisme et l'Islam ne pourront pas ne pas puiser chez lui. C'est lui qui a véritablement porté la définition d'un Dieu comme conséquence logique d'une certaine vision du monde.
Aristote prétend, de fait, non pas formuler quelque chose de nouveau, mais en revenir aux « sources », afin de masquer précisément la nouveauté de sa thèse...
Aristote a donc formulé l'idée d'un « premier moteur », qui permet à des « formes » de façonner de la matière. Seulement, on voit mal alors au fond quelle est la différence, en apparence, avec Platon. On pourrait dire en effet que le « premier moteur » est un équivalent du « un », les « formes » étant ce que Platon appelle les « idées ».
Il y a une nuance de taille cependant, car Aristote a modifié le schéma de Platon. Chez ce dernier, l'un et les idées sont au ciel. Comme il avait besoin de justifier comment on arrive à la matière, il a utilisé les « nombres », qui sont un « sas » entre les idées et la matière (qui est ainsi « formulée » par les nombres).
Aristote abaisse les idées, qu'il appelle « formes », pour les mettre dans notre propre monde. De cette manière, le rapport entre la matière et ce qui la forme est « direct », par « la puissance » et « l'acte »...
Aristote est le véritable titan de l'antiquité grecque. Si la figure de Platon est davantage connue, c'est parce que celui-ci a joué un rôle moteur dans l'affirmation de l'idéologie chrétienne.
Toutefois, c'est Aristote qui parvient à développer le plus profondément les questions scientifiques et cela, dans pratiquement tous les domaines. Il intervient de fait à un moment historique, celui où, enfin, la Grèce parvient à s'unifier.
Aristote est en effet macédonien, de la ville de Stagire, et c'est lui qui va éduquer pendant deux décennies le grand unificateur : Alexandre le grand. Le grand problème, évidemment, sera qu'Alexandre le grand n'a pas fait qu'unifier la Grèce en s'opposant à la Perse, comme le voulait son père, il a également conquise celle-ci, pour arriver aux portes de l'Inde. Cela a liquidé un problème d'unification pour en aboutir à un autre...
Platon n'avait en fait pas le choix dans ses propositions stratégiques concernant l’État idéal. Sa proposition stratégique de formation d'un régime ultra-hiérarchisé - qui est la même que son maître Socrate - correspond en effet aux intérêts de toute une frange de l'élite athénienne, non seulement par rapport aux esclaves, mais par rapport aux « hommes libres » eux-mêmes.
Il faut, pour saisir cela, regarder l'histoire de la Grèce antique. Lorsqu'on parle de celle-ci, on entend la Grèce actuelle, avec également ce qui fut appelé la grande Grèce, c'est-à-dire les côtes méridionales de la péninsule italienne, ainsi que la Ionie, c'est-à-dire la façade ouest de l'actuelle Turquie.
La tradition de Pythagore est liée à la grande Grèce, celle qui s'est tournée plutôt vers des questions scientifiques étant liée à la Ionie. Mais en Grèce même, ces divers penseurs ne recevaient que peu d'écho, car à l'époque prédominait comme idéologie le paganisme bien connu des dieux Zeus, Poséidon, Athéna, etc...
Il ne faut pas perdre de vue que l'oeuvre de Platon se situe dans une perspective de construction politico-religieuse. Il n'y a pas d'originalité particulière dans la démarche de Platon, sa seule particularité étant de tenter de combiner les deux principales traditions « philosophiques » qui avaient, de fait, le même but.
Socrate, le maître de Platon, était d'ailleurs un pythagoricien, croyant en l'éternité de l'âme, étant végétarien, etc. Platon était donc de son côté un « héraclitéen », mais penchant vers les valeurs « socratiques ».
Cela a donc un sens à la fois politique et religieux, car Socrate est un moraliste, et la morale sert justement de base à la politique. Des œuvres qui nous restent de Platon (à savoir uniquement les dialogues, le reste étant perdu), c'est bien sûr dans l'ouvrage appelé la République que l'on retrouve établis les principes politico-religieux conseillés par lui.
Héraclite est une figure importante de l'antiquité grecque, car il va tenter une fuite en avant qui va redonner de l'impulsion à la « philosophie ». Il avait en effet conscience que les efforts de l'école ionienne ne pouvaient qu'aboutir à l'athéisme par les sciences naturelles.
Partant de là, il tenta de relancer le concept de Dieu, en expliquant que ce qu'était Dieu c'était le principe même du changement. Comme Dieu est tout, le changement est tout, jusqu'au nihilisme. Héraclite est ainsi connu pour son expression à la fois dialectique et incompréhensible, puisque selon lui tout est tout le temps en contradiction et c'est donc également le cas de toute affirmation, y compris par Héraclite lui-même...
Thalès avait ouvert une perspective très concrète : étudier le « multiple » pour comprendre comment, derrière, il y avait un ordre, un Dieu. Il fut à l'origine d'une véritable tradition, d'une réflexion de fond visant à syntéthiser un monothéisme en s'appuyant sur la réalité matérielle elle-même, en tentant d'en expliquer l'origine.
Anaximandre, qui vécut au 7e siècle av. JC, fut le disciple de Thalès, et comme ce dernier, il tenta de comprendre ce qu'était la « matière ». Cependant, il ne mit pas en avant l'eau, mais en quelque sorte ce qu'on pourrait définir comme une sorte de grande boîte, de grand réservoir, où va tout ce qui a été et d'où provient tout ce qui sera.
Comme bien entendu, il y a une infinité de choses, alors cette « boîte » est infinie...
Les pythagoriciens sont, historiquement, surtout liés à la grande Grèce, les parties de l'actuelle Italie qui ont été colonisées par des Grecs. Comme on l'a vu leur attention s'est surtout porté sur Dieu, sur « l'un », c'est-à-dire Dieu en tant qu'être unique, le monde consistant en les chiffres, le « multiple ».
C'est le processus inverse qui s'est développé en Ionie, région consistant actuellement en l'ouest de la Turquie. Il existait alors une fédération de villes : Chios, Éphèse, Érythrée, Clazomènes, Colophon, Lébédos, Milet, Myonte, Phocée, Priène, Samos, Téos et Halicarnasse.
Pythagore vient de Ionie, mais son idéologie s'est répandue en grande Grèce ; la tradition ionienne est partie quant à elle dans une autre direction : celle de la compréhension du multiple, du monde réel, de la physique...
Avant Empédocle, deux « philosophes » ont tenté de modifier la perspective de Pythagore. Xénophane et Parménide avaient cherché à renforcer le côté divin, afin de donner plus de poids à l'établissement de la dimension ouvertement religieuse.
Xénophane, qui vécut au VIe siècle avant J.-C., témoigne du combat déjà fort marqué contre le polythéisme, Homère étant bien entendu une cible évidente dans ce combat, de par sa célébration de l'ancienne époque, et de par ses dieux aux traits humains.
Xénophane affirmait la religion comme vision explicative de l'univers, ce qui ne pouvait aller avec une perspective simplement anthropocentriste des « dieux »...
L'échec de Pythagore appelait à être comblé. L'une des figures les plus marquantes fut alors Empédocle d'Agrigente, ville se situant aujourd'hui dans le sud de l'Italie.
On a de nouveau ici une figure mystique, se présentant comme une figure divine, un véritable porteur de message divin.
Empédocle se présente donc comme un sauveur ; lui aussi a en fin de compte une démarche politico-religieuse. Sa perspective est évidemment pythagoricienne, mais il tente de combler un problème théorique, en étant clairement influencé par la pensée indienne...
La démarche de Pythagore, qui a vécu au Ve siècle avant JC, a ainsi une fonction dans le cadre de la lutte de classes. Elle se situe dans le cadre historique où la Grèce passe d'un régime de tribus éparpillées et marqué par un certain communisme primitif, à un régime esclavagiste.
Pythagore produit une nouvelle idéologie unifiant ces tribus et même, dans l'idée, les cités-Etats, ainsi que le style qui doit être propre à la nouvelle classe dominante. Cela n'alla pas sans heurts ni complications. De fait, Pythagore partit à Crotone, où les pythagoriciens prirent le pouvoir, pour en être finalement chassés.
Par la suite, il semble que les pythagoriciens dominèrent une zone entre Métaponte et Locres, puis à Tarente. De la même manière, les révoltes renversèrent les pythagoriciens : ce fut l'échec de la tentative de Pythagore...
Pythagore est le point de départ, au VIe siècle avant notre ère, de ce qu'on appelle la « philosophie » de la Grèce antique ; la tradition veut d'ailleurs qu'il soit à l'origine du terme.
Un philosophe est un ami de la sagesse (sophia en grec), la restriction par rapport au fait d'être sage (soi-même en tant que tel) vient du fait que, selon Pythagore, seul Dieu est réellement sage. Le philosophe c'est, en quelque sorte, l'ami de Dieu.
On voit donc ici qu'on est déjà dans le monothéisme, et ainsi il est faux de considérer que le culte d'un seul Dieu ne se serait produit qu'en Egypte avec Akhénaton, ainsi qu'avec les Hébreux. La conception du caractère unique de Dieu est un passage théorique obligé lors de la prise en considération de la réalité et de la réflexion sur l'univers. On est ici à un stade peu élevé de cosmologie, et Dieu est le moyen de fournir la base de l'explication du cosmos, de l'univers...
 L'Iliade et L'Odyssée, écrites par une ou plusieurs personnes que l'histoire a résumé en la figure de Homère, est une œuvre très connue et également populaire en France. On a tendance à considérer, en raison de cela, que la Grèce de l'Antiquité était une sorte de région du monde composée d'Ulysse, d'Ajax et d'Agamemnon, peuplant des cités bien établies, d'un haut niveau culturel, etc.
L'Iliade et L'Odyssée, écrites par une ou plusieurs personnes que l'histoire a résumé en la figure de Homère, est une œuvre très connue et également populaire en France. On a tendance à considérer, en raison de cela, que la Grèce de l'Antiquité était une sorte de région du monde composée d'Ulysse, d'Ajax et d'Agamemnon, peuplant des cités bien établies, d'un haut niveau culturel, etc.
Toutefois, ces œuvres datent en réalité d'entre 850 et 750 avant notre ère, alors que l'apogée de la civilisation grecque antique se déroule lors du 5e siècle avant notre ère. Ainsi, si les oeuvres écrites attribuées à une figure historique (par ailleurs douteuse) appelée Homère a bien relevé de l'éducation de la jeunesse masculine de la Grèce antique, elles représentent surtout des mythes et légendes ayant une fonction politique.
Quelle est la raison de cela ? Elle est simple : c'est le passage d'une civilisation de tribus marquée par le patriarcat et le partage communautaire à un peuple organisé ayant constitué ses institutions et étant divisé en classes sociales....
La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne (GRCP) en Chine populaire a eu une gigantesque influence de par le monde. Nous sommes alors à la fin des années 1960, et des petits noyaux révolutionnaires soutenant Mao Zedong parviennent alors à se structurer, en s'appuyant sur l'élan de la GRCP, ce qui aboutit à l'apparition dans de nombreux pays d'un « Parti Communiste Marxiste-Léniniste », comme le Parti Communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste (TKP/ML), le Parti Communiste d'Espagne (Marxiste-Léniniste), le Parti Communiste d'Inde (Marxiste-Léniniste), etc.
Rares sont cependant les organisations qui ont su se maintenir, malgré parfois un rôle historique certain dans leur pays, notamment le PC d'Espagne (ML) à travers la phase armée du Front révolutionnaire antifasciste et patriote.
En France, la situation relève pareillement de l'échec. En fait, initialement, il y a bien la formation d'un Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France (PCMLF), qui a la reconnaissance de la Chine populaire et se revendique de la GRCP. Toutefois, la direction relevait d'un semi-révisionnisme qui fut toujours plus franc, et passa au soutien de la fraction réactionnaire en Chine, celle de Deng Xiao Ping...
La situation imposée par la tentative de coup d'Etat de Lin Piao était extrêmement difficile. Les droitistes avaient des arguments contre la gauche, puisque Lin Piao avait été une figure majeure de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne. Pour cette raison, Deng Xiaoping put revenir à la direction du Parti, qui était divisée en trois fractions principales :
- celle de Mao Zedong et de dirigeants de gauche, notamment de Shanghai ;
- celle des droitistes, menée par Deng Xiaoping ;
- celle des centristes, conduite par Zhou Enlai, qui privilégiait l'efficacité étatique...
En apparence, en 1969, la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne avait été un succès plein. Cependant, l'intervention de l'armée pour appuyer les rebelles et les gardes rouges posait un problème concret. En l'occurrence, lors du IXe congrès, le responsable de l'armée, Lin Piao, formula un document pour dire que la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne était précisément terminée.
De la même manière, Lin Piao se posait contre la réhabilitation des cadres ayant fait leur autocritique, et il sabotait le remplacement des comités révolutionnaires, supervisés par l'armée, par les comités provinciaux. En fait, Lin Piao comptait profiter de la situation pour que l'armée prenne le contrôle du Parti et du pays.
En pratique, des 170 membres du Comité Central issu du IXe congrès du Parti Communiste de Chine, 74 étaient des représentants de l'Armée Populaire de Libération, et 38 d'entre eux étaient des commandants ou commissaires régionaux...
Le transfert de pouvoir à la Triple Union dans la ville de Shanghai devint un modèle pour tout le pays, où le principe fut appliqué zone par zone, les dernières étant celles du Sinkiang et du Tibet en septembre 1968 et annoncées dans un éditorial commun du Quotidien du Peuple et du Quotidien de l'armée.
Cela n'alla pas sans mal. Dans la ville de Wuhan, les gardes rouges et les rebelles, au nombre de 400 000, affrontait la faction du « Million de héros » qui profitait de l'appui du général Chen Zaidao, qui fit même arrêter Xie Fuzhi, un dirigeant révolutionnaire envoyé par Mao Zedong pour ordonner au général de cesser un tel soutien.
Dans le Hunan, il y a également la fraction ultra-gauchiste du Shengwulian (Comité d'Union des révolutionnaires prolétariens du Hunan), qui devient le centre névralgique de l'ultra-gauchisme dans tout le pays...
C'est à Pékin que le mouvement des gardes rouges prit son envol au départ, la jeunesse de tout le pays affluant dans la capitale chinoise pour rejoindre officiellement l'initiative. Toutefois, le mouvement des gardes rouges émula les masses en général, qui se lancèrent dans la bataille politique ; la question dépassait désormais la simple jeunesse.
Par conséquent, les usines furent également touchées, avec une vague de révolte contre l'organisation du travail mise en place par les partisans de la voie capitaliste. Les ouvriers se lançant dans ce mouvement prirent le nom de « rebelles » et de « révolutionnaires prolétariens ».
La ville de Shanghai devient alors l’abcès de fixation de la bataille. Shanghaï est en effet alors le premier centre industriel de Chine, et dix millions de personnes y vivaient. Les forces conservatrices au sein du Parti Communiste y étaient particulièrement fortes...
Les pays impérialistes ont célébré hier les 70 ans du débarquement allié en Normandie, afin de se présenter comme des forces positives historiquement. Elles n'ont cependant pas pu masquer les contradictions inter-impérialistes, avec tout un jeu pathétique entre Barack Obama et Vladimir Poutine, obligeant d'ailleurs François Hollande à dîner avec le premier pour aller ensuite « souper » avec le second.
Cependant, le débarquement allié reste un événement foncièrement positif de l'histoire du monde, au-delà de la récupération faite hier, en présence du président français François Hollande, de la chancelière allemande Angela Merkel, des présidents américain et russe Barack Obama et Vladimir Poutine, ou encore de la reine d'Angleterre...
L'objectif des Gardes Rouges était de frapper les partisans de la voie capitaliste infiltrés dans le Parti, afin de protéger la Pensée Mao Zedong, et donc par là la nature authentique du Parti Communiste de Chine.
Furent ainsi organisées des campagnes de dénonciation, par l'intermédiaire de l'agitation et de la propagande, avec les dazibaos en particulier, jusqu'à parvenir à généraliser des mouvements de masses forçant les cadres révisionnistes à s'avouer vaincus et à faire leur autocritique.
La règle était de ne pas utiliser de violence physique et de ne frapper que la petit minorité de cadres soutenant le révisionnisme, afin que les masses s'approprient entièrement l'expérience de la critique des révisionnistes...
Le mouvement des gardes rouges se fonde sur la « pensée Mao Zedong » ; l'objectif du mouvement est la diffusion de celle-ci et comme le formule Le Quotidien du peuple dans le titre de son éditorial du 1er août 1966 : « Tout le pays doit être une grande école de la pensée de Mao Zedong. »
La pensée Mao Zedong n'est pas simplement la pensée de Mao Zedong ; c'est un concept qui exprime ce que Mao Zedong a synthétisé de la Chine du point de vue du matérialisme dialectique. C'est le marxisme appliqué aux conditions concrètes de la Chine, et cela dépasse donc largement la simple personne de Mao Zedong.
Vu de l'extérieur, sans compréhension du principe de « pensée », nombre d'observateurs ont simplement cru voir une apologie de Mao Zedong, alors qu'il s'agit d'une question d'interprétation idéologique dans un contexte précis...

Le 16 mai 1966, le Parti Communiste de Chine produit une circulaire visant à critiquer le groupe composé de cinq personnes chargé de la question de la révolution culturelle.
Ce document, accompagné par d'autres, ouvrit la porte à une révolte de masses, dont le détonateur fut à la fin mai 1966 une affiche à grands caractères écrits à la main, un « dazibao », critiquant la direction de l'université de Pékin pour aller dans le sens du révisionnisme.
Face à la répression, les activistes à l'origine du dazibao (qui est suivi par d'autres), s'organisèrent en gardes rouges, menant des opérations d'agitation et de propagande contre les partisans de la « ligne noire »...
Voici comment la situation de la période juste avant la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne est présentée dans un éditorial du Hongqi (le drapeau rouge) de 1966.
La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne (GRCP) a été un phénomène essentiel de l'histoire du socialisme chinois, et elle suit directement le grand bond en avant. Pour comprendre son sens, il faut saisir la grande compréhension qu'a eu Mao Zedong de la question de l'idéologie et de son rapport avec l'opinion publique, en deux points essentiels, intrinsèquement liés.
Déjà, Mao Zedong avait constaté la prise du pouvoir sans accrocs réels réussi par le révisionnisme en URSS : une fois le pouvoir pris par en haut, les forces révolutionnaires y furent liquidées administrativement sans réel souci, au moyen de purges s'étalant de 1953 à 1956.
Dans ce contexte et avec cette compréhension, Mao Zedong fut en mesure d'approfondir l'analyse du phénomène révisionniste. L'un des exemples frappants fut la pièce de théâtre intitulée La Destitution de Hai Rui, écrite par le vice-maire de Pékin Wu Han. On y voit comment un fonctionnaire inspecteur est condamné par l'empereur pour avoir fait exécuter un fils de noble ayant tué un paysan et enlevé sa fille...

Le Grand Bond en Avant n'a pas été à la hauteur des attentes du Parti Communiste, les terribles conditions climatiques, avec des sécheresses et des inondations à grande échelle, étant le problème principal. La production agricole a baissé de 13 % en 1959, et de 14 % en 1960. En 1961, la production était redescendue au même niveau qu'en 1952. L’État chinois a dû acheter 5 millions de tonnes de céréales par an sur le marché international.
Mais ce n'était pas tout. L'URSS soutenait une faction révisionniste et a interrompu son aide à la Chine dans son entreprise de sabotage de la lutte anti-révisionniste initiée par Mao Zedong. En 1960, 15 000 ingénieurs et employés soviétiques quittèrent la Chine du jour au lendemain, après avoir détruit tous les plans en leur possession.
Cela a mis un frein brutal à la production industrielle, qui a chuté de 38 % en 1961, et encore de 16 % en 1962...
Pour les authentiques communistes de Chine, la question était très facile à comprendre. Ils devaient faire face à deux dangers, qui formaient une possibilité imminente de restauration contre-révolutionnaire.
Le premier danger était la tentation pragmatique d'autoriser les entreprises capitalistes comme un « outil » du développement des forces productives. Le second danger était la prise du pouvoir par les spécialistes et les cadres d’État, entraînant la destruction du Parti.
En URSS, la première menace était portée principalement par le boukharinisme et le trotskysme, et le seconde par la clique de Khrouchtchev...
 Pourtant, il existait déjà un fort courant révisionniste dans le Parti lui-même, un courant s'opposant à la collectivisation, ayant les mêmes positions que Tito, Gomulka, etc. dans les pays d'Europe de l'Est.
Pourtant, il existait déjà un fort courant révisionniste dans le Parti lui-même, un courant s'opposant à la collectivisation, ayant les mêmes positions que Tito, Gomulka, etc. dans les pays d'Europe de l'Est.
Durant la période 1945-1949, l'Armée Populaire de Libération, composée d'un million deux cent mille soldats et officiers, a dû affronter le Guomindang (4,3 millions de soldats) qui bénéficiait du soutien de l'impérialisme américain, avec 50 000 marines pour protéger les sites stratégiques, 100 000 autres dans la province côtière du Shandong, ainsi que de l'équipement, de l'entraînement et des transports fournis à quelque 500 000 soldats.
Mais la capacité à mobiliser les masses autour de l'idéologie communiste – la guerre populaire – a été la clé du succès. Dans la bataille décisive de Hsupeng, 800 000 soldats du Guomindang ont du affronter seulement 660 000 soldats de l'Armée Populaire de Libération, mais ces derniers recevaient de l'assistance de 600 000 soldats irréguliers et de 5,3 millions de personnes.
Dans ce contexte de victoire sur toute la Chine continentale en 1949, la situation était très difficile en raison de l'inflation, des pénuries de nourriture, mais aussi de la rareté des transports et des moyens de communication. Les chemins de fer étaient détruits. La Chine n'avait même pas de service météorologique, ni d'usines de bicyclettes. Pas seulement à cause de la guerre : la situation arriérée de la Chine aggravait la situation...
L'objectif de la Démocratie Nouvelle était déjà compris depuis longtemps par Mao Zedong. Et sa compréhension de la situation chinoise a en effet été intégrée par le Parti Communiste de Chine.
Lors de son septième congrès, du 23 avril au 11 juin 1945, 754 délégués représentant 1,2 millions de membres du parti ont soutenu le rapport de Mao Zedong intitulé « Du gouvernement de coalition ».
Mao explique dans ce rapport :
Après l'effondrement du régime nazi en Allemagne, et étant donné le rôle joué par l'Union Soviétique dans ce processus, beaucoup de pays d’Europe de l'est sont devenus des « démocraties populaires ».
On retrouve ce même processus dans deux pays d'Asie : l'Armée Rouge (d'URSS) n'y a pas libéré le pays, mais a fourni un appui stratégique important aux forces armées communistes qui ont libéré la Chine et la moitié nord de la Corée.
Quand le Parti Communiste a libéré la Chine en 1949 pour former la « République Populaire », le pays est devenu en pratique similaire aux « démocraties populaires » d'Europe. Ce n'est pas le socialisme qui a été organisé, mais une union des forces progressistes sous la direction du Parti Communiste.
Dans le combat contre les tendances erronées après 1945, les communistes d'URSS ont eu comme base non pas le matérialisme dialectique, mais la défense de la constitution de 1936, ainsi que le matérialisme historique concernant le développement économique.
Cela a eu des conséquences fatales. Comme l'avait souligné Staline, les meilleures forteresses se prennent de l'intérieur, et une clique de révisionnistes a pu réussir à placer ses membres dans l'appareil d'Etat, pour renverser l'idéologie à la direction du Parti à la mort de Staline, finalisant la démarche lors du XXe congrès du Parti Communiste d'Union Soviétique, en 1956.
La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie doit avant tout à l'Armée Rouge, qui a battu l'écrasante majorité de l'armée allemande, libérant toute une série de pays, pavant la voie aux démocraties populaires.
Cependant, après 1945, une intense lutte de classes se déroula en URSS. Celle-ci ne sera cependant pas réellement apparente, mais c'est elle qui va aboutir à un coup d’État suite à la mort de Staline, en 1953.
Cette lutte de classes n'est pas liée tant à la période d'avant 1941 qu'aux conditions provoquées par la seconde guerre mondiale impérialiste. Celle-ci a posé un problème terrible, en plus des innombrables destructions : 34,4 millions de personnes y ont participé, dans l'Armée Rouge ; 9,1 millions de personnes y ont laissé la vie, alors que dans la population civile, 15 millions de personnes ont également été tuées.
 La vie soviétique souffrait d'un manque certain de biens de consommation, en raison de la nécessaire accumulation de capital dans l'industrie lourde, qui elle seule pouvait permettre un travail au meilleur rendement et donc justement une base matérielle d'existence pour les consommateurs.
La vie soviétique souffrait d'un manque certain de biens de consommation, en raison de la nécessaire accumulation de capital dans l'industrie lourde, qui elle seule pouvait permettre un travail au meilleur rendement et donc justement une base matérielle d'existence pour les consommateurs.
Le trotskysme, à partir de 1934 en tant que tel, n'est plus du tout un courant d'opposition, mais un magma de structures clandestines, liées à l'étranger à tout ce qui était favorable à un changement de régime en URSS, donc notamment aux services secrets étrangers ayant des visées impérialistes sur des parties du territoire soviétique (Allemagne, Japon, mais également Grande-Bretagne par rapport à l'Asie centrale).
Staline notait ainsi, en 1937 : « Dans la lutte qu'ils mènent contre les agents trotskistes, nos camarades du Parti n'ont pas remarqué, ont laissé échapper le fait que le trotskisme actuel n'est plus ce qu'il était, disons, sept ou huit ans plus tôt ; que le trotskisme et les trotskistes sont passé durant ce temps par une sérieuse évolution qui a modifié profondément le visage du trotskisme ; qu'en conséquence, la lutte contre le trotskisme, les méthodes de lutte contre ce dernier, doivent être radicalement changées. »...
Il existe une contradiction entre l'affirmation de la Constitution et la nécessité de la répression à l'égard de la contre-révolution.
Le régime soviétique a toujours dû faire face à d'intenses activités contre-révolutionnaires, allant de la propagande au terrorisme. Pour cela, il a organisé une structure, qui a changé de nom historiquement.
Il y a ainsi au départ la Tchéka (Commission extraordinaire), de 1917 à 1922, puis le GPU (Direction Politique d’État) jusqu'en 1934, date à laquelle il cède la place au NKVD (Commissariat du peuple aux Affaires intérieures)...
L'industrialisation et le développement d'une armée de cadres permit au Parti bolchevik de former une société socialiste, au grand dam des bourgeoisies des pays impérialistes, qui n'auront de cesse de critiquer la « dictature » et par la suite le « totalitarisme ».
L'URSS signifiait en effet alors une nouvelle citoyenneté, avec des individus s'assumant comme membres de la société. Dans le domaine des arts et des lettres, le réalisme socialiste s'imposait comme la forme la plus élevée de civilisation, l'URSS produisant toute une série d'artistes assumant l'héritage, suivant le réalisme et ancrés dans le peuple.
Sur tous les plans, la société de l'URSS progressait à pas de géant ; les masses se mobilisaient pour le socialisme, les plans étaient régulièrement finis en avance, comme par exemple le deuxième plan quinquennal de l’industrie réalisé en avril 1937, avec neuf mois d'avance...
La construction du socialisme posa certains problèmes, principalement dans l'équilibre entre les initiatives prises, dans la connexion entre les différentes étapes.
Le plan quinquennal avait un objectif très clair : industrialiser l'URSS, qui était isolée du reste du monde, contrôlé par les capitalistes. Le pays devait de lui-même réaliser des centaines d'usines de constructions mécaniques, de machines-outils, d'automobiles, de produits chimiques, de moteurs, d'outillages pour centrales électriques, d'artillerie, de tanks, etc. etc.
Il y parvint. Au début des années 1930, l'industrie formait la majorité de l'économie. Elle avait rattrapé le niveau d'avant-guerre en 1926-1927 et représentait en 1933 201 % du niveau de 1929, alors qu'en même temps, en raison de la crise générale du capitalisme, l'industrie des États-Unis passait à 65 % par rapport à 1929, d'Angleterre à 86 %, de France à 77 %, d'Allemagne à 66 %.
Cela ne veut pas dire que l'URSS avait alors rattrapé ces pays. Tant sur le plan électrique que métallurgique, le retard était encore très grand. La production de fonte visait, en 1929-1930, 5,5 millions de tonnes, la France en produisant alors presque le double, et l'Allemagne un peu moins du triple...
L’issue, c’est de passer des petites exploitations paysannes dispersées aux grandes exploitations centralisées...
La ligne de Trotsky, Kamenev et Zinoviev ne pouvait conclure qu'à une seule chose : maintenir l'Etat en tant que tel mais ouvrir l'industrie au capitalisme privé, notamment aux capitalistes étrangers, afin qu'ils investissent. C'est en quelque sorte ce que Deng Xiao Ping parviendra à réaliser en Chine populaire dans les années 1980.
Une telle ligne n'avait aucune chance de réussir dans un Parti ayant mené la révolution socialiste et entendant construire le socialisme, à la suite de l'élan donné par Lénine...
La figure la plus importante du courant refusant de considérer la NEP comme un « sas » au socialisme fut Trotsky. Et il fut par ailleurs par la suite parlé de trotskysme pour désigner les différentes variantes de « l'opposition » au sens du Parti Communiste d'Union Soviétique (bolchevik).
A la différence de Staline, qui lui était un vieux bolchevik compagnon de Lénine et familier des conceptions de celui-ci, Trotsky était un penseur totalement indépendant par rapport au léninisme, auquel il s'est par ailleurs opposé durant toute la période avant 1917...
Lénine fut grièvement blessé lors d'un attentat mené contre lui par les Socialistes Révolutionnaires de gauche, et sa santé déclinant, c'est en novembre 1922 qu'il fit son dernier discours, au Soviet de Moscou. Il rappelait que « la NEP [la nouvelle politique économique] continue d'être le mot d'ordre principal, immédiat, universel d'aujourd'hui », et conclut « en disant de la Russie de la NEP sortira la Russie socialiste ».
C'était bien entendu une affirmation en faveur de la construction du socialisme en Russie même. Mais à la suite de la vague gauchiste se produisit une vague droitière, niant cette possibilité même. C'était l'expression de la capitulation...
Une fois la victoire sur le « gauchisme » effectué, le Parti bolchevik put passer à l'étape suivante : du « communisme de guerre », on passa alors à la « nouvelle politique économique ». La liberté du commerce fut en partie acceptée ; les paysans pouvaient commercer avec ce qui était produit au-delà de l'impôt.
En mars 1922, lors du 11e congrès du Parti bolchevik, Lénine constatait ainsi un an après le lancement de la « nouvelle politique économique »...
C'est dans ce contexte que s'ouvrit le Xe congrès du Parti bolchevik, en mars 1921. Il comptait plus de 730 000 membres et avait triomphé dans la guerre civile : l'armée rouge avait battu l'armée blanche.
Il y avait toutefois la question de l'organisation économique, et le point de vue de Lénine, s'il était hégémonique, dut faire face à une intense rébellion. Différents courants remettaient en effet en cause le principe de la centralisation et de la direction de la société par le Parti. Ils représentaient des courants petits-bourgeois en opposition au principe des directives mis en avant par la classe ouvrière.
Ils exprimaient le refus petit-bourgeois de ce que Lénine considérait comme central : le recensement et le contrôle, bases élémentaires pour gérer la société.
La révolution russe ayant triomphé du tsarisme et de la bourgeoisie en 1917, c'est la question du socialisme qui se pose et qui est formulée par Lénine, une nouvelle fois. Celui-ci n'a donc pas été que le dirigeant de la révolution russe et du parti des bolchéviks : il est également celui qui organise le socialisme dans la période suivant la révolution.
Or, le problème est évidemment que les masses qui ont fait la révolution n'ont nullement l'habitude de gouverner, c'est-à-dire d'organiser et de gérer. Il y a là une contradiction fondamentale, que Lénine formule de la manière suivante en décembre 1917, dans « Comment organiser l'émulation ? »...
Lénine a été victime en 1918 d'un attentat organisé par les populistes « socialistes révolutionnaires », et les séquelles seront terribles, Lénine souffrant terriblement, depuis, de migraines et d'insomnies jusqu'aux alertes cardiaques en passant par un AVC, la paralysie, etc. Il mourra en 1924, après deux années finales d'une vie terriblement douloureuse.
Toutefois, il a laissé deux choses qui vont après sa mort façonner la Russie et avec elle toute l'Union soviétique.
En affrontant la petite production comme réalité, Lénine récuse le gauchisme comme maladie infantile du communisme, qui est le produit de cette réalité, qui nie la centralisation nécessaire pour la réorganisation de l'économie du point de vue socialiste. Lénine conçoit ainsi véritablement le socialisme comme phase transitoire et il critique les gauchistes qui conçoivent la révolution socialiste sans intégrer les caractéristiques de cette phase transitoire.
Voici ce qu'il explique dans La maladie infantile du communisme (le "gauchisme")...
« L'histoire du mouvement ouvrier montre aujourd'hui que dans tous les pays, le communisme naissant, grandissant, marchant à la victoire, est appelé à traverser une période de lutte (qui a déjà commencé), d'abord et surtout, contre le "menchevisme" propre (de chaque pays), c'est-à-dire l'opportunisme et le social-chauvinisme; puis, à titre de complément, pour ainsi dire, contre le communisme "de gauche". »
Tel est le point de Lénine, qui s'impose dans la victoire sur le gauchisme en 1921 qui a profité d'un grand travail théorique de Lénine...
 La révolution socialiste s'était imposée, mais deux forces entendaient ne pas faire durer le nouveau régime : d'un côté, les impérialistes de l'Entente, qui avaient perdu leur allié russe, craignaient la paix et la diffusion du socialisme, et de l'autre les forces réactionnaires en Russie même.
La révolution socialiste s'était imposée, mais deux forces entendaient ne pas faire durer le nouveau régime : d'un côté, les impérialistes de l'Entente, qui avaient perdu leur allié russe, craignaient la paix et la diffusion du socialisme, et de l'autre les forces réactionnaires en Russie même.
Ces deux forces n'avaient pas d'autres choix que de converger. Seule l'Entente disposait des moyens matériels, et seules forces réactionnaires disposaient de cadres, issus de l'armée, et de personnes capables de rejoindre une éventuelle armée contre-révolutionnaire, à partir des réseaux des paysans riches – les koulaks – et des cosaques, population rassemblée de manière semi-militaire et dont les membres devinrent des gendarmes tsaristes...
La tentative bourgeoise de construire sa propre République et de supprimer les forces bolchéviks avait échoué. Sous la direction de Lénine, les bolchéviks avaient démasqué le régime et possédaient la majorité dans les Soviets des députés ouvriers et soldats de Moscou et Saint-Pétersbourg.
Lénine rentra d'exil en Finlande pour participer à la réunion du Comité Central, qui prit une résolution historique :
 Après Février 1917, Lénine se voit obliger de suivre en urgence le principe de « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire » et de publier une étude sur l’État. Si auparavant la question du pouvoir politique ne semblait pas se poser, la situation politique exige une action révolutionnaire conséquente, ce qui demande une base théorique solide.
Après Février 1917, Lénine se voit obliger de suivre en urgence le principe de « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire » et de publier une étude sur l’État. Si auparavant la question du pouvoir politique ne semblait pas se poser, la situation politique exige une action révolutionnaire conséquente, ce qui demande une base théorique solide.
Or, Lénine fait face à deux soucis. Tout d'abord se pose la question de ce qu'est l’État socialiste ; pour cela, il va puiser dans les études de la Commune de Paris effectuées par Karl Marx...
 Lors de la 1re Guerre Mondiale, la Russie ne fut pas en mesure de mener la guerre correctement. Son état-major était corrompu, parfois de mèche avec les impérialistes allemands ; seule l'Autriche-Hongrie connaissait une situation du même type, avec tout son système de défense de déjà connu par l'espionnage russe.
Lors de la 1re Guerre Mondiale, la Russie ne fut pas en mesure de mener la guerre correctement. Son état-major était corrompu, parfois de mèche avec les impérialistes allemands ; seule l'Autriche-Hongrie connaissait une situation du même type, avec tout son système de défense de déjà connu par l'espionnage russe.
L'organisation du front était médiocre, voire sabotée qui plus est ; le ravitaillement devint toujours plus catastrophique, y compris pour les villes. De plus en plus, il était clair que la Russie tsariste allait proposer une paix séparée, et c'est pourquoi les impérialistes anglais et français aidèrent la bourgeoisie russe à l'organisation d'une révolution de palais, afin de déposer le tsar Nicolas II et de mettre à sa place un tsar lié à la bourgeoisie, Michael Romanov.
Cela révèle la nature fragile du régime tsariste et les bolcheviks menèrent la bataille révolutionnaire, dans le prolongement de leur opposition à la guerre impérialiste. La vague de grève au début de l'année 1917 se transforma en grève politique et en révoltes ouvertes, avec l'armée passant ouvertement dans le camp des révoltés, faisant de ceux-ci des insurgés à l'assaut du tsarisme.
L'épuration dans le POSDR a correspondu avec la remontée des mouvements de grève ; entre 725.000 et un million de prolétaires seront en grève en 1912, ce qui revient aux chiffres d’un million d’ouvriers en grève en 1906 et de 740.000 en 1907.
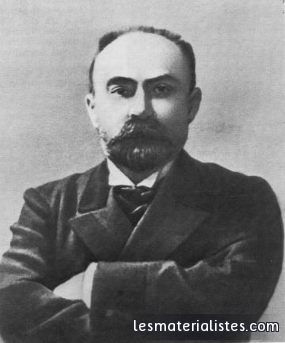 A l'aube de la révolution russe, Lénine a donc réussi à construire une organisation révolutionnaire d'un nouveau type. Il est nécessaire de voir comment Lénine a compris le marxisme, à la fois grâce à Georgi Plekhanov, et contre lui.
A l'aube de la révolution russe, Lénine a donc réussi à construire une organisation révolutionnaire d'un nouveau type. Il est nécessaire de voir comment Lénine a compris le marxisme, à la fois grâce à Georgi Plekhanov, et contre lui.
Initialement, Georgi Plekhanov était un populiste, mais il s'est remis en cause en prenant connaissance des thèses de Marx et Engels. Il a poussé à l'agitation dans les rangs de la classe ouvrière naissante, même s'il considérait comme central les « rébellions paysannes ».
A vingt ans, il devint ainsi l'un des protagonistes principaux de la genèse de la première manifestation politique en Russie, le 6 décembre 1876 à Saint-Pétersbourg. Il y a également tenu un grand discours, les masses le protégeant de toute arrestation; par la suite, il dut se réfugier à Berlin, Paris et Genève, afin de revenir en Russie et de passer dans la clandestinité...
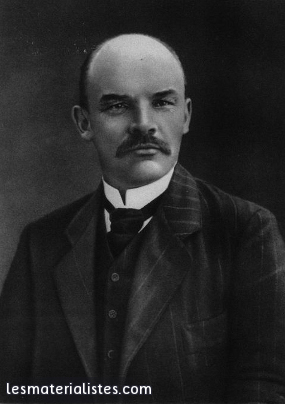 Après une période où le tsarisme fit semblant de prôner le compromis, il réinstalla son pouvoir autocratique en 1907 en supprimant toute importance du parlement. C'est le coup d'Etat du 3 juin 1907, qui installe un parlement dont le découpage électoral et les critères de votes servaient purement et simplement la réaction.
Après une période où le tsarisme fit semblant de prôner le compromis, il réinstalla son pouvoir autocratique en 1907 en supprimant toute importance du parlement. C'est le coup d'Etat du 3 juin 1907, qui installe un parlement dont le découpage électoral et les critères de votes servaient purement et simplement la réaction.
Sur 442 députés, il y avait 171 ultra-réactionnaires (les Cent-Noirs), 113 octobristes représentant les grand industriels et les grands propriétaires fonciers, 101 constitutionnels-démocrates (les « cadets ») représentant en quelque sorte la bourgeoisie, 13 représentants de la petite-bourgeoisie...
La conséquence directe de l'interprétation léniniste de la Russie tsariste est la reconnaissance idéologique et politique de la classe ouvrière. Dès sa fondation, l'union à laquelle appartient Lénine mène une grande grève de 30.000 ouvriers du textile, des groupes essaimant en prenant l'union comme modèle.
Un grand pas est alors fait avec la formation du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (P.O.S.D.R.), regroupant les « Unions » de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev, Iekaterinoslav, ainsi que le « Bund », structure regroupant des socialistes d’origine juive. Lénine est alors exilé et ne participe pas à cette fondation, mais son document de 1898 - « Les tâches des sociaux-démocrates russes » – montre son importance théorique et pratique...
 La Russie n'a pas toujours été un vaste territoire ; elle naît comme dans un processus de conquête, à partir de Moscou, contre les Tataro-mongols et leur royaume appelé la « Horde d'or ». Entre 1300 et 1796 se forme alors la Russie par la conquête féodale, avec l'appui de l’Église orthodoxe.
La Russie n'a pas toujours été un vaste territoire ; elle naît comme dans un processus de conquête, à partir de Moscou, contre les Tataro-mongols et leur royaume appelé la « Horde d'or ». Entre 1300 et 1796 se forme alors la Russie par la conquête féodale, avec l'appui de l’Église orthodoxe.
On assiste, ainsi, à la formation très tardive d'un royaume, formation permettant un élan féodal. Cela explique que, alors qu'en Europe occidentale il est procédé à des débuts de réforme agraire, en Russie le phénomène inverse se déroule : en 1649, le servage est instauré, liant le paysan et ses descendants à une terre et son propriétaire féodal...
Pour les communistes et pour notre Parti, faire le bilan de l'Internationale Communiste, spécialement celui de son VIIe Congrès avant la seconde guerre mondiale et au rôle du camarade Staline, représente une tâche impérative...
Les succès du révisionnisme dans les démocraties populaires étaient parallèles à ceux de l'URSS. Mais cette dernière était par ce chemin devenue un social-impérialisme, entendant bien faire des pays de l'Est européen ses semi-colonies.
A l'opposé, le triomphe des révisionnistes de type titiste dans les démocraties populaires ne pouvait que contribuer à l'émergence du nationalisme ouvert, sans maquillage « socialiste ». C'est pour cette raison que, dans le prolongement du triomphe révisionniste en Hongrie après 1953, on en arriva à l'insurrection de Budapest en octobre – novembre 1956.
La victoire du révisionnisme en Union Soviétique, avec Nikita Khrouchtchev comme dirigeant, impliquait nécessairement d'écraser les forces révolutionnaires des démocraties populaires. L'une des étapes importantes en ce sens fut la dissolution du Kominform, le 17 avril 1956.
Un tel acte était une grande offensive contre l'histoire même des démocraties populaires. A côté de cela, Khrouchtchev organisa l'alliance avec les forces révisionnistes des démocraties populaires, malgré le fait qu'elle soient orientées vers le nationalisme, et donc tendanciellement vers une certaine rupture avec l'URSS.
Article d'Akrami Yari, fondateur du mouvement maoïste en Afghanistan.
Qu'est-ce que le capitalisme bureaucratique ? La compréhension de cette forme sociale est au plus profond du noyau du maoïsme. Selon le maoïsme, il y a deux types de pays : les pays impérialistes d'un côté, et les pays opprimés de l'autre. Ces pays opprimés sont semi-coloniaux, semi-féodaux.
La démocratie populaire est un régime allant au socialisme, par étapes. Dans ce cadre, le rythme était différent selon les situations, mais il y avait deux objectifs : briser les grands propriétaires terriens et distribuer les terres, pour amener à collectiviser les terres ensuite ; s'assurer du monopole des grandes industries.
Cela allait de pair avec le renforcement de l'idéologie socialiste : c'était une bataille au sein de la démocratie populaire afin que le camp du socialisme gagne sur la réaction.
Les réussites des Fronts populaires amènent une première grande contradiction au sein du mouvement communiste. Il existe en effet une perspective pour la réaction : utiliser ce Front contre le Parti Communiste.
C'est ce qui se passe en Yougoslavie, où le Parti Communiste est dissous, littéralement, dans le Front National ; le Parti Communiste de Yougoslavie devient une sorte de société secrète, il n'existe plus du tout de manière publique.
 La période 1945-1948 a consisté en la bataille pour la victoire du front organisé par les communistes, front des progressistes devant paver la voie à la démocratisation générale de la société et par là même permettre l'affirmation du socialisme.
La période 1945-1948 a consisté en la bataille pour la victoire du front organisé par les communistes, front des progressistes devant paver la voie à la démocratisation générale de la société et par là même permettre l'affirmation du socialisme.
La Tchécoslovaquie est en quelque sorte le modèle des démocraties populaires
 Au lendemain de 1945, la situation est très différente dans chacun des pays de l'Est européen. Dans certains cas, les communistes ont joué un rôle particulièrement fort, dans la continuité de la situation d'avant-guerre, et profitent d'une popularité incroyable. C'est le cas en Tchécoslovaquie.
Au lendemain de 1945, la situation est très différente dans chacun des pays de l'Est européen. Dans certains cas, les communistes ont joué un rôle particulièrement fort, dans la continuité de la situation d'avant-guerre, et profitent d'une popularité incroyable. C'est le cas en Tchécoslovaquie.
Maurice Thorez a porté une ligne qui n'était pas matérialiste dialectique.
Maurice Thorez a réussi à façonner le PCF à son image, tout comme Maurice Thorez a été façonné à l'image du PCF.
La conception même du communisme est nécessairement falsifiée par Maurice Thorez dans un sens économiste.
La position de Maurice Thorez s'est nécessairement accompagné d'une remise en cause du matérialisme dialectique.
L'une des caractéristiques du réformisme de type social-démocrate est de limiter les revendications sociales à la question de l'amélioration, du fait de rendre la vie plus facile. Il y a ici à la fois une dimension prolétarienne réelle, et une manipulation psychologique et des sentiments.
Maurice Thorez se précipite systématiquement dans ce travers réformiste, il en use de bout en bout, avec une démagogie certaine...
Le PCF a réussi à s'imposer comme un parti politique puissant et participant à la vie institutionnelle, par l'intermédiaire du Front populaire. Le problème est que celui-ci n'est, en fin de compte, qu'une forme gouvernementale traditionnelle, avec simplement un appui extérieur.
Le PCF n'a aucune culture insurrectionnelle.
A partir du moment où les institutions sont reconnues, à partir du moment où l'ennemi est présenté comme étant une oligarchie (et non plus la bourgeoisie), alors la voie est ouverte pour le refus de la guerre civile, objectif pourtant central des communistes.
Avec le succès du Front populaire, Maurice Thorez transforme le PCF en une sorte de « Front de Libération Nationale » devant allier toutes les masses contre une petite poignée d'oppresseurs.
Plus jamais le PCF ne changera de culture, prônant toujours une démocratie plus développée et appelant au rassemblement des forces de gauche en défense de la République face à la réaction...
Maurice Thorez a été la grande figure du PCF pour avoir réussi à combiner syndicalisme révolutionnaire et forme partidaire de type « social-démocrate » dur ; c'est lui qui a été l'artisan de l'acceptation du régime républicain bourgeois au nom de la possibilité, mécanique, de l'accumulation des forces...
L'une des expressions les plus claires de l'adaptation pragmatique-machiavélique organisée par Maurice Thorez est la disparition de la question de la bourgeoisie, au profit du thème de l'oligarchie, de la simple toute petite minorité ennemie.
Si le matérialisme historique explique que le fascisme est porté par la fraction la plus agressive de la bourgeoisie, l'ensemble de la bourgeoisie est toutefois considérée comme placée sous la dépendance de celle-ci. Il n'y a pas d'oligarchie remplaçant la bourgeoisie ; chez Maurice Thorez, c'est pourtant le cas...
Face au coup de force fasciste et face à la guerre, le PCF a proposé le Front populaire, qui a un énorme écho. Il n'est cependant pas capable de le porter comme tactique devant le porter à un palier supérieur, il n'est pas en mesure de prendre l'initiative.
Le coup de force fasciste de février 1934 a montré que le PCF avait raison de constater le processus de la fascisation ; par conséquent, il comptait profiter de sa clairvoyance politique.
Le PCF est cependant incapable de maintenir une ligne directrice, de par les manquements terribles dans les domaines culturels et idéologiques...
Le moment clef pour Maurice Thorez et le PCF se déroule le 6 février 1934, lorsqu'a eu lieu une grande manifestation d'extrême-droite à Paris, devant la Chambre des députés.
Cela a eu comme conséquence l'intervention immédiate de la classe ouvrière, y compris par la lutte armée. Le PCF en profite pour s'engouffrer dans la ligne qui va être au fur et à mesure celle du Front populaire.
La question de la révolution démocratique est d'une grande importance pour les communistes en France.
Non pas parce que cette révolution serait à l'ordre du jour – la révolution française a en effet été le modèle du genre à l'époque où la bourgeoisie jouait un rôle révolutionnaire dans l'histoire de la lutte des classes.
Mais parce que la révolution démocratique est une question actuelle pour l'écrasante majorité des masses mondiales, qui vivent une oppression caractérisée par la domination des pays impérialistes, en alliance avec les forces féodales ou néo-féodales locales...
Maurice Thorez est parvenu à la direction du PCF car ce dernier était devenu un appareil bureaucratique, coupé de la base. Maurice Thorez s'est fait le porte-parole de la base, en réclamant « l'élection régulière des directions de cellules, de rayons, de régions et du Comité central, et l'obligation pour toutes les directions de rendre compte de leur activité » (Démocratie syndicale).
Dans le fameux article « Pas de "mannequins" », il développe longuement cette ligne, affirmant que « La tendance à la secte, c'est-à-dire à la méfiance vis-à-vis des masses, a comme conséquence la méfiance à l'égard même du Parti et de ses militants […]. Elle aboutit, consciemment ou non, à la formation, à l'intérieur du Parti, de petits clans fermés, étroits. »...
Maurice Thorez a été la grande figure du Parti Communiste français. Avant lui, le PCF n'était qu'un assemblage de différents courants opposés voire antagoniques et largement marqués soit par le réformisme, soit par l'anarcho-syndicalisme...
Le processus lancé par l'Internationale Communiste a porté ses fruits, l'identité communiste apparaissant comme plus net. Aussi s'appuie-t-elle désormais sur plus de soixante Partis Communistes, avec 3,1 millions de membres, dont 785 000 en-dehors de l'URSS.
Le 6e congrès de l'Internationale Communiste s'est tenu du 17 juillet au 1er septembre 1928. C'est la première fois qu'un aussi grand écart existe entre la tenue des congrès, et la raison en a été la difficulté de procéder à la bolchevisation.
Face aux défis lancés par le prolongement de la crise et face aux erreurs profondes des Partis Communistes, l'Internationale Communiste affirma la ligne de la « bolchévisation ».
Le 4e congrès de l'Internationale Communiste se tint du 5 novembre au 5 décembre 1922 ; le 7 novembre 1922 fut une date particulièrement importante, puisque marquant le 5e anniversaire de la révolution socialiste en Russie.
A ce moment-là, 66 Partis Communistes formaient l'Internationale Communiste, pour un nombre total de 1,2 million d'activistes. 408 délégués venus de 58 pays étaient présents au congrès.
Le 3e congrès de l'Internationale Communiste se tint du 22 juin au 12 juillet 1921. Son contexte était devenu différent des deux précédents congrès. Cette fois, la Russie révolutionnaire était solidement organisée, mais inversement, les révolutions socialistes tant attendues en Europe ne s'étaient pas produites, malgré de grands événements comme les occupations de fabriques en Italie, la grève de décembre en Tchécoslovaquie, ou bien n'avaient pas triomphé – comme en Hongrie et en Bavière.
Le deuxième congrès de l'Internationale Communiste se tint du 19 juillet au 7 août 1920, à Moscou, comme de fait tous les futurs congrès. Après le congrès du lancement l'année précédente, ce congrès devait être celui de l'organisation.
L'Internationale Communiste naît directement de la décision des bolchéviks à la suite de la révolution russe, avec à l'esprit notamment la révolution allemande...
En peu de temps, l'Eglise reprit le dessus; après avoir organisé un accord avec la noblesse hussite, elle put reconquérir son hégémonie et écraser définitivement le hussitisme au moyen de l'Autriche et de l'idéologie baroque...
Thomas Müntzer, le grand réformateur à côté de Martin Luther, était un dirigeant populaire-révolutionnaire, faisant référence au hussitisme. Voici à titre documentaire son Manifeste de Prague...
L'Eglise, force sociale avec de fortes traditions sut se montrer plus habile que les forces nouvelles, en appuyant autant que possible l'opportunisme...
Après l'écrasement du communisme taborite, c'est le républicanisme plébéien praguois qui fut écrasé; par la suite, le mouvement hussite tenta d'aller de l'avant et mena des contre-croisades qui furent de grands succès.
Tant la noblesse que la bourgeoisie ne pouvaient pas admettre la valorisation de la démarche communiste effectuée au sein des Taborites...
Le communisme avait à Tabor une forme millénariste : la fin des temps avait comme contenu l'abolition des classes sociales, le collectivisme...
Tabor comme lieu de rassemblement de masse fut le lieu d'une effervescence sans pareil. Les prêcheurs populaires-révolutionnaires avaient réussi à synthétiser une ligne pour mobiliser les masses...
C'est l'utilisation de chariots par les masses en guerre qui fut l'un des phénomènes ayant le plus frappé lors des guerres hussites...
Des dizaines de milliers de personnes se rassemblant sur les collines, alors que dans les villes les masses s'arment: c'est l'insurrection hussite...
(fr. 115 D) Il est une loi fatale, un antique décret des dieux, | à jamais confirmé par leurs serments sans réserves : | si quelqu'un, par sa faute, souille sa main d'un meurtre | ou s'il ose violer un serment, | 5 | (lui, daimone dont la vie s'étend dans les siècles), | pendant trente mille saisons il errera loin des bienheureux, | revêtant successivement les formes mortelles de toutes sortes, | passant de l'un à l'autre des douloureux sentiers de la vie. | Tel je suis aujourd'hui exilé loin des dieux, errant, | 10 | soumis aux fureurs de la Haine... (fr. 117 D) | car j'ai déjà été garçon et fille, et arbrisseau et oiseau et dans la mer un muet poisson. | ... (fr. 139 D) Hélas ! pourquoi un jour sans pitié ne m'a-t-il pas détruit, | avant que mes lèvres eussent connu l'œuvre criminelle de la nourriture ? ... (fr. 119 D) | 15 | Loin de quel honneur, de quelle félicité sans bornes suis-je misérablement déchu dans les régions mortelles |....
(fr. 118 D) J'ai pleuré, j'ai sangloté en voyant cette demeure inaccoutumée |... (fr. 121 D) cette demeure sans joie | où le Meurtre, le Ressentiment et le reste des Kères | 20 | (les maladies repoussantes, les contagions, les œuvres périssables) | parcourent la ténébreuse prairie d'Até | ... (fr. 122 D) Là étaient la Terrestre et la Solaire aux yeux perçants, | la Guerre ensanglantée et l'Harmonie au doux regard, | la Beauté et la Laideur, la Lenteur et la Hâte, | 25 | l'aimable Sincérité, la Dissimulation à l'œil sombre |... (fr. 123 D) la Naissance et la Mort, la Torpeur et la Veille, | la Mobilité et l'Immobilité, la Grandeur couronnée | et l'Humilité, la divine Taciturnité et la Parole | ... (fr. 120 D) Nous arrivâmes sous cet antre couvert …
La mise à mort de Jan Hus fut un véritable détonateur de la lutte de la noblesse, de la bourgeoisie et des masses contre l'Eglise.
Jan Hus est celui qui a synthétisé les prédications pragoises et formulé celles-ci politiquement, sous la forme d'un averroïsme politique ouvert, mais cependant religieux, dans une perspective de morale individuelle.
LIVRE XI
Chapitre 1
LIVRE VI
Chapitre 1
LIVRE I
Chapitre 1
La Métaphysique
Si la royauté privilégiait un hussitisme modéré pour contre le clergé, elle fut cependant déborder par la noblesse qui tendait empêcher l'émergence d'une monarchie absolue...
« A la nuit succède le jour qui nous éclaire et nous invite au travail »: Thomas Stitny a une conception qui pave directement la voie au protestantisme.
Les prédicateurs se montrèrent des tribuns formidables, critiquant d'un côté l'ordre dominant et galvanisant le révolte de l'autre, dans une Prague aux conditions sociales explosives...
Au début du 15e siècle, Prague est une ville riche, un centre humaniste, la troisième en superficie en Europe après Rome et Constantinople...
Après Marsile de Padoue, c'est l'anglais John Wyclif qui va de nouveau mettre en avant la thèse de la prédominance de la royauté sur l’Église.
L'antisémitisme a toujours son « bon juif », et parfois, c'est le Bund...
L'affirmation par l'averroïsme de la séparation du spirituel et du temporel avaient eu un formidable écho au sein des couches cultivées et les forces féodales en contradiction avec l'Eglise dominante depuis l'âge gothique vont directement l'utiliser l'averroïsme.
La Bohême du début du 15e siècle est marquée par une lutte de classes sans précèdent dans l'histoire, qui vont faire émerger pour la première fois les masses sur le devant de l'histoire comme force communiste...
Nous avons présenté l'Arthashastra, écrit par le ministre indien Kautilya - Chāṇakya (environ 350-283 avant notre ère) ; voyons quelles en sont les thèses.
D'un coté il y a un État et une administration, de l'autre il y a la science politique. Ce qui donne cela :
« Celui qui connaît bien la science politique (…) peut jouer à sa guise avec les rois qu'il enchaîne à son intellect. »...
Pour comprendre la démarche de Machiavel (1469-1529), il faut raisonner en terme de « positions ». Pour cela, on peut reprendre l'exemple de Vauban, le grand stratège militaire ayant organisé des citadelles pour protéger des invasions le régime de Louis XIV. Voici comment il formule le principe du « pré carré », dans une lettre à François Michel Le Tellier de Louvois en janvier 1673, Louvois étant qui plus est l'organisateur des fameuses « dragonnades », ces opérations militaires extrêmement brutales pour convertir de forces les protestants...
En plus de ses Maximes, Richelieu a laissé un Testament politique, mais également une correspondance de 7000 pages. Et Richelieu n'est bien sûr pas le seul à avoir formulé son avis ; toute l'époque est marquée d'ouvrages sur la politique...
« En faisant voir qu'on a plus de cœur pour faire des conquêtes que de tête pour les conserver, on fait paraître qu'on est vrai Français. »
Il y a 120 ans, le 26 décembre 1893, naissait Mao Zedong !
Nous saluons sa mémoire avec une grande ferveur révolutionnaire, dans l'esprit du matérialisme dialectique, en pleine connaissance du fait que Mao Zedong est une figure historique de la bataille pour le communisme.
Mao Zedong a appliqué le marxisme-léninisme dans les conditions concrètes de la Chine ; il a dirigé le Parti Communiste de Chine, le menant de victoire en victoire face aux réactionnaires chinois et à l'impérialisme japonais...
Il y a 120 ans naissait Mao Zedong, grande figure du matérialisme dialectique, au point que ses apports (on peut en consulter de nombreux sur maozedong.fr) forment le maoïsme, troisième étape du marxisme, la seconde étant le léninisme.
Richelieu a ouvert une nouvelle voie : celle de l'interprétation des individus par rapport à leur positionnement ; c'est une démarche essentielle à la dynamique pragmatique-machiavélique...
Ce qui est caractéristique d'une vision pragmatique-machiavélique, c'est qu'il y a toujours « quelque chose à dire », toujours un « positionnement » à avoir...
L’Italie des années 1970 et du début des années 1980 est une très grande référence pour les communistes, en raison du très haut niveau de « conflictualité » qui s'est développé, pour reprendre justement un concept italien.
Les luttes de classes ont été particulièrement fortes, et une multitude de groupes armés est apparue ; l'organisation la plus connue consistait naturellement en les Brigades Rouges.
La question du pouvoir était ouvertement posée, à la différence d'avec les extrêmes-gauches légalistes, syndicalistes, associatives, populistes, etc. existant alors dans toute l'Europe de l'Ouest, et particulièrement en France...
Richelieu est matérialiste, dans la mesure où il pense que l'étude d'un phénomène et les actions adéquates permettent d'aboutir à la situation la moins mauvaise. Cependant, son matérialisme a des limites de classe...
Le régime de la monarchie absolue était autoritaire, en rupture avec la noblesse et la féodalité, et cela non pas dans le sens d'aller en direction d'une sorte de « dictature individuelle », mais bien en direction de l'intérêt général...
Le cardinal de Richelieu a synthétisé son expérience dans des « Maximes ». Il y expose la valeur de l'expérience pratique, la nécessité d'appréhender les phénomènes en les évaluant...
Tant les fortifications de Vauban que la ville créée par Richelieu, et bien sûr Versailles, témoignent de la façon dont les comportements sont façonnés par des exigences culturelles...
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1633 - 1707) est un parfait exemple de cadre de la monarchie absolue, posant l'intérêt national, qui ne sera assumé en tant que tel que par la bourgeoisie...
La politique naît avec l’État dans sa forme la plus structurée, qui décide et détient la souveraineté. Il agit de manière « scientifique », avec comme but la prospérité, sans parti pris quant à ce qui est bien ou mal...
Jean de La Fontaine a écrit ses Fables dans l'esprit de l'averroïsme politique. Comprenons cela.
Au moyen-âge, face à la religion et au clergé, les matérialistes se trouvaient isolés, car la nouvelle classe révolutionnaire, la bourgeoisie, était encore faible, voire inexistante. Pour cette raison, le matérialisme européen, nommé « averroïsme », s'est transformé en averroïsme politique...
La Fontaine visait, en fait, les mêmes personnes que visaient les grands écrits indiens que sont l'Arthashastra, le Paṃchataṃtra, le Hitopadesha...
La rupture « sino-soviétique », comme l'ont appelé les médias à l'époque, consiste en le grand conflit idéologique entre d'un côté le Parti Communiste d'Union Soviétique (PCUS) et le Parti Communiste de Chine (PCC)...
Les « bonnets rouges » de la « révolte » en Bretagne ont une origine historique : celle de l'opposition au royaume à l'époque de Louis XIV ; par la suite, ils furent repris lors de la chouannerie opposée à la révolution française...
Il n'y a aucune contradiction à ce que Michel Foucault, homosexuel adepte du sado-masochisme, ait fait l'apologie de la révolution iranienne.
Les penseurs islamistes puisent tous dans le subjectivisme, notamment d'Henri Bergson et de Friedrich Nietzsche. Inévitablement, Michel Foucault devait se retrouver dans la démarche...
Lorsque la bourgeoisie a cessé d'être progressiste, elle a fragmenté sa vision du monde, de plus en plus. De l'impressionnisme, on est passé au cubisme, de l'esprit libéral concurrentiel au monopolisme, de l'art moderne à l'art contemporain.
La bourgeoisie sait par un instinct de classe que pour freiner la révolution socialiste, elle doit générer des obstacles au matérialisme dialectique : ce sont les idéologies qui nient l'existence des classes sociales, de la société, de l'humanité, de l'humain...
Qu'est-il advenu du capitalisme indien? Il avait en fait déjà une idéologie extrêmement développée : le jaïnisme...
La vigueur idéologique de l'hindouisme a conduit les forces féodales du sud à le rallier, les seigneurs féodaux ont été intégrés dans la castes des kshatriya, des prêtres ont été formés, et toute une histoire a été « écrite » pour intégrer le sud à la culture du nord...
L’hindouisme est parvenu à écraser le bouddhisme grâce à la Bhakti, mais le prix à payer a été élevé, car il a fallu intégrer la dévotion des masses dans la pratique religieuse...
Le mouvement de la Bhakti acceptait la théologie hindouiste, mais rejetait plus ou moins les castes, et même les rituels védiques, au nom d'une connexion directe avec un dieu, au moyen du chant, de la prière, de la dévotion etc.
Le matin du 10 novembre 1938, il y a 75 ans, était celui d'un jour nouveau, marqué par une atmosphère ouvertement criminelle, auquel avait donné naissance le pogrom de la « nuit de cristal » en Allemagne....
La situation du matérialisme dans l'Inde antique était intenable. Les deux directions possibles du matérialisme étaient bloquées à la fois par l’hindouisme et le bouddhisme.
Shankara a admis la position du bouddhisme, mais au lieu de dire que l’ego n'existait pas, il a proposé un système de fusion de la conscience individuelle et du vrai Soi.
L'hindouisme était l'idéologie des hautes castes qui avaient besoin d'une société statique et à leur service. A la différence du bouddhisme, de sa culture urbaine et de sa morale de citoyenneté universelle, l'hindouisme se basait d'un coté sur les grandes villes, l'état central et les pèlerinages, et de l'autre sur les villages.
Face au bouddhisme et au jaïnisme, le brahmanisme a dû entreprendre une transformation interne, et proposer une nouvelle perspective dans laquelle la réincarnation allait jouer un rôle central dans sa reconquête de l'hégémonie sur les masses.
Le bouddhisme et le jaïnisme se sont employés à afficher le caractère erroné de l'hindouisme, qui affirmait que tout le monde pouvait partir d'en bas et accéder au sommet de la société.
La réincarnation est le premier concept que les gens associent à l'hindouisme, au bouddhisme et au jaïnisme.
Si l'on regarde de plus près, on voit de grandes similitudes entre la Grèce antique et l'Inde antique.
Dans la Grèce antique, le système esclavagiste avait permis de produire une classe d'intellectuels assez riches pour consacrer leur temps au savoir et à la science.
Pendant la Renaissance en Europe, en particulier en Italie, le « retour » à ce savoir de la Grèce antique a été appréhendé comme une façon de dépasser le Moyen-Âge.
En Italie et en France, la bourgeoisie s'est en fait emparée de l'idéologie philosophique de la Grèce antique afin d'affaiblir la religion, de manière défensive, alors qu'ailleurs le hussitisme et le protestantisme sont devenus des formes idéologiques militantes d'averroïsme politique, dans une lutte ouverte contre le féodalisme...
Le « Mouvement Révolutionnaire Internationaliste » est un thème important qu'il faut comprendre pour saisir le maoïsme comme idéologie révolutionnaire de notre époque.
Au début de Matérialisme et empirio-criticisme, Lénine écrit un long passage intitulé « En guise d’introduction : comment certains « marxistes » en 1908 et certains idéalistes en 1710 réfutaient le matérialisme. »
En fait, il n'existe pas de « diderotisme » et ainsi, les positions matérialistes de Diderot se diluent dans le mouvement des Lumières...
Dans les années 1960-1970 sont apparues différentes organisations « marxistes-léninistes » et « maoïstes » s'affirmant opposés au révisionnisme du Parti Communiste français. Voici l'évaluation nécessaire.
Quand on regarde la bataille contre le révisionnisme menée à partir de 1953, on peut voir qu'il y a deux tournants. A chaque tournant, c'est le courant non révolutionnaire qui l'emporta et posséda une base solide pour la période suivante.
L'approche de Diderot est un matérialisme, mais un matérialisme qui sera par la suite appelé « vulgaire », au sens où il parvient à affirmer le caractère matériel de l'être humain, mais n'arrive pas à saisir le principe d'une organisation globale de la matière par elle-même.
A la lumière du matérialisme dialectique, il apparaît que ce que représente Diderot doit être analysé à partir de deux critères concrets. Tout d'abord, le rapport à la forme historique de matérialisme apparu en Europe : l'averroïsme, ensuite le positionnement par rapport à Spinoza.
Le matérialisme affirme l'unité de l'univers et l'esprit de synthèse. En ce sens, la parution au 18e siècle de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est un triomphe du matérialisme.
Histoire de la Gauche Prolétarienne, issue de l'UJC(ml).
Il y a 300 ans, le 5 octobre 1713, naissait Denis Diderot, l'illustre figure du matérialisme français, le grand activiste des Lumières qui fut le maître d'oeuvre de l’Encyclopédie.
Upton Sinclair a écrit un roman dans la veine du reportage, au sujet de la plus grande concentration industrielle d'alors, en 1906 : les Chicago stockyards, un enfer d'élevages et d'abattoirs.
Grand ami d'Egon Erwin Kisch, Joseph Roth (1894 – 1939) est une très grande figure de l'histoire du journalisme.
Voici comment l'écrivain allemand Alfred Kurella dresse un Portrait d'Henri Barbusse en 1934...
Histoire du Parti Communiste Révolutionnaire (marxiste-léniniste), issu du Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France.
C'est dans l'histoire des luttes des prolétaires contre l'exploitation et l'oppression capitaliste que se situe pour nous la continuité du projet communiste d'Action directe. Action directe se forme à la suite de la deuxième phase de la guérilla en Europe de l'Ouest.
L'Union des Jeunesses Communistes (marxistes-léninistes), issue de l'Union des Etudiants Communistes, a joué un grand rôle dans la popularisation de Mao Zedong dans la jeunesse, et s'est développée parallèlement au PCMLF...
L'histoire du Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France.
C'est avec un œil avisé et un regard cocasse que Kisch effectue ses reportages, nous montrant de manière critique la vie des gens. Ici, il se promène dans un quartier qui n'existe plus depuis quelques années, appelé le Marais et de culture juive, dans le centre de Paris.
Cette fois-ci, c'est nous-mêmes, les émigrés, qui allons vous parler de notre condition.
Au début des années 1990, tant le maoïsme que le marxisme-léninisme sont des idéologies anéanties en France ; le trotskysme et l'anarchisme sont les seules variantes idéologiques réellement existantes en France.
L'histoire de la Fraction Armée Rouge en Allemagne.
Karl Marx dit qu'il faut que les personnes juives s'émancipent complètement, en tant qu'humaines, et non pas en tant que personnes religieuses. Sinon, l'émancipation politique va être un piège qui va renforcer la mainmise religieuse, et donc l'aliénation.
L'échec du messianisme et l'apparition d'un messie « caché » avec le rabbin de Loubavitch puisent au cœur même de l'idéalisme du judaïsme : la providence est le lieu idéologique de l'effondrement inéluctable de cette religion.
Le jour même du début du bombardement systématique du Nord-Vietnam par les impérialistes américains, le Commando Petra Schelm a fait sauter, avec une charge de 80 kg de T.N.T., le Quartier général du 5e corps d'armée des Forces d'occupation américaine en Allemagne de l'Ouest, basé à Francfort.
«Rien n'est plus sensationnel dans le monde que l'époque à laquelle on vit. » « Rien n'est plus estomaquant que la simple vérité, rien n'est plus exotique que notre environnement, rien n'est plus plein de fantaisie que l'objectivité.»
L'avantage de parler de « danger » dans les études religieuses est bien entendu de maintenir comme centrale la fonction des rabbins.
La preuve que le judaïsme, en tant que religion d'une communauté, s'est fondé finalement sur Maïmonide et la kabbale, est le succès complet de Sabbataï Tsevi (1626-1676) et du Rabbi de Loubavtich, Menachem Mendel Schneerson (1902-1994).
Un autre ouvrage, qui ne fait pas partie de la Bible, a marqué le mysticisme juif : le Livre hébreu d’Hénoch. On a Rabbi Ismael qui est « emmené » par « Métatron », et raconte son expérience, en nous priant de le croire.
Il est nécessaire de se pencher sur le mysticisme juif pour comprendre comment la kabbale a pu se développer. Ce mysticisme qui s'est développé une centaine d'années avant « Jésus-Christ » et a continué par la suite s'appuie sur le Livre du prophète Ézéchiel, dans la Bible.
Le kabbalisme a une conséquence terrible pour le judaïsme : en effet, le judaïsme affirme la toute-puissance de Dieu, or là on pourrait agir en Dieu, « si on peut dire ». Dans la kabbale, si on prie bien, on agit positivement « en haut », mais l'inverse est possible.
L'alimentation cachère s'est vue attribuer, dans un esprit proche de la kabbale, une signification pour l'accès au monde supérieur.
La théorie kabbaliste est une continuation du néo-platonisme, son prolongement le plus ultime. Non seulement on a la théorie de l'émanation : l'énergie vient d'en haut, il faut que son âme rejoigne la source divine...
En fait, le principe de la kabbale a déjà été étudié par la grande majorité des gens en France, avec la conception des « correspondances » chez Baudelaire. Il y a des « parallèles », des portes, des accès, entre ce qui se passe dans le monde matériel et dans le monde spirituel.
La kabbale puise ses racines dans le néo-platonisme, à partir du mysticisme juif, dont la religion juive disposait déjà d'une solide base.
Le problème fondamental des affirmations de Maïmonide, c'est qu'elles en font un disciple d'Aristote, d'un « philosophe » qui n'utilise pas directement les écrits sacrés ou la tradition orale.
Les monopoles musicaux sont obligés de réagir, puisque leur but est de toujours plus accumuler des profits. Ils vont pour cela profiter de leur statuts de monopoles pour casser toute concurrence nouvelle.
Pour que Maïmonide puisse parfaire son système, il doit justifier que Dieu pense. Si Dieu ne pense pas, il ne peut pas en effet pas avoir choisi non seulement de révéler des choses, mais également d'avoir accordé le libre-arbitre aux humains.
Le comité que nous formons a pour principal objectif de diffuser la connaissance du mouvement économique de la société actuelle et de l'histoire de l'époque impérialiste.
Dans Le guide des égarés, Maïmonide (ou « Rambam ») expose trois conceptions de la prophétie. La première conception, que le Rambam rejette, est celle des païens qui pensent que Dieu choisit un homme pour lui faire porter un message.
Or, cela signifie que Rambam rejette le fait d'un « choix » et qu'il est obligé d'accepter la conception prophétique du « reflet » qu'on trouve chez Al Farabi, Avicenne et Averroès... Et Rambam le reconnaît lui-même ; il puise ouvertement dans Aristote.
Voici ce qu'il dit :
S'il ne l'a jamais dit ouvertement (et pour cause), la logique d'Averroès aboutit forcément à la thèse qu'on lui a attribué : celle qui consiste à parler des « trois imposteurs » pour désigner Moïse, Jésus et Mahomet.
Les syndicats participent à la confusion du réformisme en essayant de tromper les masses sur le but véritable de la lutte, c'est-à-dire : détruire le système capitaliste.
Les free parties ne sont pas un phénomène nouveau, et pourtant il aura fallu attendre le début de ce nouveau siècle pour que l'ampleur en France soit telle que l'Etat soit obligé de réagir de manière répressive, brutale, policière.
Il est intéressant de voir que " Résistance Offensive " cumule les tares de tous ces groupes, et que c'est justement pour cela qu'il est possible de parler de lutte entre deux lignes, et de leur donner toute cette importance.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement, ici, l’un des courants du heavy-metal : le black-metal.
On nous présente en général l’Etat comme étant une entité indépendante qui serait placée au-dessus des classes dans leur intérêt commun. Or il n’en et rien, car l’Etat n’est que l’instrument dont se sert la bourgeoisie pour assurer ses intérêts économiques.
La bourgeoisie est en pleine offensive. Il n'est pas un jour sans qu'on parle de sécurité, de nécessité de renforcer la police. Quant à l'armée, elle s'entraîne déjà pour les mauvais jours de la bourgeoisie : les dernières manœuvres de l'OTAN étaient consacrées à la guérilla urbaine en milieu hostile.
Pour nous maoïstes, le processus révolutionnaire n'est pas spontané. C'est un aspect essentiel de la question de la révolution. Le mouvement de mai/juin 1968 a montré quelles sont les conséquences de l'absence d'une organisation maoïste dirigeant le mouvement de masses. C'est en disposant ce que Mao Zedong avait appelé " les trois épées magiques " que les communistes des métropoles impérialistes pourront organiser les masses populaires pour vaincre l'Etat bourgeois et construire le socialisme, pour le communisme...
Nous revendiquons un statut d'avant-garde. Nous sommes des communistes, des marxistes-léninistes-maoïstes. Ceux et celles qui s'obstinent à rester dans le passé ne nous intéressent pas, nous ne les avons pas attendu, nous ne les attendons pas, nous ne les attendrons pas.
En rejetant le maoïsme, " VP " tombe dans la même logique qui a poussé Enver Hoxha à rejeter Mao Zedong à la fin des années 1970 : celle du révisionnisme.
L'aspect essentiel de la théorie marxiste quant à la notion de "crise" du développement capitaliste consiste en la théorie de la "chute tendancielle du taux de profit".
Au tout début des années 1970, le « maoïsme » est déjà en crise. Il a existé vraiment entre 1969 et 1972 et sa démarche est déjà épuisée au bout de ces quelques années. La constellation maoïste est alors constitué de militants très radicaux, mais sur une base spontanéiste au nom de la tentative de générer des structures autonomes populaires.
Regardons la conception, très intéressante, d'Avicenne sur la « prophétie », ce qui permettra de voir comment Maïmonide ne fait que la reprendre à son compte.
Comment Maïmonide justifie-t-il le libre-arbitre ? En fait, il fait exactement comme Thomas d'Aquin. Tous deux reprennent Aristote, pour le dévier vers une direction où il est affirmé que la partie supérieure de l'âme est « libre ».
Quel problème fondamental a donné naissance aux conceptions de Maïmonide et de la Kabbale ? Si elles sont différentes, tant Maïmonide que les kabbalistes ont tenté de résoudre un seul et même problème, amené par le développement du matérialisme...
Toute religion est une idéologie, qu'il s'agit de réfuter. Il faut comprendre les dynamiques religieuses, pour triompher de l'idéalisme. Le judaïsme est une religion qui a eu une grande importance culturelle dans notre pays...
Il va de soi que l'immense Karl Marx avait parfaitement compris le sens de la philosophie de Descartes. Voici comment, dans une simple note du Capital, il rend parfaitement clair l'objectif de Descartes, dont nous avons constaté ici le cheminement...
La question de la philosophie marxiste est une des questions centrales de la révolution sociale.
Pourquoi René Descartes maintient-il la fiction de l'existence de Dieu ? Parce qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens pour proposer le « libre-arbitre. » Le principe de « libre-arbitre » est essentiel dans la religion, c'est une base du patriarcat et de l'anthropocentrisme.
René Descartes (1596-1650) est indéniablement le plus grand penseur français. Ne dit-on pas que les « Français sont cartésiens », et sa réputation n'a-t-elle pas été immense, de son vivant même ?
La fin des années 1970 et le tout début des années 1980 ont été marqué par l'apparition d'une nouvelle culture musicale.
Un historique de la lutte armée en Italie.
Deng Xiaoping a réussi à couper la science de la philosophie, ce qui signifie qu'il rejetait l'aspect universel du matérialisme dialectique. Il y aurait d'un côté la science, de l'autre la philosophie.
Cette « double vérité » était nécessaire pour légitimer la domination du Parti « Communiste » révisionniste. La science doit servir le capitalisme, et le Parti « Communiste » devrait être la nouvelle bourgeoisie.
Le rejet du mouvement de 1989 a été le rejet de l'option de dépasser cette « double vérité ». Le problème est bien sûr que plus la science devient contrôlée par les éléments bourgeois, plus elle est non-productive et aussi un facteur de libéralisme...
Comme nous l'avons vu, l'émergence du libéralisme dans le domaine de la cosmologie a changé la situation pour le révisionnisme chinois. En effet, l'émergence de scientifiques dans ce cadre ouvert par le révisionnisme chinois a donné une contribution importante à l'idéologie de contre-révolution bourgeoise ouverte, au point que le régime révisionniste en a lui-même été mis en difficulté.
Étudions plus précisément ce processus...
Comment Deng Xiaoping a-t-il lancé à la lutte contre le matérialisme dialectique? Il a dû apparaître comme menant la réorganisation de l'idéologie, comme la remettant sur son chemin.
Par conséquent, Deng Xiaoping prétendait agir au nom de la « vérité ».
Le 19 Septembre 1977, l'information a été donnée comme quoi Deng a expliqué que « chercher la vérité des faits » était « la quintessence de la pensée philosophique de Mao Zedong », en parlant avec la figure la plus importante du ministère de l'Éducation...
Selon Deng Xiaoping, "Le marxisme a toujours considéré que la science et la technique font partie des forces productives."
Quelle est la clé du révisionnisme, en URSS et en République Populaire de Chine? C'est l'idéologie, il y avait un espace ouvert pour révisionnisme en URSS et en République populaire de Chine, où les éléments bourgeois ont pu s'agglutiner et ensuite faire un coup d’État.
En URSS, cet espace était dans le domaine de la biologie. La conception bourgeoise de l'ADN comme support de tout ce qu'est la vie a été bien comprise comme une illusion réactionnaire.
Néanmoins, cela a été confronté avec la conception erronée de modifier la matière depuis l'extérieur, sans suivre le principe selon lequel la contradiction est interne...
La Hollande était au dix-septième siècle la nation capitaliste par excellence. Karl Marx explique comment le pillage colonial va développer les échanges, faisant du port d'Anvers la capitale mondiale du capitalisme...
Pieter Aertsen, dit Lange Pier, marque une étape très importante de la peinture. En effet, avec lui on a la reconnaissance de la dignité du réel s'affirmant dans un domaine très précis. Avec lui, il y a la reconnaissance de la réalité de l'utilisation de plus en plus massive des animaux dans l'alimentation...
La social-démocratie se développa à proportion de l'industrialisation accélérée de l'Autriche. Ainsi, la social-démocratie s'inséra toujours plus dans une société en transformation, conquérant des droits pour les masses...
Le pays qui a été le plus marqué par le marxisme a été l'Autriche, dans sa partie autrichienne et tchèque. Le contexte était celui d'une tension entre l'aristocratie, la monarchie tendant à être absolue, et la bourgeoisie.
La monarchie avait toujours considéré le parlementarisme comme une extrême menace pour elle, même si à l'inverse elle devait profiter de l'élan bourgeois pour moderniser le pays, ce dont les forces féodales ne voulaient même pas entendre parler...
Il n'est pas possible de parler de social-démocratie française, sauf peut-être pour parler du Parti Communiste Français, qui en a pris immédiatement les traits, les rejetant pendant une courte période pour très vite les reprendre...
La brochure de Kautsky la Dictature du prolétariat, parue récemment à Vienne (Wien, 1918, Ignaz Brand, 63 pages), offre l'exemple le plus frappant de la plus complète, de la plus honteuse banqueroute de la II° Internationale, dont parlent depuis longtemps tous les socialistes honnêtes de tous les pays.
La question de la révolution prolétarienne s'inscrit aujourd'hui, pratiquement, à l'ordre du jour dans nombre d'États. Analyser les sophismes de renégat et le reniement total du marxisme chez Kautsky est donc de toute nécessité...
A la fin du 19e siècle, la social-démocratie a été le fer de lance de la classe ouvrière en Europe, même si en France les problèmes étaient déjà immenses. Pierre Mauroy en est le produit : c'est un fils du peuple qui a trahi les valeurs progressistes, c'est un traître qui a aidé à anesthésier les masses populaires du Nord...
Karl Kautsky n'aurait pas été un grand dirigeant si sa critique de Bernstein n'avait été que vaguement correcte et uniquement au sujet de la question de l'Etat. Il a également défendu l'orthodoxie...
Karl Kautsky fut le dirigeant exprimant le rejet du « révisionnisme » de Eduard Bernstein ; ce rejet a deux aspects.
La social-démocratie allemande a représenté une force vigoureuse lors de la période allant de 1891 – juste après que tombe la loi sur son interdiction – à 1914, date où elle soutient la guerre impérialiste, une ligne de compromis avec la bourgeoisie s'exprimant ouvertement par la suite, avec le refus de la révolution allemande et enfin, en 1921, l'ouverture définitive au régime en formant le parti gouvernemental.
Jean Jaurès figurera dorénavant, avec Mikhail Bakounine... parmi ces hommes qui, par une activité, une intelligence, un dévouement extraordinaires, ont rendu des services... mais qui... se sont mis en opposition avec les tendances et les bases du mouvement.... et ont employé leur grande influence sur les masses... pour les lancer à la poursuite de feux-follets...
Le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois : c'est dans le cerveau de certains individus de cette catégorie qu'est né le socialisme contemporain, et c'est par eux qu'il a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus développés, qui l'introduisent ensuite dans la lutte de classe du prolétariat là où les conditions le permettent...
Les dates du groupe armé Action Directe.
Le « syndicalisme révolutionnaire » est né, en théorie, contre l'influence des intellectuels bourgeois dans la classe ouvrière. Mais c'est lui qui a fait naître la charte d'Amiens de la CGT et qui s'est opposé à la naissance de la théorie socialiste...
Aujourd'hui, quand on pense à la social-démocratie, on a à l'esprit un mouvement réformiste organisé par un groupe de fonctionnaires de parti sur la base des syndicats. Cette image n'est absolument pas conforme à la réalité. La social-démocratie a été le premier mouvement organisé de la classe ouvrière, basé sur le marxisme, avec le socialisme comme but...
Léon Trotsky a donné un avis largement développé et erroné au sujet de l'Action antifasciste, attaquant de manière virulente la juste ligne de l'Action antifasciste et de la stratégie impulsée par Ernst Thälmann...
A titre d'illustration, voici quelques positionnements de l'Antifa autonome [M]...
Promesse de lutte de l'action antifasciste
12 juillet 1932
Le congrès de lutte contre le fascisme a décidé à sa réunion de prendre la promesse suivante comme serment de lutte de l'action antifasciste:
Nous promettons, corps et vie, de donner tout notre force pour la lutte antifasciste de masses :
contre les fascistes, ennemis à mort du peuple travailleur,
contre la formation de la dictature fasciste,
Nous avons besoin de profiter de l'Action Antifasciste pour consolider l'alliance entre la ville et la campagne sous de l'hégémonie du prolétariat, ce qui est actuellement de la plus haute importance dans la lutte contre la contre-révolution fasciste...
L'Action antifasciste est né dans le contexte allemand, et c'est Ernst Thälmann qui est à l'origine du concept...
Dans les années 1980, le symbole de l'Action Antifasciste est réapparu en Allemagne, cette fois avec un drapeau noir au lieu du second drapeau rouge. Cela fit partie d'une relance de l'antifascisme en Allemagne, aboutissant dans les années 1990 à la reformation d'une Action Antifasciste par des « antifascistes autonomes. »
Il y a 80 ans en Allemagne naissait l'Action Antifasciste face aux SA. Ce fut un événement historique...
L'expérience allemande a bien entendu profité au Parti Communiste - Section Française de l'Internationale Communiste, comme en témoigne la stratégie mise en avant ici en 1934, au lendemain de la tentative de coup d'Etat par l'extrême-droite française, en février 1934...
Rabelais ne pouvait pas espérer un soulèvement populaire, ni même l'acceptation par les masses de la pensée humaniste et de ses exigences. Aussi, Gargantua devient au fur et à mesure de l'oeuvre un appel à l'averroïsme politique.
Rabelais a tenté de présenter les choses de manière systématique ; Gargantua est un prétexte pour en arriver à une présentation synthétique de la réalité...
Le néo-gothique, idéologie issue du romantisme dans sa version ultra-réactionnaire, a été une plaie en France, de Victor Hugo à Viollet-le-Duc.
L'art gothique prolonge l'art roman, par une modernisation particulière selon les réalités nationales.
C'est Bernard de Clairvaux qui va jouer un rôle central dans la formation de l'idéologie de l'âge gothique.
L'un des moments essentiels est, suite à la genèse d'une nouvelle société, l'apparition de l'idéologie de la chevalerie, avec la chanson de geste et l'amour courtois, se fondant sur les "matières" de France, de Bretagne et de Rome.
L’échec de la falsafa va empêcher le développement culturel et idéologique du monde arabo-persan, et permettre le passage de celui-ci sous le coup de l’Empire ottoman et de l’impérialisme. Deux courants politiques, idéologiques et culturels vont alors émerger.
« Sulh-e-Kul » signifie : paix (ou harmonie) pour tous. L’empereur Jalaluddin Muhammad Akbar (1542-1605) généralisera ce concept, instaurant la « Deen-i-Illahi », la « divine foi » comme idéologie officielle. La « Deen-i-Illahi » est une sorte de philosophie religieuse, issue de débats à l’Ibādat Khāna, la maison de la dévotion, fondée en 1575 au palais d’Akbar à Fatehpur Sikri. Lors des débats se voyaient confronter les points de vue musulman, hindouiste, bouddhiste, jaïn, chrétien, juif, zoroastrien…
Cordoue est alors, avec presque 250 000 personnes y vivant, une des trois plus grandes villes du monde, aux côtés de Bagdad et Constantinople...
D’où vient le mot « falsafa », signifiant « philosophie » en arabe ? La falsafa est tout simplement un terme directement calqué sur le terme grec ayant donné « philosophie » en français (philosophie signifie amour de la « sophia », c’est-à-dire de la sagesse)...
Dans certains cas, lors des moments de recul des forces progressistes, la falsafa est apparue non pas sous une forme directement philosophique, mais par l’intermédiaire de la morale...
Nous allons ici étudier le cadre de ce développement, en accordant une attention particulière à l’Islam des philosophes, l’Islam des « falasifa » (pluriel de « faylasoof »). La philosophie, la « falsafa » en arabe, est un mode de pensée tendant au matérialisme et ayant contribué de manière essentielle à l’humanisme tel qu’il se développera en Europe. Sans falsafa arabo-persane, pas d’humanisme européen.
Karl Marx a largement raconté et analysé la Commune de Paris, toute son histoire, ses forces et ses faiblesses. Dans L’État et la révolution, Lénine a repris l'analyse de Karl Marx, en en soulignant la dimension historique, les aspects nouveaux, propres au prolétariat...
En raison de la persistance de la contradiction entre villes et campagnes, la bourgeoisie doit abandonner temporairement et en partie le commandement de l'Etat à l'Etat lui-même, en tant qu'outil administratif et militaire. C'est une phase transitoire qui puise sa source dans la défaite de la féodalité et dans l'existence d'une vaste couche paysanne...
En 1848, les fractions de la bourgeoisie non dominantes et les forces populaires unissent leurs forces, mettant à bas la « monarchie » qui était le masque de la haute bourgeoisie financière. C'est la relance du processus commencé en 1789, et Karl Marx constatera : « La période de 1848 à 1851 ne fit qu'évoquer le spectre de la grande Révolution française »
Karl Marx a compris que la révolution de 1848, qui met un terme à la phase de domination de l'aristocratie financière, était progressiste et donnait libre cours à l'aspect populaire de la révolution. Cependant, il n'a pas vu un aspect secondaire : la naissance d'un « anticapitalisme » antisémite représentant les intérêts de la petite bourgeoisie face au grand capital...
Lors de la Restauration, l'aristocratie n'avait plus les moyens de revenir à l'esprit de la monarchie absolue à son apogée, avec Louis XIV. Elle n'en avait de toutes manières plus l'aspect progressiste et, qui plus est, son ennemi, l'idéologie des Lumières, puisait déjà dans l'humanisme...
L'échec des jacobins ramène la bourgeoisie conservatrice au pouvoir, et finalement c'est Napoléon qui rétablit l'ordre et révolutionne la société dans un sens bourgeois.
Le jacobinisme, au-delà de ses contradictions, représentait la pointe de la révolution française, sa fraction la plus démocratique.
A la veille de la révolution française, il y a deux forces principales en présence : la noblesse, qui tente de revenir sur le devant de la scène aux dépens de la monarchie absolue, et la bourgeoisie qui tente de voir son existence reconnue afin de se développer socialement. En ne cédant pas sur ses exigences, la bourgeoisie a fait s'effondrer la féodalité déjà chancelante...
La monarchie absolue a joué un rôle positif en mettant relativement de côté, pour un temps, l'aristocratie et la religion, mais la bourgeoisie a grandi et entendait avoir une place plus grande.
Le point de vue communiste concernant la période de la monarchie absolue est connu et facile à comprendre. Néanmoins, il est important de le rappeler en préambule à l'histoire de la révolution française qui s'étale de 1789 à 1871.
Pour les communistes, qui s'appuient de fait sur le matérialisme historique, l'histoire est l'histoire de la lutte des classes et chaque palier historique marque la transformation d'un mode de production...
Les Lumières françaises ne sont donc pas « tombées du ciel », elles sont bien une production, et non pas une création « géniale. » Elles sont le fruit de l’humanisme né avec les débuts du capitalisme, notamment en Italie et en Hollande, bastion des arts et des sciences, du protestantisme ainsi que du matérialisme anglais, expression du capitalisme anglais qui s’exprime largement depuis la révolution anglaise au 17ème siècle.
Le principal problème du Parti Communiste français dans les années 1930 et 1950 a été son incapacité à correctement évaluer les Lumières françaises. Elles ont été considérées comme pavant unilatéralement la voie au socialisme scientifique, en raison de leur matérialisme.
C’est là un point de vue erroné, doublement erroné. Tout d’abord, parce que ce matérialisme n’est pas dialectique. Ensuite, parce que ce matérialisme pris comme seulement « français » nie l’influence du matérialisme anglais, le premier vrai matérialisme bourgeois.
La sortie du Moyen-Âge, sous l’impulsion de la falsafa et du développement du capitalisme, a conduit à un grand développement des forces productives et la généralisation des techniques artistiques.
La formation de l’esprit national français culminant dans le « classicisme » caractérisé par l’alliance monarchie – religion (avec la prépondérance de la monarchie) va de pair avec la formation de l’État français, en tant qu’administration à l’échelle nationale.
La formation de l’État national français se fait donc en alliance avec l’Église, mais une Église qui n’a pas l’hégémonie et ne peut pas faire du baroque l’idéologie dominante. C’est le classicisme qui prédominera, en tant que forme idéologique féodale de « haut niveau », puisque royale et nationale.
La faiblesse de l’humanisme en France d’un côté, le renforcement de l’État national sous François Ier de l’autre, font que la monarchie a une marge de manoeuvre très large face au féodalisme de la noblesse d’un côté, au féodalisme du clergé de l’autre.
L’État central généralise une justice unique, rejetant la violence des micro-univers repliés sur eux-mêmes et combattant de manière ultra-violente et tribale la moindre intervention extérieure. Il ne le fait pas sans mal, mais il profite d’une tendance irrépressible, celle de l’accumulation du capital.
La France de la période capitaliste est le fruit d’un long processus, au travers duquel la bourgeoisie est née, s’est développée, a tenté de prendre le pouvoir, et enfin l’a pris en réussissant à le conserver.
Ayant révisé le marxisme, le PCF va forger de nouveaux concepts et tenter d'arriver par les institutions à un gouvernement démocratique d’union populaire. C'est à la TV que les membres du PCF découvrent l'abandon de la dictature du prolétariat.
Avec le rejet de Staline, le PCF passe définitivement dans le camp des institutions bourgeoises. Thorez résume ainsi sa thèse dans un rapport d’activité du Comité central : « La démocratie, création continue, s’achèvera dans le socialisme ». Après la mort de ce dernier, la PCF entre dans une période de transition et rejette totalement la révolte de mai-juin 1968...
La résistance communiste a joué un rôle essentiel dans la défaite, dans la mesure où c’est lui qui a permis, de par son caractère populaire, à ce que les masses s’engouffrent dans la Résistance. De Gaulle ne disposait que d’un état-major et de réseaux et il a fallu du temps avant que Léon Blum n’apporte l’appui socialiste. Mais en aucun cas il n’est possible de dire que le PCF a « trahi » en 1945 car prendre le pouvoir n’a en fait jamais été son but, ou tout au moins pas de cette manière là.
Qui plus est, les rangs des FTP ou des milices patriotiques ne se sont vraiment massifiées qu’au moment du débarquement en Normandie, passant de 25 000 à 250 000 pour les FTP, sur un total de 500 000 FFI, au moment du débarquement de plus de 300 000 soldats alliés...
La Jeunesse Communiste, qui continue de publier clandestinement son organe Avant-Garde, a elle-même une structure similaire à l’OS : les Bataillons de la Jeunesse. En tant qu’organisation la JC a un rôle essentiel dans la première manifestation de masse de la porte Saint-Denis à Richelieu-Drouot, qui rassemble 10 000 personnes le 4 juillet 1941.
Le PC-SFIC est interdit et écrasé à la veille de la seconde guerre mondiale. Il doit se reconstruire, en pleine Occupation. La base se reconstitue alors grâce à l'action des femmes et des communistes immigrés..
La réalisation du Front Populaire est le grand succès du PC-SFIC, c'est une victoire sur le fascisme. Mais cela va l'exposer à une contamination institutionnelle et culturelle bourgeoise. Au moment de la fin du Front Populaire en 1938, la SFIC a obtenu sa légitimité, mais a perdu toute capacité d’initiative, a bouleversé son identité et se retrouve totalement désarmé sur le plan de la combativité...
La SFIC a réussi son pari : elle a réussi à se transformer en un parti de cadres qui dispose maintenant d’une audience certaine et également d’une forte expérience. Le Parti Communiste possède également un dispositif clandestin de planques, d’imprimeries, des moyens financiers à l’abri d’une saisie, avec des dirigeants inconnus des services de police.
Le système est efficace : à son arrestation en 1929, Maurice Thorez était dans l’illégalité depuis deux années déjà. Mais une telle pratique militaire ne va pas sans une grande pression à l’intérieur de ses structures, notamment face à l’énorme répression exercée par l’État...
« Feu sur Léon Blum - Feu sur Boncour Frossard Déat - Feu sur les ours savants de la social-démocratie - Feu feu j’entends passer la mort qui se jette sur Garchery - Feu vous dis-je - Sous la conduite du parti communiste SFIC » De nombreux jeunes intellectuels vont sympathiser avec la SFIC qui, à partir de 1925, n’a plus grand chose à voir avec ce qu’elle était à sa fondation...
La révolution russe bouleverse les archaïsmes français et le Parti Socialiste se scinde, donnant naissance à la Section Française de l'Internationale Communiste. Mais si la nouvelle organisation possède idéologiquement une dimension énorme avec la vague populaire issue de la révolution russe, la situation n’en est pas moins extrêmement complexe en son sein...
Dans la période d'avant 1914, réformisme et syndicalisme-révolutionnaire priment. Avec l'assassinat de Jaurès, ces deux courant passent directement dans l'Union sacrée pour la guerre de 1914. Le mélange de nationalisme et de syndicalisme pave la voie à l’idéologie fasciste. Et la ligne pacifiste critique la guerre sans prôner le sabotage de la guerre ni la rupture avec le patriotisme...
Épicure à Ménécée, salut.
Il y a presque 28 ans, le 14 mai 1970, la RAF naissait dans une action de libération : aujourd'hui nous en terminons avec ce projet. La guérilla urbaine sous forme de la RAF fait désormais partie de l'histoire.
Ils construisent une réalité artificielle afin d'ouvertement tromper l'opinion publique. Ils ne savent pas grand chose sur nous. Ils ne nous ont jamais vraiment compris de A à Z, ni vu à quoi ressemblent nos structures, ni qui est organisé dans la RAF.
Je pense qu'il espérait aussi que je viendrais le défendre sur la base de I'action qu'il poursuivait ainsi que ses camarades. II a vu que je n'étais pas d'accord avec eux. Je suis venu par sympathie d'un homme de gauche pour n'importe quelle formation de gauche en danger ; ce qui est une attitude qui, je crois, devrait être générale.
Nous sommes arrivés avec le développement de ces dernières années jusqu'à la scission à un bas niveau: nous n'avons pas réussi à amener tes expériences de 23 années de lutte dans ce processus, ensemble, comme connexion politique prisonnier/e/s-RAF.
Nous avons fait sauter la prison en construction de Weiterstadt avec le commando Katharina Hammerschmidt et ainsi évité que pour des années des gens soient enferméEs là-bas.
Notre orientation est aujourd'hui en première ligne le développement d'un processus social, où s'organise un contre-pouvoir par en-bas, qui place à la valse répressive des frontières et la fait reculer.
Nous avons le 27.7.90 attaqué l'expert en contre-insurrection Hans Neusel, secrétaire d'Etat dans ministre de l'intérieur à Bonn, avec le « commando José Manuel Sevillano. »
Le saut à la politique du front est possible et nécessaire pour les forces révolutionnaires, afin d'amener la confrontation à l'acuité adéquate.
Aujourd'hui le commando Ingrid Schubert a exécuté le diplomate-espion Braunmühl, directeur des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères, individu-pivot du processus d'élaboration de la politique occidentale-européenne, au coeur du système impérialiste global.
Nous avons, avec le commando Patsy O'Hara, exécuté Ernst Zimmermann, président de la BDLI (Union Nationale de l'Industrie de l'aéronautique, de l'espace et de l'armement) et patron de la MTU (Union des Moteurs et Turbines).
Nous disons: l'espace de l'action et de l'évolution du front est illégale. II n'y a pas un schéma ou le "grand plan", parce que le front est seulement possible comme processus ouvert pratique.
La guérilla ouest-européenne ébranle le centre Impérialiste.
L'impérialisme dans les centres a perfectionné et systématisé sa domination au point qu'ils ne trouvent plus la force de résister. Taux de suicides en forte augmentation, fuite dans la maladie, l'alcool, les tranquillisants, les drogues, voilà la réaction à la réalité d'une longue histoire d'échecs, d'épreuves et de souffrances, de dépolitisation, alors que la violence extérieure n'est plus perçue comme la cause de tout cela. Mais de cette dimension de la misère vient aussi la profondeur existentielles des luttes et la haine.
Nous avons commencé une grève de la faim, après l'exécution d'Andréas, de Gudrun, de Jan et d'Ingrid, après la mort de huit prisonniers de la RAF ces trois dernières années...
Le 7 avril 1977, le commando Ulrike Meinhof a exécuté le procureur fédéral Siegfried Buback.
Cela signifie dès le début que la conscience révolutionnaire dans le peuple n'est possible que dans le cadre de l'internationalisme prolétarien, dans l'identification avec les luttes de libération anti-impérialiste des peuples du Tiers-Monde, ne peut pas seulement se développer à travers les luttes de classes ici.
Parce que la lutte pour les camarades emprisonnés est maintenant notre cause du fait du rapport de forces ne peut être que notre cause et celle de nos armes qui en décideront.
[La grève durera du 13 septembre 1974 au 2 février 1975]
Mercredi 24 mai 1972, deux bombes d'une charge de 200 kg de T.N.T. ont explosé au Quartier général des Forces armées américaines en Europe, situé à Heidelberg.
Le vendredi 12 mai 1972, le commando Thomas Weisbecker a fait exploser trois bombes à la présidence de la police d'Augsburg et dans les bureaux de la police criminelle de Munich.
La guérilla urbaine c'est, malgré la faiblesse des forces révolutionnaires en république fédérale et Berlin-Ouest, intervenir ici et maintenant de manière révolutionnaire!
Élargir les luttes de classes Organiser le prolétariat Commencer avec la lutte armée à construire l'armée rouge !
Ce n'est pas seulement la RAF qui y a échoué, sans exception, toutes les pistes de gauche s'y sont cassées les dents.Bon, dans les années 70, le slogan était "Ab ins Private" (Vive la vie privée !), la vie alternative, le retour à l'université, la "longue marche" dans les institutions.
Des expériences, voilà le développement des luttes. Est décisif ce qu'on apprend à connaître. C'est le côté subjectif de la dialectique Révolution - contre-Révolution.
C'est un tuyau rouge, pas une sonde, qui est utilisé, pour être introduit dans l'estomac.
Ce que racontent les hommes politiques, ce n'est pas ce que les gens pensent, mais ce qu'il faut qu'ils pensent - et quand ils disent « nous », ils ne cherchent qu'à baratiner, pour que les gens croient y retrouver, en mieux formulé, ce qu'ils pensent et leur façon de penser.
Le système impérialiste mondial s'est développé sous l'hégémonie du capital américain, la politique extérieure des états-unis en est la manifestation politico-militaire et l'armée américaine, l'instrument principal.
Que la stratégie du manifeste communiste " prolétaires de tous les pays, unissez-vous " a retrouvé son ferment organisateur dans la guérilla qui anticipe sur la reconstruction internationale de la politique prolétarienne, la forme d'organisation de l'internationalisme prolétarien dans les métropoles du capital, ce sera la guérilla urbaine...
La position de classe ne peut être que le mouvement de la classe dans la guerre des classes, le prolétariat mondial armé et combattant, réellement ses avant-gardes, les mouvements de libération...
Ce procès est une manœuvre dans la stratégie de conduite psychologique de la guerre que mènent l' " Office fédéral de police judiciaire ", le bureau du procureur fédéral et la justice contre nous, il vise à faire tomber l'intérêt politique que représente notre procès en Allemagne de l'Ouest et à cacher la stratégie d'anéantissement du " procureur fédéral ", ce qui est une partie de leur programme.
Sentir ta tête exploser (sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux)
Il y a exactement 75 ans, les troupes allemandes envahissaient l'Autriche. Le communiste Alfred Klahr avait alors correctement compris la réalité. Un événement important, non seulement parce que c'était un exemple de raid impérialiste: c'était aussi un moment important où la démagogie fasciste a joué avec le nationalisme...
Le triomphe du Parti Socialiste en 1981 est similaire au triomphe de la bourgeoisie industrielle en 1969. A chaque fois, ce triomphe amène une désillusion de par l'impossibilité historique de réaliser ce qui devait l'être, de par la nature même du mouvement.
En 1958, la bourgeoisie financière s'imaginait parvenir au pouvoir, comme après 1945, mais cette fois avec un Charles De Gaulle mature instaurant un régime parfaitement adapté. La révolte anti-conservatisme ; libérale et populaire de 1968 en aura raison...
Le week-end dernier, les 8 et 9 décembre 2012, le Front National tenait un rassemblement privé dans une salle parisienne pour fêter ses 40 ans. Depuis le 5 octobre 1972 où Jean-Marie Le Pen lançait avec quelques compagnons un nouveau mouvement politique d’extrême-droite jusqu'à aujourd'hui où Marine Le Pen est l'une des personnalités les plus importantes de l’actualité politique française, les choses ont beaucoup évolué.
Le Front National était, jusqu'au début des années 2000, une structure radicale destinée à polariser la société française sur des valeurs d’extrême-droite et rassembler les personnes les plus réactionnaires autour d'un projet large, au delà des simples noyaux radicaux. Aujourd'hui, comme nous l'évoquons dans nos nombreux documents qui traitent de Marine Le Pen, de ce qu'elle représente et de comment la combattre, le Front National se transforme en une structure destinée à prendre le pouvoir en France. Le Front National n'est plus simplement d'extrême-droite, il est une structure nationaliste fasciste. C'est un tournant historique, qui a et aura un impact important sur la lutte des classes en France...
Les « identitaires » pratiquent un romantisme anti-national. En jouant sur l'idéalisation du passé et l'émotion par une attitude mélodramatique, ils en appellent à un passé où la nation française n'existait même pas, afin de nier le passage à une nouvelle étape, portée par les contradictions sociales au sein de la société française elle-même...
"Lascaux 4, autrement dit le Centre d'art pariétal, 50 millions d'euros pour un projet non prioritaire, nous l'arrêtons..." Voilà ce qu'a osé expliquer la ministre de la culture, Aurélie Filippetti.
On a beau savoir que la bourgeoisie est décadente. On ne peut qu'être halluciné devant la capacité de la bourgeoisie à liquider le patrimoine...
Le rapport entre semi-colonialisme et semi-féodalisme - PCMLM [Bangladesh] / PCMLM [France], août 2012
Selon le Marxisme-Léninisme-Maoïsme, les pays du monde sont divisés en deux types, caractérisant leurs contradictions.
Il y a dix ans décédait l'iranien Mansoor Hekmat, le 4 Juillet 2002. Cet intellectuel a essayé de développer une nouvelle idéologie, une nouvelle forme de marxisme, qu'il a appelé « communisme ouvrier. »
La Bourgeoisie a systématiquement présenté et continue à présenter De Gaulle comme étant au-dessus des partis, « au-dessus des factions », c'est-à-dire en fait au-dessus des classes sociales. Rien n'est plus faux.
De Gaulle est l'homme du capital financier français, il a directement servi les intérêts de la bourgeoisie impérialiste française...
La raison pour laquelle le gaullisme n'est pas un fascisme tient essentiellement en une chose : le gaullisme est républicain ; il met systématiquement en avant « la République » et n'est donc pas une dictature OUVERTE des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier.
Les références politiques à De Gaulle se multiplient largement aujourd'hui en France. C'est surtout le gaullisme, en fait un néo-gaullisme, qui se développe comme idéologie politique, comme mode de pensée et vision du monde cohérente pour servir l'impérialisme français – à l'instar de De Gaulle lui même.
Le gaullisme est une forme originale de la dictature du capital financier et des groupes monopolistes en France. C'est un régime autoritaire ultra-nationaliste – mais qui n'est pas à proprement parler un fascisme. Il s'est développé dans les années 1950-1960 afin de répondre aux besoins d’expansion de la bourgeoisie impérialiste française et maintenir l'ordre sur le territoire national...
Il y a 50 ans, le 19 mars 1962, rentraient en application les « accords d'Évian » signés la veille entre l’État impérialiste français et le Front de libération nationale (FLN), qui fit passer l'Algérie d'une situation coloniale à une situation semi-coloniale.
Le 19 mars 1962 n'est pas la date du premier pas vers l'Algérie indépendante ; les masses algériennes n'ont pas l'indépendance derrière elle historiquement, mais devant elle, car l'indépendance reste à conquérir.
Il y a 40 ans, le 25 février 1972, le militant maoïste Pierre Overney était abattu aux portes de l'usine Renault de Boulogne Billancourt, en banlieue parisienne. Une des plus grandes usines de France, une place-forte de la classe ouvrière, qui a été fermée en 1989 et détruite en 2005.
Et, en raison de la dimension de l'usine, à l'époque, c'était un lieu symbole de la bataille entre la Gauche Prolétarienne qui avait levé le drapeau de Mao Zedong et le Parti « Communiste » français qui, avec la CGT, maintenait la classe ouvrière dans le légalisme, le syndicalisme, l'électoralisme (voir ici les archives de la Gauche Prolétarienne - la Cause du Peuple)...
Que signifient les propos de Claude Guéant sur "les civilisations qui ne se valent pas" et "le relativisme de gauche"? Il est remarquable ici que le « raisonnement » de Claude Guéant rejoigne celui d’Anders Breivik, l’auteur du massacre d'Oslo. Là où Anders Breivik parlait de « marxistes culturels », Claude Guéant parle indistinctement et de manière générale de la « gauche », mais leur approche intellectuelle n’en est pas moins très similaire.
Il y a 70 ans, la conférence de Wannsee en Allemagne nazie scellait la stratégie d'extermination des personnes juives en Europe. Un événement d'une dimension extrême et unique, alors que la planète a connu et connaît nombre de massacres et de génocide.
Il y a 70 ans, le 20 janvier 1942, se tenait la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, en Allemagne nazie. Alors que l'extermination massive, par balles, des Juifs et Juives d'URSS avait déjà commencé, la conférence devait établir l'organisation industrielle de la destruction de la population juive d'Europe.
Cet événement, cette planification, cette organisation méthodique et systématique, est unique dans l'histoire : si les forces impérialistes et réactionnaires en général ont déjà mené des génocides, jamais ils n'ont organisé celui-ci à cette échelle, organisant l'ensemble du système politico-militaire et économique en ce sens.
Ce 26 décembre, nous célébrons l'anniversaire de Mao Zedong. Né en 1893, il a repris le flambeau de Staline, qui lui-même assumait le léninisme, alors que Lénine assumait lui les enseignements de Marx et Engels.
Il existe dans les pays impérialistes une profonde tradition révisionniste qui se revendique de Mao Zedong, mais en pratiquant une escroquerie sur les plans politique, idéologique et culturel. Mao Zedong n'est en effet assumé que pour le folklore, que pour la forme ; ses thèses sont modifiées, changées, « adaptées » au besoin du jour...
Un autre symbole très ancien de l'humanité est la double ligne parallèle, tracée la plupart du temps sur le ventre ou les fesses. Ce symbole est évidemment clairement interprétable, illustrant que deux êtres sont en fait présents là où l'on ne voit qu'un seul corps.
Le ministère lance une série d'analyses sur les oeuvres de la préhistoire qui témoignent du matriarcat à l'époque du communisme primitif. Nous constituerons ainsi une base de données essentielle sur le matriarcat, une époque de l'histoire de l'humanité totalement déniée par la bourgeoisie. Ce premier texte introductif présente des aspects généraux du matriarcat et l'analyse de la Vénus de Laussel, sculpture sur roche vieille de 25 000 ans...
Le culte de Maria Lionza est pratiqué dans tous les États du Venezuela, depuis la région de Yaracuy d'où elle est originaire, jusqu’à Caracas. Basé sur des rites précolombiens de dévotion à une déesse, el espiritualismo Marialioncero est un mélange de croyances d'Afrique, d'Europe, et de l'Amérique du Sud d'avant la colonisation espagnole.
Les révolution russe et chinoise ont été les plus grandes révolutions socialistes jusqu’à présent. Et souvent on pense à l’Allemagne (avec Rosa Luxembourg) ou à l’Espagne (avec la république antifasciste) quand on recherche une révolution de cette dimension, touchant tout le pays, tous les aspects sociaux, culturels, idéologiques.
La révolution finlandaise de 1918 a pourtant été une révolution de grande importance historique, d’une ampleur gigantesque. Si elle a échoué, de nombreuses leçons sont à en tirer, et notamment par rapport aux contradictions au sein de la bourgeoisie...
S’il est un pays où les contradictions au sein de la bourgeoisie sautent aux yeux historiquement, c’est bien l’Autriche. L’affrontement durant les années 1930 de « l’austro-fascisme » et du national-socialisme témoignent de cette contradiction, de manière édifiante.
Avec l’effondrement de l’Autriche-Hongrie à la fin de la première guerre mondiale, l’Autriche s’est retrouvé privée de ses nombreuses colonies. Son identité fut profondément troublée par cette réalité : Vienne perdit une partie de ses habitants puisqu’elle n’était plus la capitale d’un empire, et l’ouverture vers le Danube qui constituait le fondement de l’identité de la dynastie des Habsbourg était totalement remise en cause...
Le « soulèvement armé » de Neuberg est un manuel destiné aux cadres du Parti Communiste d’Allemagne afin d’être capable de mener l’insurrection, durant les années 1930. Voici sa présentation et sa critique.
La bourgeoisie a permis l’avènement de l’individu et c’est là son mérite, mais elle donne naissance également par la suite à l’individualisme, dans toute sa confusion mentale, et cela est critiquable.
La bourgeoisie française a lutté de manière exemplaire contre les forces féodales ; sa révolution a été exemplaire et considérée comme un modèle pour toutes les bourgeoisies du monde. Et il faut bien souligner que sa décadence est tout aussi exemplaire.
Le socialisme renverse l’ordre capitaliste, il met fin à la domination du capital, il met fin à l’exploitation, par l’introduction des rapports de production de type socialiste qui abolissent la propriété privée des moyens de production.
L’attention qu’il faut porter en France à la concurrence au sein des fractions de la bourgeoisie est d’un intérêt certain pour la révolution.
Les mouvements de la contre-révolution, la progression du fascisme, puisent leur source dans les mouvements de fond de l’infrastructure de la société capitaliste ; l’antifascisme, pour être concret, doit comprendre les tendances générales de l’époque, et voir comment le fascisme tente de grandir.
L’exemple allemand apporte beaucoup de leçons ; il aide à comprendre que non seulement la démagogie fasciste mute en fonction des situations, ce que l’on sait dès qu’on étudie le fascisme, mais également pourquoi il mute...
C’est le problème des rapports entre structure et superstructure qu’il faut poser exactement et résoudre pour parvenir à une juste analyse des forces qui opèrent dans l’histoire d’une période déterminée et définir leur rapport.
Le capitalisme correspond à un stade de développement de l’histoire de l’humanité, de l’histoire de la lutte des classes. Comme toute chose, il a connu une naissance, il a connu une progression, et il connaîtra une fin. Cela est inévitable, tout comme le féodalisme est né au sein même de l’esclavagisme, il s’est développé puis a été dépassé par le capitalisme qui s’est développé en son sein. Le capitalisme est une étape logique de l’histoire de l’humanité, de la matière en mouvement, de la vie.
Pendant 623 ans, de 1299 à 1922, l’Empire ottoman a dominé une large zone géographique autour de la Turquie. Le développement du capitalisme dans les pays d’Europe, puis le passage à l’impérialisme, ainsi que les mouvements de libération nationale, ont amené son effondrement.
Cet effondrement a cela de particulier qu’il a transformé la bourgeoisie nationale en bourgeoisie bureaucratique, et que cette bourgeoisie bureaucratique a dû faire face à des contradictions liées à la situation du pays et à la situation internationale.
L’exemple turc est très intéressant pour bien distinguer les putschs existant comme expression de contradictions au sein des classes dominantes, des putschs organisés pour écraser la révolution...
Dans les années 1970, les partisans de Mao Zedong n’avaient pas comme drapeau le maoïsme, mais le marxisme-léninisme pensée Mao Zedong.
C’est une chose importante à savoir, à connaître, si l’on veut éviter un retour en arrière, si l’on veut éviter que le maoïsme ne soit « révisé » et transformé en marxisme-léninisme pensée Mao Zedong.
En fait, au moment de la grande polémique entre le PC d’Union Soviétique et le PC de Chine, les organisations qui ont suivi la ligne « chinoise » ont assumé le marxisme-léninisme pensée Mao Zedong...
Pour nous le présent se transforme en futur. Les années 2010 n’auront rien à voir avec les années 2000.
Puisque le 21ème siècle sera -à travers tout un dédale - le siècle de la révolution socialiste en France, il est temps de davantage affirmer les questions d’organisation, et de souligner l’importance de la camaraderie.
La discipline est un élément fondamental pour les communistes qui, jusque dans leur vie privée, doivent matérialiser leur rupture avec les vieilles conceptions réactionnaires héritées du capitalisme et à cette fin, pratiquer intensément la critique et l’auto-critique.
Il y a 75 ans se déroulait un événement tragique qui a profondément marqué le prolétariat international, une expérience traumatisante qui a renforcé la volonté d'union selon les principes du Front Populaire.
Texte des militants du Parti Communiste Politico-Militaire (PCP-M) au procès de Milan - automne 2008.
L'une des caractéristiques essentielles du maoïsme est la considération selon laquelle l'URSS s'est transformée en Etat social-impérialiste. C'est une notion centrale, qui définit ce que le socialisme est et ce qu'il n'est pas.
Octobre 1917 ! C'était il y a 90 années, mais 90 années ne sont rien pour l'histoire du monde. Dans les pays où règnent aujourd'hui le capitalisme, la bourgeoisie a mis plusieurs siècles pour mener sa révolution et réussir à asseoir sa suprématie contre l'aristocratie.
Il y a 70 ans Gramsci mourrait, quelques jours après avoir été "libéré" de prison, le 27 avril 1937. Lors du procès suivant son arrestation en 1926, le juge représentant l'Italie fasciste avait affirmé qu'il fallait "empêcher ce cerveau de penser pendant vingt ans."
Il y a 70 ans, le 26 avril 1937, était bombardée la ville de Gernika (Guernica en castillan).
En appeler à la nation, c'est en appeler à serrer les rangs,à s'unir autour du drapeau national, ce drapeau que chaque foyer doit posséder, selon les désirs de Ségolène Royal. Et cette Marseillaise que tous les français doivent connaître. Mais quelle est la signification de la révolution française?
Chronique des relations entre le NSDAP et le capital monopolistique d’octobre 1923 au 30 janvier 1933 (sélection), extrait de De Weimar à Hitler : Les causes de l’avènement de la dictature fasciste, de Kurt Gossweiler.
Octobre 1923 : Fritz Thyssen remet au général Ludendorff 100000 marks-or pour le NSDAP.
8/9 novembre 1923 : Putsch de Hitler et de Ludendorff à Munich...
Médecin, Wilhelm Reich adhère aux thèses de la psychanalyse et il est l’un des premiers disciples de Sigmund Freud. Mais il décide assez vite de rompre avec lui : pour Freud en effet la sexualité en elle-même n’a aucune valeur, et sa satisfaction va à l’encontre de la civilisation, car la culture est le fruit d’une énergie sexuelle déplacée vers la culture.
Wilhelm Reich s’oppose formellement à cette conception et dans La révolution sexuelle, prône la libération complète de la sexualité. Pour Reich, l’amour libre est la condition sine qua non d’une vie épanouie. Il rejoint alors les rangs socialistes puis communistes, et quitte alors l’Autriche pour l’Allemagne, où il rejoint les rangs du Parti Communiste d’Allemagne, qui mettait systématiquement en place de grandes structures populaires.
Reich organise alors la Sexpol, c’est-à-dire une organisme d’agit-prop traitant des conditions de vie des masses et de leur sexualité : l’Association allemande pour une politique sexuelle prolétarienne. Reich constate notamment l’impossibilité matérielle d’avoir une sexualité, en raison de la pénurie de logements...
L’Allemand Otto Rühle (1874-1943) est une figure du mouvement appelé par Lénine le « gauchisme ». Militant socialiste proche de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, opposé pareillement à la première guerre mondiale, il fait partie du Parti Communiste d’Allemagne à sa fondation. Il en est exclu en 1919 pour « gauchisme » et participe à la naissance du Parti Communiste des Ouvriers d’Allemagne (KAPD), puis à l’Union générale des travailleurs d’Allemagne - Organisation unitaire, petite scission de l’Union Générale des Travailleurs d’Allemagne, elle-même scission du KAPD, puis n’est plus organisé à partir de 1924, se rapprochant de l’anarchisme et écrit de nombreuses oeuvres sur l’éducation et la psychologie individuelle. Il meurt en exil au Mexique...
L’Allemand Ernst Nolte est un universitaire allemand ; ultra-conservateur, il est le chef de file de ce qui est le courant dominant idéologiquement dans l’Etat allemand. Il est une référence pour un auteur comme Stéphane Courtois.
Selon Nolte, le fascisme n’est qu’une « réaction » ; il est un « totalitarisme » qui n’est apparu qu’en réponse à un autre totalitarisme considéré comme une menace : le communisme. Le fascisme est « une copie brouillée du bolchevisme »...
Moishe Postone, né en 1942, est un universitaire nord-américain. S’appuyant sur les travaux de Marx, il a étudié la théorie de la valeur ainsi que l’antisémitisme.
Gossweiler n’a pas étudié ni la culture ni l’antisémitisme ; son travail se fonde uniquement sur la formation pratique et théorique des structures nazies. La thèse de Postone, elle, met l’accent sur le côté froid et « rationnel » du nazisme, le fait que le génocide ait été « calculé. » La population juive a été exterminée sans qu’aucun intérêt matériel n’existe ; les nazis considéraient cela comme leur « mission », et même leur mission « centrale », prioritaire...
A l’opposé de l’interprétation de Gramsci, Sternhell considère que le fascisme est une idéologie extrêmement cohérente, qui s’est développée lentement et synthétise plusieurs courants d’idées. Historien universitaire, Sternhell a étudié la France de la fin du 19ème siècle, notamment l’oeuvre de Maurice Barrès, le principal intellectuel d’extrêmedroite avec Charles Maurras. Barrès critiquait le « éracinement », la perte des valeurs nationales, identitaires, et a développé ainsi une critique « de droite » du capitalisme. Sternhell a de cette manière constaté que les conceptions du fascisme italien provenaient de France. Sternhell s’intéresse principalement à l’histoire des idées; il analyse très peu les classes sociales; ce qui l’intéresse, c’est l’idéologie...
Au sortir de la première guerre mondiale, la Turquie a vécu une « révolution », guidée par Mustafa Kémal et ayant amené une modernisation du pays, qui devint une république, défendant notamment la laïcité. Ibrahim Kaypakkaya a été le premier théoricien à considérer que cette révolution était en fait une révolution par en haut, instaurant un régime fasciste.
Si aujourd’hui l’extrême-gauche en Turquie considère ce pays comme fasciste, les avis divergent concernant le moment où le fascisme est apparu. Certains considèrent que le kémalisme a été trahi, d’autres que le kémalisme a modifié sa nature après avoir libéré le pays pour lui donner son indépendance. Kaypakkaya affirme au contraire que le kémalisme est une révolution par en haut pour empêcher celle par en bas...
George Jackson (1941-1971) est un révolutionnaire afro-américain. Condamné à l’âge de 18 ans à 10 ans de prison pour avoir volé 70 dollars lors d’un braquage, il se politise en prison et devient l’un des principaux dirigeants historiques du Black Panther Party. Il fondera également l’organisation militante de prisonniers appelée « Black Guerilla Family. »
Emprisonné, Jackson s’est politisé et a fait une relecture de sa vie et de l’existence de la communauté afro-américaine aux USA. Il constate que dominent aux USA des règles et des principes équivalant au fascisme. La fin de l’esclavage n’a fait que marquer un saut qualitatif dans l’oppression...
Mao Zedong a été le premier grand théoricien de la notion de fascisme dans les pays contrôlés par le colonialisme. Selon lui, les colonisateurs font en sorte qu’émergent de nouvelles classes sociales qui lui soient liées. Dans les villes existe ainsi la bourgeoisie compradore, terme venant du portugais ; il s’agit d’une bourgeoisie bureaucratique, servant d’intermédiaire au service des colonisateurs. Dans les campagnes, les colonisateurs soutiennent la mise en place de grands propriétaires terriens.
La colonisation installe donc des régimes fascistes, où la dictature prévaut. Les communistes ont donc considéré la Chine comme un régime de type fasciste, où « la terreur ouverte prévaut » (Zhou Enlai, A propos du fascisme chinois)...
En tant que dirigeant du mouvement communiste en Italie exactement au moment où le fascisme de développe et finit par triompher, Antonio Gramsci a été en première ligne dans la tentative d’analyse de ce phénomène « nouveau ». Gramsci a ainsi pu voir comment le fascisme a mis en place le corporatisme, découpage de la société en strates totalement compartimentées et soumises à l’Etat fasciste. Il interprète cette forme d’organisation sociale comme correspondant à l’idéologie de la petite-bourgeoisie...
Kurt Gossweiler, né en 1917 en Allemagne, il déserte en 1943 l’armée nazie pour rejoindre l’armée rouge. Il devient alors un responsable de l’agitation antifasciste auprès des anciens membres de l’armée nazie, puis l’une des principales figures universitaires d’Allemagne de l’est ; de 1970 à 1983 il est collaborateur scientifique de l’Institut central d’histoire de l’Académie des Sciences en RDA. Auteur en 1972 d’une thèse sur Les monopoles industriels et l’Etat, il a publié de très nombreux travaux sur le mouvement nazi et le nazisme au pouvoir.
Aux élections du 6 novembre 1932, le NSDAP perd deux millions de voix et tombe à 11,7 millions de voix, cela malgré l’énorme démagogie sociale et la violence des centaines de milliers de SA. Les communistes sont à 5,2 millions de voix, gagnant 700,000 voix, alors que l’action antifasciste, front uni de lutte, se développe...
Selon Dimitrov, la très haute bourgeoisie a dès le départ soutenu le mouvement fasciste; le fascisme exprime même très exactement ses besoins. La raison de cela réside dans la « chute tendancielle du taux de profit », qui est un constat fait par Karl Marx dans son analyse du Capital. Selon lui, la bourgeoisie augmente la productivité du travail et licencie en raison de la concurrence, mais le problème est que la bourgeoisie vit en réalité de l’exploitation des travailleurs : remplacer les travailleurs par des machines c’est pour le capitalisme se couper les ailes. Une contradiction insoluble amenant un capitalisme ultra agressif, que Lénine a défini comme l’impérialisme (« L’impérialisme, stade suprême du capitalisme »).
Le fascisme est alors l’expression de la bourgeoisie la plus agressive, la plus impérialiste...
L’Allemand Reinhard Kühnl, né en 1936, est un universitaire ayant fait son cursus en Allemagne de l’ouest. Il est connu dans son pays pour avoir concentré son travail sur la question du fascisme afin de contribuer aux initiatives antifascistes.
Publié en 1936, Fascisme et grand capital n’a eu aucun écho à sa publication. Ce n’est qu’à partir des années 1970-1980 que cette oeuvre sera mise en avant par les courants politiques trotskyste et anarchiste.
Fascisme et grand capital s’oppose en effet à l’antifascisme tel qu’il a été conçu par les communistes. Daniel Guérin reprend la conception développée par Léon Trotsky du fascisme comme bonapartisme et la développe longuement. Les fascistes sont selon lui des «plébéiens » (du terme de l’antiquité romaine pour nommer les membres de la « plèbe », de la « populace » par opposition aux aristocrates), qui ont un discours anticapitaliste de façade qui amène les masses à les soutenir, ce qui plaît au grand capital qui empêche ainsi la révolution d’arriver.
Léon Trotsky (1879-1940) est un intellectuel et un révolutionnaire russe, qui en 1917 rejoint les bolcheviks. Refusant toutefois la politique de « socialisme dans un seul pays », il est exclu et exilé. Il forme alors la « Quatrième Internationale », mettant en avant une autre interprétation du léninisme que celle existante en Union soviétique.
Si Zetkine est restée fidèle à l’Internationale Communiste, Léon Trotsky a rompu avec elle en raison de ses considérations sur ce que devait (ou pouvait) être le socialisme en Union Soviétique. Sa rupture ouverte et revendiquée date de la fin des années 1920, et ses considérations sur le fascisme, datant des années suivantes, reprennent les premières analyses du fascisme en y apportant des explications plus approfondies.
Si Zetkin est la première à analyser le fascisme, c’est parce que ce dernier est un mouvement nouveau. Mussolini prend le pouvoir en Italie en 1922 ; quelques années auparavant on trouve la dictature de Horthy en Hongrie, instaurée en 1920, ou encore la terrible répression des « rouges » par les « blancs » en Finlande en 1918. La révolution de 1917 en Russie a été suivie d’une vague révolutionnaire, qui a amené une vague contre-révolutionnaire. Il a donc été logique de mettre a priori tous les mouvements de répression anticommuniste sur le même plan, et de considérer que les dictatures se valent toutes.
Zetkin fût la première à expliquer que cette analyse est fondamentalement erronée. Elle oppose la terreur blanche comme conséquence de l’existence d’un fort mouvement révolutionnaire, et le fascisme qui apparaît comme un châtiment parce qu’il n’y a pas de mouvement révolutionnaire. La terreur blanche « classique » est le produit de la tentative de faire de la révolution, le fascisme est le produit de l’absence de cette tentative...
Patterson n’est pas un spécialiste du fascisme, et tout comme Mosse il ne s’intéresse qu’à un aspect précis du fascisme allemand: le nazisme et le génocide. C’est à cette occasion qu’il a entrevu ce qui est selon lui un lien essentiel entre le meurtre de masse des êtres humains et le meurtre de masse des animaux. Le nazisme n’aurait pas pu exister sous cette forme destructrice si les abattoirs n’avaient pas eux-mêmes généralisé le meurtre de masse «anonyme » avec les abattoirs industriels. Et ces abattoirs eux-mêmes sont le fruit de la colonisation de l’Amérique, de la gestion des animaux pour les colons arrivant toujours plus massivement.
Dans son étude, Patterson explique ainsi que c’est l’organisation du travail dans les abattoirs qui a inspiré Henry Ford, et que ce n’est pas un hasard si Henry Ford était un antisémite forcené, qui plus est en lien avec l’Allemagne nazie. Hitler avait un portrait de Ford dans son bureau et le considérait comme un grand chef; Ford luimême publiait des pamphlets antisémites à grande échelle et avait aidé à financer les nazis en Allemagne. Il eut pour toutes ces raisons le « privilège » de recevoir en 1938 la grande croix de l’Ordre suprême de l’Aigle allemand, soit la plus grande décoration nazie pour un étranger.
GL Mosse (1918-1999) est un historien américain d’origine allemande. Universitaire, il a mené ses travaux sur les origines idéologiques du national-socialisme et sur l’antisémitisme.
Rien ne pose un défi plus grand à la culture que le fascisme. Le fascisme est l’expression la plus ultime de la barbarie moderne, mais il ne se présente jamais comme destructeur: il se veut enthousiaste, rebelle, anti-conformiste, il se met en avant comme une « révolte contre le monde moderne ». Mussolini lui-même disait que « Le fascisme c’est l’horreur de la vie commode ».
Pour vaincre le fascisme, il faut apprendre de ceux et celles qui ont lutté contre lui. Cela signifie apprendre de l'Internationale Communiste, parce que l'histoire de celle-ci correspond très exactement à la lutte contre le fascisme.
Sans cette critique ininterrompue, la ligne révolutionnaire s'étiole et se transforme en son contraire.
Une telle lutte a possédé un caractère marquant : il s'agit de la critique effectuée par le Parti Communiste de Chine (PCC) des positions erronées du Part i Communiste d'Union Soviétique (PCUS).
Aujourd'hui, la Chine est un Etat-prison. Les paysans, qui forment 70% de la population, sont exploités et opprimés par une minorité urbaine qui agrandit chaque jour davantage les usines-prisons dans les villes pour s'enrichir toujours davantage.
« La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne est le plus point le plus positif et le plus grandiose du processus mondial de lutte entre révolution et contre-révolution, entre restauration et contre-restauration dans le développement du socialisme. » (Parti Communiste du Pérou)
Il y a trente années Ulrike Meinhof a été assassiné, le 9 mai 1976. Cette affirmation est encore aujourd'hui interdite en Allemagne, parce que officiellement elle s'est "suicidée". L'Etat ouest-allemand ne pouvait pas laisser vivre cette dirigeante communiste, chef de file de la lutte contre le révisionnisme, pour la reconstruction de la ligne rouge.
Un spectre hante le monde, celui de Joseph Staline.
Car Staline n'a pas seulement été un symbole du communisme, ennemi juré du capitalisme, il est également un autre symbole : celui de l'opposition complète au libéralisme. Que l'on s'oppose à la concurrence, que l'on planifie et l'anathème petit-bourgeois tombe: « stalinien! »
Barbara Anna Kistler, née il y a 50 ans, est tombée en janvier 1993, dans les rangs de la guérilla, TIKKO (Armée Ouvrière et Paysanne de Libération de la Turquie). Elle est le symbole de l'internationalisme prolétarien, de l'internationalisme qui ne vit pas de mots mais de la lutte concrète pour la révolution de par le monde.
Article paru dans la revue Front Social n°19, 2001.
C’est une position de principe qui comporte un choix cohérent : en tant que combattants communistes, nous ne devons des comptes qu’à notre organisation, les BR-PCC.
Une résolution adoptée en même temps que celle sur le maoïsme.
La seconde déclaration du MRI, appelant à assumer le maoïsme comme idéologie.
Le cas italien devrait enseigner de nombreuses choses aux communistes et aux prisonniers révolutionnaires désirant travailler concrètement à la relance de la perspective en Europe occidentale.
L'internationalisme est depuis toujours l'élément de base de la conception révolutionnaire de la lutte de classe et de la construction du communisme.
[La zone géopolitique Europe - Méditeranée - Moyen-Orient fait partie d'un document de procès fourni en 1992 à la Xème chambre correctionnel du tribunal de Paris par les mlitantes des Brigades Rouges pour la construction du parti communiste combattant Simonetta Giorgeri et Carla Vendetti et les militants révolutionnaires Nicola Bortone et Gino Giunti.]
Nous ne sommes donc pas à l'aube de " l'ère de la paix, de développement et de stabilisation " dont parle la bourgeoisie occidentale en toutes occasions.
[Le collectif wotta sitta regroupe des prisonniers politiques italiens venant de différentes organisations, principalement le parti-guérilla du prolétariat métropolitain qui a été une scission ultra-gauchiste des Brigades Rouges du dé"but des années 1980. Le document est de 1992.]
Comme militante des BR per la costruzione del PCC, j'entends avant tout réaffirmer la valeur: politique et le caractère propulsif de la relance des termes globaux de l'activité révolutionnaire opérée par les BR a l'intérieur de la phase de: Retraite Stratégique qui, étant donné les perspectives politiques qu'elle a ouvertes tant sur le terrain du rapport classe/Etat que sur celui de l'anti-impérialisme, s'est traduite dans l'approfondissement du plan d'affrontement révolutionnaire.
Le saut à la politique du front est possible et nécessaire pour les forces révolutionnaires, afin d'amener la confrontation à l'acuité adéquate.
Union des Communistes Combattants
Action contre Da Empoli
(février 1986)
Le vendredi 23 février, un noyau armé de notre organisation a attaqué et blessé Antonio Da Empoli, responsable et dirigeant du "bureau des affaires économiques" du Palais Chigi [Siège de la présidence du conseil des ministres et du conseil des ministres du gouvernement italien].
L'Union des Communistes Combattants, avant-garde consciente de la classe ouvrière, œuvre pour transformer toute lutte réduite ou partielle en une lutte générale pour le renversement de l'ordre capitaliste.
Le 27 mars 1985, un noyau armé de notre Organisation a exécuté Ezio Tarantelli, un des plus grands responsables de l’attaque contre le salaire ouvrier et contre l’histoire des conquêtes politiques et matérielles du prolétariat de notre pays.
Le but est la construction d'une politique prolétaire armée contre la stratégie d'extermination que réalisent matériellement les Dassault et consorts.
Il s'agit aujourd'hui de concevoir l'Europe occidentale comme un territoire homogène où la construction d'un pôle révolutionnaire unitaire est possible. Cela signifie considérer le prolétariat de la métropole comme une classe unique, répartie sur des territoires différents, mais qui ont des caractéristiques fondamentalement semblables.
Nous avons attaqué l'Institut Atlantique, cellule de réflexion et de propagande d'articulation impérialiste.
La grande bourgeoisie de notre pays, la bourgeoisie impérialiste de chez nous, est désormais consciente depuis longtemps de la nécessité d'imprimer de très grands tournants au cours général de la société italienne.
Mouvement Révolutionnaire Internationaliste: la première Déclaration, de1984.
Le 15 février 1984, un noyau armé de notre organisation a justicié Ray Leamon Hunt, directeur général de la « Force Multinationale d’Observation » dans le Sinaï, constituée afin de garantir les Accords de Camp David, stipulés entre l’Egypte et Israël sous le contrôle direct des USA.
Mardi 3 mai, un noyau armé de notre organisation a frappé Gino Giugni, rond de cuir du staff des têtes pensantes du "Parti de la Guerre " dans notre pays.
La lutte armée naquit en Italie au début 70, comme hypothèse révolutionnaire pour le communisme. Elle naquit donc comme rupture subjective de quelques avant-gardes communistes d'avec 20 ans de révisionnisme, comme construction d'un point de référence stratégique révolutionnaire enraciné dans la classe.
De ce fait, les vieilles catégories de « classe ouvrière », « sous-prolétariat », « semi-prolétariat », etc.. ne tiennent plus. Aujourd’hui la domination réelle totale du mode de production capitaliste a définitivement prolétarisé toutes ces couches.
(Document de Diego Forastieri et Sergio Segio, membres de l’ex-direction historique de Prima Linea puis des Noyaux Communistes Combattants.]
Reprendre aujourd’hui le fil du débat politique, donner une nouvelle finalité et perspective à la confrontation, à l’analyse, signifie en premier lieu rechercher et définir les causes qui nous ont conduit à ce qui peut sembler un cul-de-sac.
COMMUNIQUÉ N° 1 AU PROCÈS MORO - 10 mai 1982
À TOUT LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE,
À TOUTES LES ORGANISATIONS COMMUNISTES COMBATTANTES,
Ce qui se trouve dans cette salle, malgré tous les efforts que la bourgeoisie fait pour la nier, est une terrible contradiction politique.
Le procès que la bourgeoisie impérialiste estime aujourd’hui devoir et pouvoir célébrer est une étape fondamentale du procès de refondation de l’État impérialiste des multinationales en État pour la guerre totale contre le prolétariat métropolitain.
Comme tous les retournements, tes deux lettres sont en plus impromptues ; bref, un vrai choc. Ainsi, du moins, dans un premier temps.
Est-il possible, nous sommes-nous demandé, qu'Alfredo Buonavita, prolétaire, brigadiste depuis presque le premier moment, ait fait un choix aussi scélérat en douce ?
Est-il possible que celui qui a milité à nos côtés dans les années les plus dures nous ait laissé tombés comme Judas avec un baiser et une embrassade ?
Avec la capture du traître Roberto Peci et le procès prolétaire auquel il est soumis, cette insidieuse stratégie contre-révolutionnaire qui se centre sur le « projet repentis » se trouve attaquée, démantelée et frappée au coeur.
L'impérialisme a commencé à s'embourber dans les sables mouvants de la défaite.
Présentation de l'Afghanistan par l'UCF-ML.
La base d'une unification PCMLF - PCR(ml).
Le processus unitaire vient de franchir un pas en avant important avec la ratification par notre Comité central et celui du PCML d'"un protocole d'accord pour l'unification du PCML et du PCR ml".
L'annonce de la fusion des organes théoriques du PCMLF et du PCR(ml).
PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'UNIFICATION DU P.C.M.L. et du P.C.R. (m.l)
Un document commun au PCMLF et au PCR(ml).
[Publié dans un supplément à Front Rouge, février 1979.]
"A partir du moment où, il y a près d'un siècle, le marxisme s'est affirmé, dans le mouvement ouvrier comme la seule théorie capable de guider la classe ouvrière dans son émancipation, la principale manifestation de l'influence de la bourgeoisie sur le prolétariat a pris la forme du révisionnisme" (Programme FR n°4 p 99)
Dans une lettre publique de son Comité central (29 juillet), puis dans un article de son organe central (3 septembre), le Parti du travail d'Albanie en est venu à se livrer à de grossières attaques, dénaturant l'oeuvre et la pensée de Mao Tsé-toung.
Il est des heures graves dans l’histoire d’un peuple où sa sauvegarde tient toute dans sa capacité de discerner les menaces qu’on lui cache.
L’Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s’épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis hier qu’on ne veut pas la faire.
Tout nous conduit à penser que, derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l’inféodation de la France, on consent à l’idée de son abaissement.
Documents au format PDF de l'organisation Azione rivoluzionaria.
Le IIIe Congrès du PCR ml a examiné l'avancée du processus d'unification avec le PCML.
Le 13 septembre 1973 paraissait le dernier numéro de « La Cause du Peuple-J'Accuse ». Depuis, plus rien ; que ce soit au niveau de notre propagande comme à celui de notre pratique nationale unifiée. Pourquoi ?
Un message du PCMLF à l'autre grande organisation marxiste-léniniste d'alors, le PCR(ml).
[Paru dans Le quotidien du peuple, en octobre 1978, comme Tribune de discussion pour le 3e congrès du Parti Communiste Révolutionnaire (ml).]
Le projet de Programme indique dans le chapitre << Pour faire la révolution, il faut un parti révolutionnaire>> : " Le Parti communiste fonde son action sur le marxisme-léninisme, le maoïsme qui synthétise l'acquis du mouvement révolutionnaire des masses et représente l'intérêt de classe du prolétariat ".
Le point de vue du PCMLF, lors d'un meeting avec le PCR(ml).
[Le meeting s'est tenu le 14 mars 1978. Ici, le discours au nom du PCR (ml), celui au nom du PCMLF est ici.]
Mardi soir se tenait avec succès à Paris un meeting unitaire des marxistes-léninistes à l'appel du PCMLF et du PCR ml pour annoncer la position des marxistes-léninistes au second tour, tirer un premeir bilan de la campagne électorale et tracer les perspectives pour le troisième tour, celui des luttes.
.La division du monde en trois mondes, pour définir la situation internationale actuelle, n'est pas une thèse toute récente. Le Parti communiste chinois l'a formulée dans les années 73-74. En janvier 1975, Chou En-Laï, dans son "Rapport sur les activités du gouvernement présenté à la première session de la IVe Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine", la développe explicitement.
Si nous désirons examiner la situation internationale, il convient tout d'abord de rappeler les caractéristiques de l'époque actuelle, qu'a définies Lénine de manière fondamentale voilà un peu plus de soixante années. Dans "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", l'éminent dirigeant de la Révotion d'Octobre a qualifié l'époque qui s'ouvrait alors comme étant celle "de l'impérialisme et de la Révolution socialiste prolétarienne".
La situation en France est dominée par la crise économique, dont les manifestations ne peuvent être dissociées de la crise mondiale du capitalisme.
Au bout de dix ans, le PCMLF fait le bilan de son existence.
Le PCMLF donne son analyse du Parti "Communiste" français et de son révisionnisme.
Une résolution sur l'union du PCMLF et du PCR(ml).
A l'occasion du 3e congrès du PCMLF, une tentative de définition de la pensée Mao Zedong.
Les Bureaux Politiques du F.L.B.-A.R.B. (Révolutionnaire), F.L.B.-A.R.B. (Républicaine), de la R.N.B. Trawalc'h se sont rencontrés sur le territoire breton et ont adopté la déclaration suivante.
La destruction de l'état occupant ne peut se réaliser que par la lutte armée révolutionnaire. L'aggravation de l'oppression française (répression policière, occupation militaire etc...), l'emprise capitaliste en Bretagne, nous conduisent à donner la priorité à la lutte armée révolutionnaire contre le pouvoir et ses complices.
Les journalistes jettent à la volée des mots qui en mettent plein la vue sans trop se préoccuper de la lente germination de ces mots dans les consciences.
[Tiré du Manifeste pour le socialisme, 1977.].
Il y a plus d'un siècle, la classe ouvrière de Paris prenait l'initiative de la première révolution prolétarienne au monde. Elle ouvrit la voie aux révolutions futures, marquant le début des temps nouveaux dans l'histoire de l'humanité. Les exploités se dressaient les armes à la main pour arracher le pouvoir de leurs exploiteurs.
[Tiré du Manifeste pour le socialisme, 1977.].
Parmi les grandes tâches que les masses auront à résoudre pour l'édification de la société socialiste, celle de la résolution des contradictions entre la ville et la campagne, entre l'industrie et l'agriculture, entre la classe ouvrière et la paysannerie est une des plus urgentes.
Sur le plan politique, il s'agit de consolider l'alliance qu'ouvriers et paysans pauvres commencent à construire dans le combat pour la révolution socialiste. Dans la phase d'édification du socialisme, il faut donner à cette alliance une base objective qui, au lieu de creuser l'écart entre les deux forces révolutionnaires, rapproche au contraire leurs pratiques, leurs points de vue, sous l'impulsion de la classe ouvrière...
[Tiré du Manifeste pour le socialisme, 1977.].
Depuis qu'il s'est constitué en classe, face à la bourgeoisie exploiteuse, quatre fois au moins le prolétariat de notre pays a secoué le joug qui l'opprime jusqu'à ouvrir une brèche sérieuse dans le système de domination capitaliste. Trois fois, la révolution prolétarienne a frappé à la porte de l'Histoire: 1871 -1936- 1945-
[Publié dans Front rouge, 1977.]
S'il est vrai que d'anciens maos appartiennent aux NAPAP, ce n'est pas seulement à partir du bilan de la liquidation de la « Gauche Prolétarienne » ou de « Vive la Révolution » que nous nous sommes formés. De même que les éléments stratégiques de notre pratique ne s'appuient pas sur la théorie de la lutte armée comme une fin en soi.
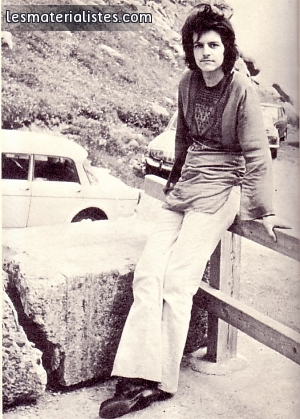 Le 15 décembre 1976, Walter Alasia, membre des Brigades Rouges,
Le 15 décembre 1976, Walter Alasia, membre des Brigades Rouges,
fut tué lors d’une fusillade nocturne avec la police italienne dans un
quartier ouvrier de la banlieue milanaise, Sesto San Giovanni.
Quinze membres d’une escouade « antiterroriste » étaient venus
l’arrêter dans l’appartement de ses parents. Walter a répondu à leurs
tirs en en tuant deux, s’échappant par une fenêtre et se faufilant jusque
Puisque nous avons aujourd'hui la possibilité de nous exprimer dans le quotidien "Humanité Rouge", ce qui est une initiative sympathique pour l'unité et, espéronsle, qui aura des lendemains, nous allons expliquer les divergences qui aujourd'hui empêchent une unité réelle.
Explication de l'identité de la nouvelle Cause du Peuple.
Nous exigeons la libération de tous les civils et soldats emprisonnés, la levée de toutes les inculpations et l'arrêt de toute répression dans les casernes.
[Publié dans Front Rouge le 5 juillet 1976.]
La vague de répression qui s'abat sur les luttes ouvrières (Fos, Besançon, Grasse), la dissolution de la Ligue " Communiste " la manifestation du P " C " F pour " la défense des libertés ", remettent à l'ordre du jour une question politique importante : oui ou non, existe-t-il en France un danger fasciste ? La bourgeoisie s'engage-t-elle dans un processus qui mène au fascisme ?
Nous pensons qu'Ulrike a été exécutée. Nous ne savons pas comment, mais nous savons par qui et nous pouvons montrer que cela a été savamment calculé. Je rappellerai les propos de Herold : « Les actions contre la "R.A.F." doivent toujours être menées de façon à éviter toute position sympathisante. »
Sur cette solide base politique venue de notre histoire , il faut s'emparer de la question du marxisme, du maoïsme comme courant révolutionnaire mondial , comme base théorique et idéologique, comme systématisation de la plus grande expérience révolutionnaire de notre temps: la GRANDE RÉVOLUTION CULTURELLE PROLÉTARIENNE.
Aujourd'hui 5 Mai à 8 heures, un noyau armé a frappé le vice-procureur Paolino dell'Anno.
Le courant de l'histoire est irréversible : les pays veulent leur indépendance, les nations leur libération et les peuples la révolution.
Dans cette société composée d'exploités et d'exploiteurs, nous nous sommes rangés avec notre classe en mettant dans la lutte toutes nos capacités de militants communistes.
Les adeptes des "contre-pouvoirs" ne seraient-ils pas en réalité des aspirants réformistes à régenter les masses en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes, l'autogestion pour le socialisme, et l'idéologie bourgeoise pour un idéologie prolétarienne ?
Les multinationales, Agnelli, Cefis, la Confindustria (Confederazione Générale dell'Industria Italiana) ont déclenché depuis longtemps une grande attaque contre la classe ouvrière, en créant, par des licenciements massifs et le coût de la vie croissant, un climat de terreur avec lequel ils espèrent avoir ensuite carte blanche pour rétablir leurs profits, que les luttes ont définitivement compromis.
Ce texte a été publié dans la brochure "Unité-critique-unité" du Collectif pour l'Unité des Marxistes Léninistes en mai 1976.
Notre tâche de Maoistes, c'est de faire fusionner les enseignements universels de la Révolution Culturelle avec la situation concrète de la Révolution en France.
Le texte sur l'expérience du Comité de Lutte contre le Chômage a été publié dans "La Cause du Peuple" n°7 et est une critique dans la pratique de la ligne erronée du PCR. Ayant reconnu cette critique juste en public, des dirigeants du PCR promirent en janvier 1976 une autocritique publique dans leur presse.
La tempête révolutionnaire de Mai 68 a mis à nu, en France, la force et la profondeur de la contradiction qui oppose le mouvement de masse ouvrier à ses soi-disantes organisations « légitimes » : les syndicats.
Les N.A.P. sont nés d'expériences de masse précises dans différents secteurs, qui ont poussé certains camarades à se poser concrètement le problème de la clandestinité.
Le 16 mai 1975, le camarade Gilbert Mury est mort. Pour nous, sa vie a une valeur d'exemple. Il appartient, dans sa génération, au petit nombre de ceux qui engagé à 20 ans dans le combat de la Résistance, n'ont jamais abdiqué leur conviction communiste. Jusqu'à sa mort, il a poursuivi le combat pour la révolution.
L'anniversaire de l'élection de Giscard a été marqué par une intense campagne pendant laquelle cet aristocrate méprisant a occupé à 100% la télévision, la radio, les journaux.
LA DC EST L'ENNEMI PRINCIPAL DU MOMENT : c'est le parti organique de la bourgeoisie, des classes dominantes et de l'impérialisme.
Le 11 mai, Teng Siao Ping, vice-président du Comité Central du Parti Communiste Chinois, membre du Comité Permanent du Bureau Politique, vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat de la République Populaire de Chine, arrive dans notre pays à l'invitation du gouvernement français.
L'appel du PCMLF pour le premier mai 1975.
Notre ligne, dans ce cadre général de projets et de contradictions, reste d'unifier et de renverser toute manifestation partielle de l'opposition prolétarienne en une attaque convergente au "coeur de l'Etat".
[Publié dans Révolution Prolétarienne du 2 janvier 1975.]
[Publié dans Révolution Prolétarienne, décembre 1974.]
A BAS L' HEGEMONISME DES 2 SUPERPUISSANCES
A BAS L'IMPERIALISME ET LE SOCIAL - IMPERIALISME
La tête de Mao qui accompagne notre titre suscitera sans doute des questions. Les uns diront qu'elle « fait chinois », d'autres qu'elle relève du culte de la personnalité.
Pierre Victor et Geismar ayant décidé de prendre leur retraite de révolutionnaires professionnels ont voulu camoufler leur démission en passant la balle à un « grand rassemblement » dans lequel les maoïstes auraient perdu leur autonomie politique.
[1er octobre 1974.]
Attention ! Restez à l'écart, cet équipement et cet endroit sont minés et exploseront à la moindre tentative d'interrompre cette communication.
Camarades prisonnières et prisonniers en taule, cette communication vous est destinée par les Noyaux Armés Prolétaires, qui se sont formés clandestinement en-dehors des prisons, afin de continuer la lutte des prisonniers contre le camp de l'Etat bourgeois et de sa justice.
« Un centre de recherche sur la révolution » ou encore « un centre de documentation sur les révoltes populaires » ou bien « un lieu de rencontre et d'échanges de tout ce qui est ou se pense « subversif ».
Une critique, a posteriori, de l'UJCML, le mouvement étudiant "en concurrence" à l'initial avec le PCMLF.
Après a décision des dirigeants de "La Cause du Peuple" de dissoudre l'organisation et face à la carence allant de pair avec de graves déviations de ces mêmes responsables, il est urgent de sauver de la liquidation les forces révolutionnaires qui les ont suivis jusqu'ici afin que se poursuive la marche en avant du maoïsme vivant dans notre pays.
Ces dernières années, sous la direction de la clique du renégat Brejnev, Moscou a monté une farce rendant un culte à Confucius et dénigrant l'école légaliste.
par Tien Kai
Confucius (551479 av. J.C.) fut un idéologue réactionnaire qui défendit obstinément le régime esclavagiste.
Sin Feng, 1974
L'initiative révolutionnaire génère inévitablement son antagonisme organisé : la contre-révolution.
Ce document vient d'un enregistrement d'une discussion, menée le 22 février 1974, entre Mao Zedong et Kenneth David Kaunda ; cela fut présenté en Chine comme le point de vue de Mao Zedong sur les « trois mondes ».
Récemment, des farces ayant pour objet de rendre un culte à Confucius ont été jouées dans quelques sombres recoins du monde. La plus maladroite fut celle montée et dirigée sur la scène de Moscou par les nouveaux tsars révisionnistes soviétiques pour encenser Confucius et dénigrer l'école légaliste.
Suite à une visite en Chine populaire, une présentation de la ligne du PCMLF.
André Roustan, 1973
Il y a 34 ans, le Parti Communiste Français était dissous par la bourgeoisie qui se préparait à collaborer avec Hitler. Il entrait dans l'illégalité, des milliers de militants étaient arrêtés, emprisonnés dans les camps en France.
[Publié dans Front Rouge le 12 juillet 1973.]
[Publié dans Front-Rouge le 12 juillet 1973.]
Dans leur dernière publication, les dirigeants de l'Humanité "Rouge" : amorcent un virage très intéressant.
Front Rouge à l'occasion de l'interdiction de la Ligue trotskiste a interrogé Bernard Rey militant marxiste léniniste, qui a été condamné après une inculpation de reconstitution du PCMLF en 1970. Il donne ici le point de vue des marxistes-léninistes.
Un article donnant l'arrière-plan de l'attaque du meeting parisien des fascistes d'Ordre Nouveau.
En d'autres termes, l'action armée pour les Brigades Rouges est le point le plus haut d'un processus profond d'auto-organisation au sein de la classe : sa perspective de pouvoir.
Malgré tous les mensonges déversés par la presse et la télé depuis vendredi, il est clair maintenant que le militant révolutionnaire Pierre Overney, qui a été assassiné aux portes de Renault Billancourt, l'a été de sang-froid et de façon préméditée.
QUI PARLE, qui raconte ce qui s'est passé à Renault ? Les bourgeois et leurs alliés.
Personne n'en parlait; les murs de la « forteresse », c'étaient les murs du silence autour des initiatives autonomes de ces sauvages : les OS sur chaîne.
Cliquer ici pour voir le PDF.
A Renault-Billancourt, les ouvriers inventent tous les jours de nouvelles formes de lutte. Les quatre actes de contrôle ouvrier qui sont décrits et analysés montrent comment.
La conception politique, le programme politique que nous représentons, que nous développons, doit être entièrement présent à tous les niveaux de l'organisation de Potere Operaio.
Le PCMLF explique sa stratégie.
J'ai toujours vécu dans un village ouvrier.
Notre plan d'action depuis la rentrée 71 part de la donnée objective fondamentale de la situation française : à savoir que l'état de crise atteint par la société française est tel, que celle-ci est à la merci d'une explosion qui peut venir de n'importe quel aspect de la société française, d'une lutte ouvrière - on était à deux doigts d'un affrontement radical avec la grève du métro, d'un scandale, type Rives-Henry, des retombées de la crise de l'impérialisme à l'échelle internationale sur la société française.
QIAO GUANHUA, 15 novembre 1971
Personne n'ignore que la Chine est un des membres fondateurs des Nations unies.
En 1949, le peuple chinois a renversé la domination réactionnaire de la clique de Tchiang Kaichek et fondé la République populaire de Chine.
Dès lors, les droits légitimes de la Chine à l'ONU auraient dû tout naturellement revenir à la R.P.C.
Avec La Cause du peuple il fallait accrocher les mecs, discuter, mais je n'avais plus peur.
Pour nous, « prenons la ville » n'est pas seulement un mot d'ordre mais un programme qui doit nous permettre d'interpréter toute une phase de la lutte de classe et de lui donner une orientation politique.
Hsinhua, 31 octobre 1971
Hsinhua, 31 octobre 1971
Les réactionnaires japonais ayant à leur tête Eisaku Sato ne se sont pas résignés à la défaite cuisante qu'ils ont subie à la 26e session de l'Assemblée générale de l'O.N.U.; ils redoublent d'efforts dans leur complot visant à créer «un Taïwan indépendant » dans la vaine tentative d'occuper de nouveau la province de Taïwan, territoire chinois.
Hsinhua, Renmin Ribao, 23 octobre 1971
Taïwan est la plus grande île de la côte sudest de la Chine. Des liens serrés tant culturels qu'économiques existent depuis des temps reculés entre Taïwan et le continent.
C'est comme ça qu'on a bien reçu l'idée des " longues marches " qui correspondait à un objectif qu'on se proposait : il y a toujours eu des étudiants qui venaient travailler à la campagne pendant les vacances mais nous, ce qu'on voulait à partir de ça, c'est faire venir des politiques de manière à ce que les paysans réfléchissent aux problèmes politiques.
Nous sommes opposés au syndicalisme.
Il faut que la révolte s'exprime; là, on découvrira jusqu'où elle peut aller.
Si la définition qu'on m'a donnée est juste, si tous ceux qui se rebellent sont des maos, alors les curés, chez nous, ce sont aussi des maos.
Lorsqu'on était communistes en 47, on était maoïstes. C'est eux maintenant qui ne sont plus communistes.
Le mouvement marxiste-léniniste est aujourd’hui l’ennemi le plus implacable et le plus déterminé de l’oppression nationale infligée à la nation Kurde et aux nationalités minoritaires par les classes dirigeantes turques, et est à la pointe des luttes contre l’oppression nationale, la persécution des autres langues et des préjugés nationaux . Le mouvement marxiste-léniniste soutient inconditionnellement, et a toujours soutenu, le droit à l’autodétermination de la nation Kurde, opprimée par la bourgeoisie et les propriétaires Turcs, c’est à dire son droit à faire sécession et à créer un État indépendant. En ce qui concerne le droit de fonder un état, aussi, le mouvement marxiste-léniniste est opposé aux privilèges...
1. La révolution kémaliste est une révolution de la couche supérieure de la bourgeoisie commerçante, des propriétaires terriens, des usuriers turcs et un nombre plus faible de la bourgeoisie industrielle existante.
C’est-à-dire que les chefs de la révolution sont les classes de la grande bourgeoisie compradore turque et les propriétaires terriens. La bourgeoisie moyenne avec un caractère national n’a pas participé à la révolution en tant que force guide...
Dans la nuit du 13 au 14 mai, le groupe Manouchian de la Nouvelle Résistance Populaire, organisation clandestine d'auto défense des masses populaires, a lancé une attaque éclair contre les locaux du journal "Minute" et les a fait sauter...
NOUS FERONS NOTRE PROPRE LOI DANS L'USINE!
Nous voulons une guérilla!
Voici tous les éléments qui permettent d'affirmer que grâce à une préparation active, à un travail des militants C.G.T. le 21 a été un grand succès !
Nous, les syndicalistes prolétariens, on avait sorti, chez Citroën, un journal, Le Drapeau rouge. J'en ai gardé un numéro. On parlait un peu de Mao, on parlait de Lénine.
Ainsi lorsque le président Mao dit dans " La ligne de masse " : "II faut tenir compte de la majorité, il ne faut pas progresser d'une manière aventureuse, mais au contraire, il faut toujours refléter l'avis de la masse populaire ", c'est quelque chose qu'il est extrêmement important de comprendre.
Et si un tract, cela ne suffit pas, si l'avertissemeni il ne veut pas le comprendre ; si tous les ouvriers sont d'accord mais qu'ils n'osent pas encore manifester en masse ou si la pression des masses est encore insuffisante pour lui faire peur, on est capable de lui faire- payer ses saloperies d'une manière efficace et qui laisse des traces.
Les maoïstes agissent un peu comme des catalyseurs : ils se fondent dans le peuple et essayent de l'aider à s'organiser.
Face aux tensions sociales et à la difficulté manifeste de leur trouver une solution dans le cadre du régime bourgeois, la bourgeoisie tente d'enlever à la classe ouvrière l'hégémonie qu'elle avait conquise l'année dernière sur le terrain social et de la rejeter, comme une couche sociale parmi d'autres, dans le marais du système bourgeois.
Mieux vaut mourir en luttant que de crever doucement à genoux.
Après Mai, l'ennemi quelque temps déséquilibré, s'est ressaisi : affaiblie politiquement, la bourgeoisie utilise des armes qui révèlent cette faiblesse, l'appareil de répression, les négociations bidons, les élections, l'intoxication.
Rapport sur la politique et l'organisation adopté au congrès : Haïr, stigmatiser et écraser le centrisme !
mai 1970
La conjoncture actuelle dans le monde présente deux phénomènes importants.
D’un côté, il y l’agression par l’impérialisme US du Cambodge. Les impérialistes US ont laissé tomber tout faux-semblant et ont directement envahi le Cambodge.
C’est la logique de Hitler, la logique de tous les agresseurs.
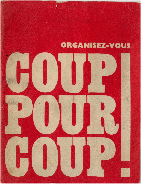 [Supplément à la Cause du Peuple n°20.]
[Supplément à la Cause du Peuple n°20.]
La tâche centrale et la forme suprême de la Révolution, c'est la conquête du pouvoir par la lutte armée, c'est résoudre le problème par la guerre.
MAO TSE-TOUNG
Nous ne cachons pas que nous sommes résolument opposés aux syndicats.
La clique des renégats révisionnistes soviétiques parle de léninisme, de socialisme et d'internationalisme prolétarien, mais ses agissements sont impérialistes à cent pour cent.
L'isolement des quartiers populaires est le résultat d'une politique dont l'appareil administratif est l'exécutant direct. Il s'agit toujours de reléguer ces quartiers à l'extrême périphérie du tissu urbain où ils seront coupés du développement physique et social de la ville.
LES FLICS HORS DU METRO, IL EST A NOUS!
Quel est le facteur décisif de l’issue d’une guerre, l’homme ou les armes ?
Voilà une question où se voit la divergence fondamentale entre les deux doctrines militaires, la prolétarienne et la bourgeoise, entre le marxisme-léninisme, la pensée mao-tsétoung et le révisionnisme, ancien et nouveau.
Le président Mao, notre grand commandant en chef, nous a enseigné « Les armes sont un facteur important, mais non décisif, de la guerre. Le facteur décisif, c’est l’homme et non le matériel ». Il a encore souligné avec clairvoyance « La bombe atomique est un tigre en papier dont les réactionnaires américains se servent pour effrayer les gens. Elle a l’air terrible, mais en fait, elle ne l’est pas.
Bien sûr, la bombe atomique est une arme qui peut faired’immenses massacres, mais c’est le peuple qui décide de l’issue d’une guerre. Et non une ou deux armes nouvelles ». Ces brillantes thèses ont considérablement raffermi le moral du prolétariat et des peuples révolutionnaires du monde et rabattu énergiquement l’arrogance de tout impérialisme et de toute la réaction.
Défiant la loi Marcellin qui prétend interdire les manifestations, liquider la "Cause du Peuple", mettre fin à la liberté de contester, Alain Geismar montre le chemin de l'honneur.
Au cours de l'histoire, la frontière chinoise subit de nombreux changements, cependant, elle ne fut en aucun moment limitée aux seules régions des Hans; la Chine avait ses frontières bien nettes avant d'être envahie par les puissances impérialistes occidentales dans le milieu du XIXe siècle.
Le gouvernement chinois a toujours préconisé de régler pacifiquement, au moyen de négociations, le problème de frontière sino-soviétique. Le 24 mai 1969, il a fait une déclaration réitérant cette position.
Le Front de Libération de la Bretagne est un front révolutionnaire et nationaliste. Il regroupe les forces de libération du peuple breton. Le nationalisme tel que nous l'entendons est la prise de conscience d'une communauté ethnique, historique, culturelle, géographique et économique, opprimée et niée (refus du droit à l'existence de la communauté bretonne).
Après notre détour par la ligne "syndicaliste prolétarien" nous nous sommes rendus à l'évidence: il ne suffit pas d'avoir des formes d'action nouvelles et dures pour se démarquer des revisos-réformistes quand on garde le même esprit syndicaliste, ou la même revendication isolée prise dans le programme de la CGT.
Les ouvriers n'attendent pas le signal du patron pour lutter. Ils le font quand ils l'ont décidé.
QUE VOULONS-NOUS? TOUT ! Vive la lutte de nos frères italiens.
Faire apparaître la classe ouvrière comme force politique indépendante, cela demande des précisions.
TRAVAILLEURS DE NICHELINO,
L'heure est venue de donner une riposte aux patrons.
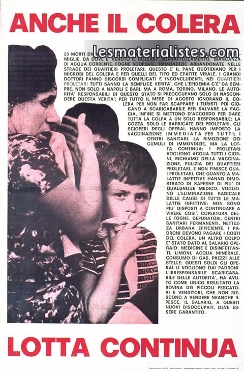 S'ils nous ont entassés dans cette ville c'est pour pouvoir nous exploiter dans l'usine avec des salaires de misère et des horaires prolongés et pour pouvoir récupérer une bonne partie du salaire avec le loyer qu'ils nous font payer pour les quatre murs dans lesquels nous dormons.
S'ils nous ont entassés dans cette ville c'est pour pouvoir nous exploiter dans l'usine avec des salaires de misère et des horaires prolongés et pour pouvoir récupérer une bonne partie du salaire avec le loyer qu'ils nous font payer pour les quatre murs dans lesquels nous dormons.
Vouloir militer dans les syndicats n'est pas faux en soit (suivant des conditions objectives), ce qui est faux, c'est de vouloir faire des syndicats « légaux » capables de discuter avec les patrons et le gouvernement. Car toute une ligne politique, quand elle est fausse comporte un point de non retour et au fur et à mesure de son application dans la pratique, elle peut très bien devenir une voie bourgeoise.
Article paru dans le Hongqi, n°67, 1969
[Stanislavski était un théoricien du théâtre qui avait fui la révolution russe de 1905, rentrant en Russie seulement après cette période révolutionnaire préfigurant la révolution d'Octobre 1917]
Partir des ouvriers, paysans et soldats ou de « soi-même »?
Chanter les ouvriers, paysans et soldats ou louer la bourgeoisie, voilà où est la différence fondamentale entre les deux conceptions de littérature et d'art, celle du prolétariat et celle de la bourgeoisie.
Stanislavski disait : « Quel que soit son rôle, l'acteur doit toujours partir de soi-même », « il faut bien retenir que dans la voie artistique, c'est soi, et rien que soi », « durant toute notre vie nous nous interprétons nous-mêmes. »
Critique
La « Décision du Comité central du Parti communiste de Chine sur la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne » élaborée sous la direction personnelle du président Mao, dit : « Réformer l’ancien système d’éducation ainsi que les anciens principes et méthodes d’enseignement est une tâche extrêmement importante pour la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne en cours. » A l’heure actuelle, nous devons poursuivre cette « tâche extrêmement importante » formulée par le président Mao. Une expérience majeure de la révolution prolétarienne dans l’enseignement est qu’il faut persister dans la critique révolutionnaire de masses au moyen de la penséemaotsétoung, pour liquider l’influence pernicieuse de la ligne révisionniste contrerévolutionnaire introduite dans l’enseignement par Liou Chaochi, ce renégat, agent de l’ennemi et traître à la classe ouvrière.
Cette ligne a des fondements « théoriques » qui ne sont autres quele traité : Pédagogie dû à N.A. Kairov, une « sommité » de l’enseignement révisionniste en Union soviétique. Le premier chapitre de l’édition de 1956 nous montre que ce traité contribue à la réalisation des « nouvelles tâches dans le domaine de l’éducation définies par le Xxè Congrès » des révisionnistes soviétiques et qui visent toutes le même objectif : la restauration du capitalisme...
Faire une propagande intense en faveur de la révolution socialiste ou frayer la voie au capitalisme.
Le 1er octobre 1949, la Chine nouvelle apparaissait tel le soleil rouge de l'Orient qui perce les ténèbres.
La révolution démocratique était achevée pour l'essentiel, la grande révolution socialiste commençait.
En avril 1948 déjà, le président Mao indiquait dans son œuvre brillante « Causerie pour les rédacteurs du Quotidien du ChansiSoueiyuan » : « Camarades ; vous vous occupez de journalisme. Votre tâche est d'éduquer les masses, de leur faire connaître leurs propres intérêts, leurs propres tâches, les principes et mesures politiques du Parti. »...
On doit se demander la raison des profondes affinités qui lient depuis pas mal de temps une fraction des trotskystes et le P.S.U.
Au moment précis où les militaires et civils de toute la Chine acclament avec enthousiasme la publication de la récente directive de notre grand guide, le président Mao : «II faut faire consciencieusement le bilan de l'expérience acquise», les révisionnistes soviétiques ont, à nouveau, fait intrusion dans la région de l'île Tchenpao, territoire chinois, et ont créé un autre incident sanglant.
Dans cette « sainte alliance » contrerévolutionnaire, la clique des renégats révisionnistes joue le rôle de complice numéro 1 de l'impérialisme US et elle est l'ennemi commun que condamnent tous les peuples.Partenaire de l'impérialisme US dans sa furieuse opposition à la Chine
Les événements ont prouvé que révisionnistes soviétiques et impérialistes U.S., qui s'abouchent et se collettent pour la mainmise du Moyen-Orient, sont les ennemis les plus féroces des peuples arabes.
Après être à l'origine du grave incident sanglant du 2 mars, le gouvernement soviétique, au mépris des avertissements réitérés du gouvernement chinois, n'a eu de cesse d'envoyer ses forces armées s'introduire dans l'île Tchenpao, territoire chinois, et s'y livrer à des provocations armées ; il a récidivé, de nouveau, et commis, à iui seul, un nouvel incident sanglant.
Editorial du «Hongqi» n° 3-4, 14 mars 1969
La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne a remporté une victoire grandiose et décisive.
Le mouvement révolutionnaire de masse pour transformer tout ce qui, dans la superstructure, ne correspond pas à la base économique socialiste, se développe en profondeur sur tous les fronts. Les vagues de colère contre les ambitions agressives démentielles de la clique des renégats révisionnistes soviétiques déferlent sur tout le pays, dans les villes comme dans les campagnes.
Tel un raz de marée, l'immense mouvement pour faire la révolution et stimuler la production, le travail et les préparatifs en prévision d'une guerre et pour saluer, par des actions concrètes, le IXe congrès du Parti, a gagné tous les fronts...
Après avoir envoyé ses troupes armées faire intrusion le 2 mars en territoire chinois, créant ainsi un sanglant incident de frontière d'une gravité extrême, la clique des renégats révisionnistes soviétiques que dirigent Brejnev et Kossyguine est allée plus loin en déchaînant une sinistre vague antichinoise.
Le 2 mars, la clique des renégats révisionnistes soviétiques a envoyé ses forces armées envahir d'une manière flagrante l'île Tchenpao sur le Wousouli, province du Heiloigkiang en Chine, lesquelles ont tiré à coups de fusil et de canon contre les gardesfrontière de l'Armée populaire de Libération de Chine, faisant parmi eux de nombreux morts et blessés.
Depuis Mai, le combat s'est poursuivi, illustrant cette vérité du printemps révolutionnaire : les luttes de Mai-Juin sont à l'origine du processus révolutionnaire qui travaille actuellement l'Europe capitaliste.
Les comités Palestine sont créés dans le but de soutenir la lutte révolutionnaire du peuple palestinien contre le sionisme et l'impérialisme avec à sa tête l'impérialisme américain et d'appuyer activement le mouvement de libération de la Palestine.
“Boycottons les élections”: la signification internationale de ce slogan
Décembre 1968
En 1937, les fascismes allemands, italiens et japonais, les trois détachements avancés de l’impérialisme mondial, conspiraient en vue de se repartager le monde ; les fascismes allemands et italiens firent irruption en Espagne pour soutenir activement le général Franco.
La classe ouvrière mondiale vint soutenir le gouvernement de front uni d’Espagne, et des brigades internationales furent formées, par des gens venant de différents pays.
Mais hélas Franco parvint à écraser la résistance appuyée par les brigades internationales et à imposer sa variété de fascisme en Espagne.
Nous, conseil politique national du Front de Libération de la Bretagne - F.L.B., réunis en conseil extraordinaire, en plein accord avec l'Etat-Major et les Volontaires de l'Armée Républicaine Bretonne (A.R.B.), après analyse des différentes déclarations et projets du Chef de l'Etat français et de son entourage, avons décidé de préciser par cette déclaration le sens profond de notre lutte, afin qu'elle ne soit plus détournée de sa véritable signification, et pour mettre fin aux interprétations fantaisistes ainsi qu'aux exploitations dont elle est l'objet.
Le «Rapport à la deuxième session plénière du Comité central issu du VIIe Congrès du Parti communiste chinois », rapport présenté par le président Mao le 5 mars 1949 et republié aujourd'hui, est un document marxisteléniniste faisant date. Ce rapport a synthétisé, de façon exhaustive, la lutte qui se déroulait entre les deux lignes, au sein du Parti, dans la période de la révolution démocratique, et il a analysé la nouvelle situation de la lutte des classes apparue après que la victoire eut été remportée pour l'essentiel dans cette révolution ; il a formulé le grand programme pour le passage de la révolution de démocratie nouvelle à la révolution socialiste, pour l'instauration et la consolidation de la dictature du prolétariat ainsi que pour l'édification du socialisme ; il constitue pour toute la période de transition une arme idéologique acérée dans la lutte contre le révisionnisme, contre la ligne opportuniste «degauche » et celle de droite. Ce grand programme révolutionnaire a illuminé tout le processus historique de la révolution et de l'édification socialistes de ces dixneuf années.
L'étude de ce rapport revêt une signification particulièrement importante pour mettre à exécution les diverses tâches définies par la douzième session plénière élargie du Comité central issu du VIIIe Congrès du Parti, comprendre de façon approfondie l'histoire de la lutte entre les deux lignes au sein du Parti, saisir la doctrine du président Mao sur la poursuite de la révolution sous la dictature du prolétariat, stigmatiser à fond les idées révisionnistes contrerévolutionnaires de Liou Chaochi, dénoncer totalement les crimes monstrueux que ce renégat, cet agent, ce traître à la classe ouvrière a commis en trahissant le Parti et la nation, ainsi que mener jusqu'au bout la grande révolution culturelle prolétarienne...
Notre grand guide, le président Mao indiqué récemment :
« Protéger les larges masses populaires ou bien les soumettre à la répression, c'est ce qui distingue fondamentalement le Parti communiste du Kuomintang, le prolétariat de la bourgeoisie et la dictature du prolétariat de celle de la bourgeoisie. »
Des classes, partis et systèmes d'Etat différents adoptent des positions, des points de vue et des attitudes différents visàvis des masses populaires et de leurs mouvements.
Protéger les masses populaires ou bien les soumettre à la répression, voilà la ligne de démarcation entre révolution et contre-révolution...
Qui crée l'histoire ?
Les héros ou les esclaves ?
C'est là un point essentiel du conflit qui, depuis toujours, a opposé les conceptions idéaliste et matérialiste de l'histoire.
En vue de maintenir leur domination réactionnaire, les classes exploiteuses ont, depuis des millénaires, pris le contrepied de l'évolution historique et propagé leur conception idéaliste qui présente les héros comme les créateurs de l'histoire. Elles ont donné pour tels les quelques figures héroïques des classes exploiteuses, les disant douées de « talent inné » et investies de la «volonté de Dieu. »
Quant aux masses populaires, elles les ont qualifiées outrageusement de « populace » subissant leur loi, voire de «matière inerte» entravant la marche de l'histoire...
Le PCMLF analyse son interdiction.
L'usine de machines-outils de Changhaï est une grande entreprise industrielle connue pour sa production de rectifieuses de précision.
Elle possède plus de 600 ingénieurs et techniciens, comprenant trois catégories d'éléments : ceux issus des rangs des ouvriers représentent environ 45 pour cent, ceux sortis après la Libération des universités et des instituts, environ 50 pour cent, et le reste est constitué par des anciens techniciens d'avant la Libération.
La grande Révolution culturelle prolétarienne, telle une violente tempête, a apporté de profonds changements parmi le personnel technique de l'usine...
- Qui êtes-vous? - Nous, on est les ex-Union des Jeunesses marxistes-léninistes - Mais vous êtes dissous aussi, et c'est tout ce que ça vous fait? - Eh oui!
Les accords de trahison de Grenelle ont été conclu. A Sochaux...
Un camarade est mort. Un jeune lycéen, Gilles TAUTIN du lycée Mallarmé. Un militant du mouvement de soutien aux luttes du Peuple. Un militant de l'Union des Jeunesses Communistes (marxiste- léniniste).
La première étape de la révolution populaire a eu deux caractéristiques principales à partir de la révolte étudiante, le développement d'un puissant mouvement gréviste de masse; autour de le classe ouvrière, l'unité du peuple dans la solidarité avec les grévistes, dans le combat contre le régime du grand capital et des assassins,
La grande révolution culturelle prolétarienne, en une suite de tempêtes, secoue la Chine et le monde entier.
La situation est excellente. Commencée par une vaste campagne de critique dans le domaine culturel, cette révolution accède, triomphalement, après une année de combats exaltants, à la phase de la grande critique de masse contre la poignée des plus hauts responsables qui, bien que du Parti, se sont engagés dans la voie capitaliste.
Cette vaste campagne de critique revêt une importance politique majeure ; elle constitue le développement en profondeur de la lutte menée par les révolutionnaires prolétariens pour la prise du pouvoir, une mesure d'importance permettant de liquider le venin du révisionnisme, une force motrice idéologique mobilisant les larges masses en vue de réaliser la tâche de luttecritiqueréforme, une puissante lutte de masse pour appliquer de façon approfondie, dans les domaines politique, économique, culturel et militaire, laligne révolutionnaire prolétarienne du président Mao. Nous avons devant nous deux livres : Idéal, vertus, vie intérieure (appelé simplement Idéal), édité en 1962 par les Editions de la Jeunesse chinoise, et Pensée, sentiments, talent littéraire (appelé simplement Pensée), publié en 1964 par les Editions populaires du Kouangtong...
Tract du PCMLF, alors que juin 1968 se profile.
L'analyse du PCMLF, à la veille de juin 1968.
Le tempétueux mouvement révolutionnaire de masse qui balaie la France, l'Europe et l'Amérique du Nord ces derniers jours continue à se développer rageusement.
En France, 10 millions d'ouvriers ont participé à la lutte en faisant la grève et ont occupé la moitié des usines, mines et entreprises du pays. Épaulés par les ouvriers, les étudiants de Paris ont combattu héroïquement les CRS et la police réactionnaire, soulevant une nouvelle vague de la lutte. Avec l'approfondissement de la lutte ouvrière, le mouvement des paysans, lui aussi, se développe rapidement. La lutte des masses populaires s'étend à de plus en plus de pays capitalistes. C'est une lutte de masse d'une ampleur qu'on avait plus vue depuis des dizaines d'années au cS ur du monde capitaliste. Elle frappe violemment le système capitaliste pourrissant, décadent. La grande puissance des masses populaires se manifeste on ne peut mieux dans cette tempête.
Dans le déferlement révolutionnaire des ouvriers, des étudiantset des masses populaires françaises, nous constatons encore une fois la vérité énoncée par le président Mao quand il nous dit : « l'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier »...
Le PCMLF affirme son rejet de De Gaulle.
Déclaration du PCMLF, en plein mai 1968.
Position du PCF en plein mai 1968, notamment au sujet de la répression d'Etat contre Daniel Cohn-Bendit.
Premier bilan de mai 1968.
Au moment où, dans l'ensemble du monde capitaliste ayant à sa tête l'impérialisme américain, la crise politique et économique va s'accélérant, un vaste et impétueux mouvement des étudiants et des ouvriers s'est levé et bat son plein. En France, de nombreux jeunes étudiants portant haut levé le grand drapeau révolutionnaire sont descendus dans la rue. Les mouvements ouvriers et estudiantins français sont d'une ampleur et d'une puissance sans pareille depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Tels les flots de la mer en furie, ils montent violemment à l'assaut de la société capitaliste pourrissante.
Malgré les innombrables fleuves et montagnes qui séparent Paris et Pékin, la lutte du peuple français est étroitement liée à la nôtre.
Avec une grande émotion, nous suivons chaque action révolutionnaire de la classe ouvrière et des étudiants de France.Nous nous réjouissons sincèrement de chacune de leur victoire. Quels que soient les ouragans, les difficultés et les revers que le peuple français sera amené à rencontrer dans la voie de la lutte révolutionnaire, nous nous tiendrons toujours aux côtés de la classe ouvrière et des jeunes étudiants de France et notre cS ur sera à l'unisson de celui du peuple français...
Le PCMLF expose son analyse de la situation, alors que mai 1968 est lancé.
Un document de mai 1968.
La répression policière s'est abattue sur les étudiante ces derniers jours les étudiants y ont répondu courageusement par la violence.
[13 juin 1968.]
Nous entrons dans la grande époque de l'effondrement de l'impérialisme, de la victoire du prolétariat et des peuples, de la pensée de Mao Zedong!
Un document de mai 1968.
La grande révolution culturelle prolétarienne puise un nouvel essor dans la ligne révolutionnaire incarnée par le président Mao. Les larges masses révolutionnaires se 'livrent à une réfutation sans merci de la ligne réactionnaire bourgeoise. C'est donc dans une situation excellente, et remplis d'un esprit de fierté militante que nous honorons la mémoire de Lou Sin — notre précurseur dans la révolution culturelle.
La colère gronde parmi les masses populaires.
Tract du tout début de mai 1968.
Communiqué au début de mai 1968.
La pensée de Mao est le marxisme-léninisme de notre époque parce qu'elle constitue le bilan et la synthèse de l'expérience d'un siècle de lutte du mouvement ouvrier.
Depuis plus d'un mois, un nombre grandissant d'étudiants et de jeunes se révoltent et luttent contre la bourgeoisie. Les étudiants de Nanterre ont dans cette révolte joué un rôle d'avant-garde.
Notre éditorial Levons haut le grand drapeau rouge de la pensée de Mao Zedong ; participons activement à la grande révolution culturelle socialiste a eu un immense retentissement, tant dans l'Armée populaire de Libération qu'en dehors d'elle. La grande masse des ouvriers, des paysans, des soldats et des cadres révolutionnaires a fait preuve d'un, remarquable enthousiasme révolutionnaire et nous a envoyé des flots de lettres et d'articles.
Active dans la lutte, elle exprime sa vive indignation contre la ligne noire, antiparti et antisocialiste, qui s'est manifestée dans le domaine culturel.
Elle sait que la grande polémique actuelle sur le front culturel ne se résume pas, en fin de compte, à une question concernant 1quelques articles, pièces ou films, ni simplement à un débat académique...
Au moment où la « justice » colonialiste française veut frapper à travers le GONG [Groupe d'Organisation Nationale de Guadeloupe] tous les patriotes guadeloupéens, le Bureau Politique de l'UJC{(ML) salue la lutte courageuse des patriotes guadeloupéens avec à leur tête le GONG.
Le chef de file de l'impérialisme américain, Lyndon Johnson, a lancé sur le marché ce qu'il a appelé un programme de « suspension partielle des bombardements », programme visant en fait à escroquer la paix, mais en moins de deux semaines, avant même que son complot ait été mis pleinement à exécution, les intentions meurtrières de Johnson se sont révélées au grand jour.
Un grand nombre de faits ont en effet prouvé que le stratagème de Johnson était une grande, pure et simple, une énorme supercherie.
Qu'a donc fait l'administration Johnson au cours des quinze jours qui viennent de s'écouler ?
Au moment précis où Johnson en appelait à la « réalisation de la paix »au Vietnam, le gouvernement américain adaptait unesérie de mesures destinées à y intensifier sa guerre d'agression. Il ordonnait un appel sous les armes de 24.500 réservistes des forces terrestres, navales et aériennes, se préparant à porter à près de 550.000 les effectifs destinés à l'agression au Vietnam. Le gouvernement américain s'est démené pour déplacer ses troupes et ses commandants. C'est ainsi qu'il a remplacé Westmoreland, commandant des troupes d'agression américaines au Vietnam par Craighton Abrams, auquel la population Sud-Vietnamienne a également infligé un grand nombre de défaites...
Que nos camarades mettent tout en oeuvre pour qu'au moment décisif ils puissent assumer pleinement le rôle d'avant-garde dans le mouvement étudiant, et la révolte de la jeunesse et des étudiants sera une nouvelle étincelle de la lutte populaire.
L'offensive du Têt est devenue pour tous les vietnamiens la fête des opprimés à la conquête de la liberté.
Le travail que nous avons à faire est immense. Mais nous devons être conscients que le développement en France de la lutte anti-impérialiste ne dépend pas seulement de nos propres efforts subjectifs.
A l'exemple des paysans de Naxalbari, le peuple indien osera se révolter contre tous ceux qui l'oppriment.
La lutte anti-impérialiste, le soutien aux peuples qui affrontent directement l'impérialisme n'est pas pour le peuple français quelque chose d'abstrait, de surajouté, un supplément artificiel à son combat propre.
Le programme du PCMLF nouvellement fondé.
Le procès machiné par l'état impérialiste français contre les patriotes guadeloupéens s'est rapidement transformé en tribune d'accusation du pouvoir colonial et de ses complices.
Un important mouvement a été déclenché dans l'U. J. C. : des militants marxistes-léninistes se constituent en groupes d'établissement et vont parmi les niasses populaires, vivre parmi elles et travailler à la production.
S'assurer des succès locaux, succès signifiant des luttes victorieuses dirigées par des m.-l. contre l'ennemi de classe et ses alliés (dénonciation pratique du révisionnisme), c'est avancer considérablement dans l'éducation du peuple français, c'est lui permettre de voir clairement, par sa propre expérience, que l'ennemi peut être vaincu.
Le rapport sur le travail mené jusque-là et présenté au premier congrès du PCMLF.
Il n'y a pas de question plus importante pour les ouvriers que celle de la conquête du pouvoir. Toutes les luttes qu'ils mènent seraient sans avenir, s'ils ne prenaient pas en fin de compte le pouvoir politique.
Un compte-rendu de l'attaque armée menée par le PCF contre le PCMLF naissant.
Salut camarades ! Tous mes vœux aux camarades pour une victoire totale de la Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne !
(Applaudissements chaleureux de tout le public.)
Je n’ai pas participé à la précédente période de la grande révolution culturelle au Hunan et n’ai fait aucune enquête à son sujet. Ce n’est que le 2 de ce mois que, conjointement avec le Premier ministre Chou, je suis entré en contact avec elle. Je ne sais rien de la révolution culturelle du Hunan. La visite que me firent les camarades du Hunan fut la seule occasion où je pus me renseigner, grâce aux documents qu’ils me fournirent. J’adresse donc mes remerciements à ces camarades ! On m’a remis de nombreux documents, mais je n’ai pas eu le temps de les lire tous. C’est pourquoi je n’ai pu procéder à une étude détaillée de ces documents. Je n’ai lu quele « programme » du Cheng-wu-lien... Tout le monde devrait lire cet étrange programme...
L'esprit de coterie bourgeois et petit-bourgeois peut se comparer à un serpent venimeux dont la morsure est redoutable.
Ce serpent étreint certains profondément infectés.
Aussi est-il indispensable, afin d'éveiller la vigilance de tous les révolutionnaires, d'énumérer les crimes de l'esprit de coterie.
Ne pas mettre en pratique, ne pas appliquer rigoureusement les directives du camarade Mao Zedong, ne pas écouter la voix du quartier général prolétarien. N'extraire des directives que ce qu'on aime, brouillant ainsi l'orientation générale de la lutte, ébranlant les dispositions stratégiques du quartier général du camarade Mao Zedong.Tel est le premier crime de cet esprit. Rejeter l'intérêt du peuple, du parti, de l'Etat, de l'ensemble, pour ne tenir compte que de sa propre tendance. Tel en est le deuxième crime...
Pour observer la situation correctement, il faut, comme nous l'enseigne le Président Mao, faire des comparaisons.
Pour résister aux luttes des ouvriers, la bourgeoisie française a toujours tenté de trouver un appui dans les campagnes.
A l'heure actuelle, la situation dans les régions rurales est excellente.
De même que les larges masses révolutionnaires urbaines, les centaines de millions d'anciens paysans pauvres et paysans moyens de la couche inférieure sont pleinement mobilisés. Guidés par la ligne révolutionnaire prolétarienne du président Mao, ils entreprennent le combat contre l'égoïsme et la réfutation du révisionnisme, ce qui permet d'élever considérablement leur niveau de conscience socialiste. Le grand mouvement révolutionnaire a impulsé un nouvel essor de la production : la récolte de cette année est superbe. La campagne chinoise présente un aspect de prospérité générale.
Réfuter de façon encore plus approfondie la ligne révisionniste contrerévolutionnaire du Khrouchtchev chinois concernant les régions rurales, liquider son influence néfaste, constitue à l'heure actuelle une tâche de combat d'importance majeure pour développer la grande révolution culturelle prolétarienne dans les campagnes...
Le « nouveau système économique » pratiqué par la clique dirigeante révisionniste soviétique n'est rien moins qu'un système économique capitaliste en même temps qu'une importante mesure qu'elle adopte pour la restauration du capitalisme sur toute la ligne dans les secteurs économiques.
Depuis la grande Révolution socialiste d'Octobre, 50 années se sont écoulées.
Dirigée par Lénine, le grand éducateur du prolétariat, elle faisait, pour la première fois, une réalité de la théorie sur la dictature du prolétariat formulée par Marx et Engels et, sur un sixième du globe, était fondé le premier Etat de dictature du prolétariat de l'histoire de l'humanité.
Pour l'humanité, une nouvelle ère commençait.
Une nouvelle époque s'ouvrait, celle de la révolution prolétariennemondiale et de la dictature du prolétariat.
Une nouvelle époque commençait, celle de la lutte de libération des nations oppimées dirigée par le prolétariat...
Pour restaurer le capitalisme dans tous les domaines et consolider leur domination réactionnaire, Khrouchtchev et ses successeurs — la clique renégate Brejnev-Kossyguine — ont agi, en ce qui concerne l'édification du Parti, suivant toute une série de principes de bout en bout révisionnistes.
Depuis une dizaine d'années, la clique révisionniste soviétique ne ménage pas ses efforts, dans l'agriculture, pour former une couche de privilégiés dans les régions rurales, introduire le « principe du profit » capitaliste, supprimer le système de planification socialiste, encourager et développer l'économie privée ainsi que le libre commerce des produits agricoles.
Comme tout le monde le sait, Khrouchtchev, après avoir usurpé la direction du Parti et de l'Etat en Union soviétique, a promu au rang de politique d'Etat l'assimilation des méthodes d'exploitation capitalistes des EtatsUnis.
par un groupe de révolutionnaires prolétariens de la Fédération des Syndicats de Chine populaire
Publié dans le Renmin Ribao du 5 octobre 1967
Présentation du Renmin Ribao :
La Chine d'aujourd'hui est le foyer des contradictions dans le monde et le centre de la tempête de la révolution mondiale.
Où va la Chine ? Suivratelle la voie socialiste ou la voie capitaliste ? C'est là non seulement la question fondamentale de la politique chinoise, mais aussi une question touchant le sort de la révolution prolétarienne mondiale.
Sur cette question fondamentale, il existe, depuis plusieurs décennies, dans chaque étape historique du développement de la révolution chinoise et à chaque moment crucial marquant un tournant de la révolution, deux lignes diamétralement opposées au sein du Parti communiste chinois, entre lesquelles la lutte est acharnée.
Une ligne soutient que la révolution chinoise doit nécessairement se faire sous la direction du prolétariat, qu'elle doit entrer dans l'étape de la révolution socialiste en passant par l'étape de la révolution de démocratie nouvelle et que la révolution sous la dictature du prolétariat doit être menée jusqu'au bout pour réaliser finalement le communisme. C'est là la ligne révolutionnaire prolétarienne incarnée par notregrand guide, le président Mao...
par les bureaux de rédaction du Wenhui Bao, du Jiefang Ribao et du Zhibu Shenguo
Publié le 10 août 1967
Que le prolétariat saisisse le pouvoir par la lutte armée ou par «la voie parlementaire »', c'est là la divergence fondamentale entre le marxismeléninisme et le révisionnisme.
Toute l'histoire du mouvement communiste international nous enseigne que les révisionnistes, grands ou petits, ont toujours été des partisans du « crétinisme parlementaire. »
Sans exception, ils ont nié que la révolution par la violence est la loi universelle de la révolution prolétarienne.
1. L’anarchisme nie le pouvoir du prolétariat et est opposé à la pensée mao zedong. « Nous ne reconnaissons aucune autorité basée sur la confiance. Toutes les règles et toutes les contraintes doivent être abolies. »
Toutes ces négations reviennent à rejeter toute autorité, même le pouvoir du prolétariat, et en particulier le pouvoir absolu de la pensée Mao Zedong.
2. L’anarchisme nie toute direction loyale à la pensée mao zedong et invite à bombarder le quartier général du prolétariat. « Vive la suspicion envers tout ! Rejetez tout, renversez tout ! A bas tous les gouvernants, supprimez toutes les barrières ! » Cela veut-il dire que la direction du quartier général prolétarien, représentée par le président Mao, doit être soumise elle aussi, à la suspicion ? et doit-il être également rejeté et renversé ? Doit-il être aussi considéré comme une « barrière » et « supprimé » ?
3. L’anarchisme abolit la différence fondamentale existant entre la dictature prolétarienne et la dictature bourgeoise, et s’oppose à la dictature prolétarienne...
Une critique de l'UJC(ml), issu de l'Union des Etudiants Communistes et qui rejette le PCMLF.
Dès le début, la grande révolution culturelle prolétarienne de Chine a frappé la clique des renégats révisionnistes soviétiques au point le plus sensible et a secoué leur "trône" chancelant.
Une critique du PCF par la nouvelle organisation marxiste-léniniste.
Ecrit par les rédactions du Hongqi et du Renmin Ribao. Selon une lettre du nouveau responsable de la propagande Wang Li à la direction de l'agence de presse Chine Nouvelle : « Il paraît que le président Mao l'a corrigé et critiqué lui-même. Cet article fait suite aux débats de la séance élargie du bureau politique. »
Le livre sur le « perfectionnement individuel » des communistes est l'œuvre représentative du plus haut des responsables qui, bien que du Parti, se sont engagés dans la voie capitaliste. Ce livre est une grande herbe vénéneuse qui s'oppose au marxisme-léninisme et à la pensée de Mao Zedong. Son poison s'est répandu par tout le pays et dans le monde. Il faut donc entreprendre une critique à fond de ce livre.
Quelle est donc l'essence de ce sinistre ouvrage sur le « perfectionnement individuel » des communistes ?
Dans son essence, ce triste ouvrage trahit la doctrine marxiste léniniste sur la dictature du prolétariat. Et trahir cette doctrine,c'est trahir intégralement et radicalement le marxisme léninisme, c'est trahir complètement, radicalement la cause révolutionnaire du prolétariat...
Etre présent dans tous les détachements du peuple est indispensable si l'on veut entraîner dans la lutte pour les transformations nécessaires la majorité réelle ; mais cela ne signifie pas que le Parti Communiste doive organiser directement l'ensemble des classes, couches et groupes sociaux qui, à un moment déterminé, composent le peuple, ni que son implantation dans les différentes catégories du peuple revête la même importance, et puisse être mise sur le même plan.
Rapport sur une rencontre ouvrière organisée par le PCMLF.
VIVE L'UNION DES JEUNESSES COMMUNISTES (MARXISTES-LÉNINISTES)
[Tiré de Jeune Garde, n°1, mars 1967. Jeune Garde est le journal de la cellule Alfred Gandois de Lyon.]
Sur les ruines de la vieille U. E. C. révisionniste, la cellule Alfred Gandois de l'U. J. C. (M.-L.) se constitue aujourd'hui publiquement.
C'est le fruit d'une lutte de principe menée patiemment dans l'U. E. C. révisionniste.
... La Commune de Paris, la Commune ; n'avons nous pas tous dit qu'une réédition de la Commune de Paris serait une nouvelle forme de pouvoir d'État ? La Commune de Paris fut créée en 1871, voici quatrevingtseize ans ; si la Commune de Paris n'avait pas abouti à un échec, si elle avait triomphé, elle serait certainement devenue de nos jours, je pense, une commune de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie française n'aurait certainement pas permis à la classe des travailleurs français de garder un pouvoir politique aussi étendu entre ses mains. Voilà ce qu'était la Commune de Paris. Quant au pouvoir d'État des Soviets... Jadis, dès la naissance du pouvoir d'État des Soviets, Lénine se frotta les mains ; il pensait que c'était une création formidable des travailleurs, des paysans et des soldats, une nouvelle forme de dictature dy prolétariat.
Mais Lénine n'avait pas pensé jadis que nï les travailleurs, ni les paysans, ni les soldats ne pourraient utiliser un tel régime, pas plus que la bourgeoisie ni même en fin de compte Khrouchtchev. En effet, les Soviets actuels... Eh bien, les Soviets de Lénine se sont métamorphosés en Soviets da Khrouchtchev. L'Angleterre est une monarchie, estce qu'ils n'ont pas une reine ? L'Amérique a un régime présidentiel, mais au fond, il n'y a aucune différence, ce sont de part et d'autre des dictatures de la bourgeoisie...
Les révisionnistes n'ont pas de place dans un front uni contre l'impérialisme américain pour la bonne raison qu'ils en sont les agents au sein du mouvement ouvrier !
Les principes et les thèses qui constituent la résolution de la première session du premier Congrès de l'U. J. C. (m.-l.) ont guidé notre lutte contre le révisionnisme dans l'U. E. C., organisation étudiante du P. C. F. révisionniste. Cette lutte est aujourd'hui victorieuse : l'U. E. C. n'existe plus; la majorité réelle des étudiants communistes se sont placés sur les positions du marxisme-léninisme.
Editorial du Renmin Ribao et du Hongqi (1er janvier 1967)
La grande révolution culturelle prolétarienne qui a pris son essor en 1966, en Chine, est, en notre 20ème siècle, le plus grand événement des années soixante.
L'U. E. C. n'existe plus, elle a été vidée de toute substance. A sa place, mais sur un autre terrain, le terrain solide du marxisme-léninisme, une organisation naît : l'U. J. C. (m.-l.).
Editorial du Renmin Ribao du 28 aoû t 1966
Se mettre à l'école de l'Armée populaire de Libération, c'est là un grand appel lancé par le président Mao au peuple du pays tout entier.
[Mémoire des délégués français au Premier congrès de l'Association internationale des travailleurs à Genève, 1866]
Convocation
Les questions suivantes seront discutées dans le prochain Congrès:
1- Organisation de l'Association internationale;
Editorial du Renmin Ribao du 15 août 1966
Editorial du Renmin Ribao du 13 août 1966
C'est sous la direction personnelle du camarade Mao Zedong qu'a été rédigée la Décision du Comité central du Parti communiste chinois concernant la grande révolution culturelle - les 16 points.
Faire confiance aux masses, s'appuyer sur elles, les mobiliser sans réserve, respecter leur esprit d'initiative, tel est le sens fondamental des 16 points.
Editorial du Renmin Ribao du 11 août 1966
La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne en cours est une grande révolution qui touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Elle représente une nouvelle étape, marquée par une plus grande profondeur et une plus grande ampleur du développement de la révolution socialiste de notre pays.
À la dixième session plénière du Comité central issu du VIIIe Congrès du Parti communiste chinois, le camarade Mao Zedong a dit : Pour renverser un pouvoir politique, on commence toujours par préparer l'opinion publique et par agir dans le domaine idéologique...
Editorial du du Renmin Ribao du 29 juillet 1966
Editorial du du Renmin Ribao du 21 juillet 1966
Editorial du Renmin Ribao du 17 juillet 1966
Renmin Ribao,
5 juillet 1966
Depuis le 29 juin, l'impérialisme américain a, à maintes reprises, opéré des bombardements massifs contre les villes de Hanoi, capitale de la République démocratique du Vietnam, et de Haiphong, la deuxième ville du pays.
C'est là un acte de guerre des plus barbares et des plus forcenés qu'il ait commis.
Depuis le 29 juin 1966, les impérialistes américains ont bombardé plusieurs fois de suite et avec insolence la ville de Hanoi, capitale de la République démocratique du Vietnam, et Haiphong, la deuxième ville du pays.
Editorial du Renmin Ribao du 24 juin 1966
Editorial du Renmin Ribao du 8 juin 1966
Le développement rapide et impétueux de la grande révolution culturelle prolétarienne de notre pays a provoqué une secousse dans le monde.
Editorial du 7 juin 1966 du Jiefangjun Bao (Quotidien de l'Armée de Libération)
Editorial du Renmin Ribao du 4 juin 1966
Editorial du Renmin Ribao du 5 juin 1966
Editorial du Renmin Ribao du 4 juin 1966
Editorial du Renmin Ribao du 3 juin 1966
Editorial du Renmin Ribao Diario du 2 juin 1966
La grande révolution culturelle prolétarienne a d'ores et déjà atteint un niveau élevé. Nous devons nous placer à l'avant-garde de ce mouvement et de le guider activement.
Editorial du Renmin Ribao du 2 juin 1966
La Chine se trouve aujourd'hui, après la prise du pouvoir par le prolétariat, dans une ère nouvelle de grandes transformations, dans une situation nouvelle, où la révolution socialiste gagne en profondeur, et au milieu du flot impétueux de la grande révolution culturelle socialiste qui touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond.
Editorial du Renmin Ribao du 1er juin 1966
La grande révolution culturelle prolétarienne que connaît la Chine socialiste, où vit le quart de la population mondiale, est en plein essor.
Aujourd'hui, au moment où la grande révolution culturelle prolétarienne bat son plein et au moment où nous attaquons énergiquement la ligne réactionnaire bourgeoise, nous rendons hommage au grand combattant communiste Lou Sin. Cette commémoration a un profonde signification pour nous, car elle nous encourage à mener jusqu'à la victoire finale la grande révolution culturelle prolétarienne.
1. ATTAQUES PERFIDES CONTRE NOTRE GRAND PARTI
par Tsi Pen-yu
Par Jiang Qing + témoignage de la troupe numéro 1 de Pékin, de l'opéra de Pékin
Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour ce festival, première campagne pour la révolution de l'opéra de Pékin. Vous avez tous fourni un labeur considérable.
Les résultats en sont prometteurs et auront probablement une profonde influence.
Désormais, on met en scène des opéras de Pékin à thème révolutionnaire contemporain, mais chacun s'en faitil la même idée ? Je crois qu'il serait prématuré de l'affirmer...
Le caractère réactionnaire des propos du soir à Yenchan et de la chronique du Village des Trois ;
par Yao Wen-yuan
Editorial du Hongqi (Drapeau rouge) n ° 14, 1966
La situation présente de la grande révolution culturelle prolétarienne est excellente.
Editorial du Hongqi, No. 12, 1966
Au cours de ces deux dernières années, les luttes spontanées des jeunes et des étudiants petits-bourgeois ont fait du bruit d’un bout à l’autre de l’Inde. Bien qu’au début, la demande de nourriture fut la revendication principale, progressivement, la revendication de l’expulsion du gouvernement du Congrès est devenue la principale. Le président Mao a dit : « Les étudiants et les jeunes petits-bourgeois sont un élément de la population et à la fin inéluctable de leur lutte, la lutte des ouvriers et des paysans atteindra un point culminant ».
par Kao Kiu
Publié dans le Jiefangjun Bao du 8 mai 1966 (Quotidien de l'Armée de Libération)
Editorial du Hongqi (Drapeau rouge) n ° 10, 1966
Editorial du Hongqi (Drapeau rouge), n ° . 9, 1966
Chose étrange et monstrueuse : " II y a un humanisme marxiste. " Ainsi en a-t-il été décidé par un vote unanime du Comité Central du Parti Communiste Français.
Un document de 1965 expliquant la rupture faite avec leur organisation par des militants du PCF.
Après une longue incarcération, les dirigeants du parti ont, après le congrès du parti, pour la première fois, eu une session du comité central au complet. La direction centrale du parti qui avait été formée par l’intermédiaire des luttes contre le révisionnisme, a adopté une résolution idéologique et a déclaré sans ménagement que toutes les critiques énoncées contre le gouvernement indien par le grand parti chinois étaient erronées.
Un premier bilan de la rupture avec le PCF.
Le premier programme élaboré par les marxistes-léninistes sortis du PCF.
Il y a certains camarades qui s’effrayent à la mention des luttes armées, et qui continuent à y voir le spectre de l’aventurisme. Ils pensent que le travail de construction d’un parti révolutionnaire s’est clôturé avec l’adoption même du programme, en d’autres termes, avec l’adoption du programme consistant en les documents stratégiques du septième congrès du parti. Ils sont simplement parvenus à la décision d’après certaines résolutions sur les mouvements adoptées au congrès du parti.
Quotidiennement, nous devrons poursuivre la lutte contre le révisionnisme, en adoptant la tactique de la prise du pouvoir à l’échelon régional. Certaines idées révisionnistes sont profondément enracinées à l’intérieur du parti. Nous devrons continuer la lutte contre celles-ci. Ici, nous examinons quelques questions.
Luttons jusqu'au bout contre le révisionnisme khroutchévien
A l'occasion du deuxième anniversaire de la publication des « Propositions générales concernant la ligne générale du mouvement communiste international »
Renin Ribao et Hongqi
14 juin 1965
[3-9 avril 1965]
Camarades, deux événements se sont produits dans le monde au cours de la période qui a suivi la deuxième guerre mondiale. Alors que, d’une part, la forme nue de la défaite des soi-disant puissances fascistes fut révélée au peuple, d’autre part, de la même manière, le système d’état socialiste mondial sous la direction du camarade Staline a instauré la confiance dans les esprits de la population.
Etant donné que les opinions révisionnistes étaient nichées dans le parti depuis longtemps, nous n’avons pas pu bâtir un parti révolutionnaire correct. Notre tâche principale aujourd’hui est de créer un parti révolutionnaire correct luttant résolument contre ces opinions révisionnistes.
Charu Mazumdar, Nos Tâches Dans La Situation Actuelle
28 janvier 1965
Le gouvernement du Congrès a arrêté un millier de communistes ce dernier mois.
La majorité de la direction centrale et provinciale est aujourd'hui en prison.
Gulzarilal Nanda a annoncé qu'il n'accepterait pas le verdict des urnes (et il ne l'a pas fait), et a commencé à débiter des absurdités à propos de la guérilla.
Khrouchtchev est tombé. Ce conspirateur invétéré qui avait usurpé la direction du Parti et de l’Etat soviétiques, ce représentant n° 1 du révisionnisme moderne, a fini par être chassé de la scène de l’histoire.
Considérant :
Ouvriers,
L'annonce de la naissance du premier regroupement marxiste-léniniste, en-dehors du PCF.
La théorie de la révolution prolétarienne et de la dictature du prolétariat constitue l’essence même du marxisme-léninisme.
Cet article est consacré à une question célèbre, celle du « passage pacifique ».
Une critique de la soumission du PCF aux socialistes.
Jamais l’unité du mouvement communiste international n’a été aussi menacée qu’aujourd’hui par le déferlement du courant du révisionnisme moderne.
La coexistence pacifique doit être la chose dont Khrouchtchev et d’autres camarades parlent le plus depuis le XXe Congrès du P.C.U.S.
Les dirigeants du P.C.U.S. répètent à tout bout de champ qu’ils sont fidèles à la politique de coexistence pacifique de Lénine et qu’ils l’ont développée de manière créatrice. Ils portent au crédit de leur politique de « coexistence pacifique » toutes les victoires arrachées par les peuples au prix de longues luttes révolutionnaires.
Rédaction du Renmin Ribao et Rédaction du Hongqi, 19 novembre 1963
Le monde entier discute de la question de la guerre et de la paix.
Rédaction du Renmin Ribao et Rédaction du Hongqi, 22 octobre 1963
La révolution bat violemment en tempête en Asie, en Afrique et en Amérique latine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’indépendance a été proclamée dans plus de cinquante pays d’Asie et d’Afrique. La Chine, le Vietnam, la Corée et Cuba ont pris la voie du socialisme. Le visage de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine a connu des changements énormes.
La restauration du capitalisme en Yougoslavie constitue pour le mouvement communiste international un nouvel enseignement historique.
Rédaction du Renmin Ribao et Rédaction du Hongqi, 13 Septembre 1963
La question de Staline est une grande question, une question d'importance mondiale qui a eu des répercussions au sein de toutes les classes du monde et qui, jusqu'à présent encore, est largement controversée. Les classes et les partis politiques ou factions politiques qui représentent les différentes classes ont des opinions divergentes sur cette question.
Trahissant ouvertement le marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien, répudiant avec impudence les Déclarations de 1957 et de 1960 et violant d'une manière flagrante le Traité sino-soviétique d'Amitié, d'Alliance et d'Assistance mutuelle, la direction du P.C.U.S. s'est alliée à l'impérialisme américain, aux réactionnaires indiens et à la clique du renégat Tito pour s'opposer à la Chine socialiste et à tous les partis marxistes-léninistes.
La ligne générale du mouvement communiste international doit être fondée sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste relative à la mission historique du prolétariat, et ne doit pas s'en écarter.
Le 14 juin 1963, le Parti Communiste de Chine répondait à une lettre du Parti Communiste d'Union Soviétique ; la lettre de réponse devint fameuse comme Lettre en 25 points. Le huitième point traite de la question de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, présentées comme « la zone des tempêtes ».
La longue critique chinoise de Togliatti.
La camarade Jiang Qing a proposé de commencer par lire des œuvres littéraires et, ensuite, d'étudier des documents et matériaux ayant trait à ces problèmes, avant d'ouvrir la discussion.
Elle nous a recommandé la lecture des œuvres du président Mao ayant trait à ces problèmes.
Elle a eu 8 entretiens particuliers avec des camarades de l'armée, elle a participé à 4 discussions collectives et a assisté en notre compagnie à 13 projections cinématographiques et à 3 représentations théâtrales.
Elle a échangé des vues avec nous au cours même de la projection de ces films et de la représentation de ces pièces...
La clique révisionniste de Dange s'est emparé de la direction du Parti communiste indien en mettant à profit, pendant les douze derniers mois, la vaste campagne antichinoise, anticommuniste et antipeuple déclenchée par les groupes dirigeants de la grande bourgeoisie et des grands propriétaires terriens de l'Inde.
Le camarade Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, et certains autres camarades de ce Parti jouent un rôle marquant dans l'actuel contrecourant dirigé contre le Parti communiste chinois et d'autres partis frères et qui sape l'unité du mouvement communiste international.
L'histoire se répète dans des conditions différentes et sous des formes différentes.
Nous avions espéré que, se tenant dans de telles circonstances, le Congrès du Parti socialiste unifié d'Allemagne se conformerait aux deux Déclarations deMoscou, contribuerait au renforcement de l'unité du camp socialiste et de l'unité du mouvement communiste international. L
Camarades, il est plus que jamais nécessaire pour nous, communistes, de veiller au maintien et au renforcement de l'unité du camp socialiste, au maintien et au renforcement de l'unité du mouvement communiste international.
Nous voulons dire en toute franchise qu'il existe entre le camarade Togliatti et certains autres dirigeants du Parti communiste italien d'une part, et nous-mêmes, d'autre part, des divergences de principe sur des problèmes fondamentaux du marxisme-léninisme.
Nous ne pouvons que regretter au plus haut point que se soient produits de tels actes qui vont à rencontre du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien.
Les camarades engagés dans les activités scissionnistes devraient se reprendre!
Le plus important pour les communistes, c'est de faire une distinction bien nette entre l'ennemi et nous, entre le vrai et le faux.
Le P.C.C. est toujours resté fidèle au marxisme-léninisme et a toujours maintenu les positions théoriques du marxisme léninisme.
Par le Bureau de rédaction du « Renmin Ribao », 22 avril 1960
C’est aujourd’hui 22 avril, le 90ème anniversaire de la naissance du grand Lénine.
Par le Bureau de rédaction de la revue « Hongqi », 16 avril 1960
Le 22 avril de cette année marque le 90ème anniversaire de la naissance de Lénine.
En 1871, l’année qui suivit la naissance de Lénine, se produisit l’héroïque soulèvement de la Commune de Paris. La Commune de Paris est une grande révolution qui a fait époque, elle est la première répétition générale de portée mondiale faite par le prolétariat pour tenter de renverser le système capitaliste.
Rédaction du Renmin Ribao, décembre 1957
Quel marxiste éminent a jamais écrit que nous ne commettrons jamais d'erreurs ou qu'il est absolument impossible qu'un communiste puisse en commettre?
Monsieur,
Je viens de recevoir votre Lettre, et en même temps l’on m’a apporté une copie manuscrite de la censure. Je me suis trouvé aussi bien traité dans l’une, que M. Arnauld l’est mal dans l’autre. Je crains qu’il n’y ait de l’excès des deux côtés, et que nous ne soyons pas assez connus de nos juges. Je m’assure que, si nous l’étions davantage, M. Arnauld mériterait l’approbation de la Sorbonne et moi la censure de l’Académie. Ainsi nos intérêts sont tout contraires. Il doit se faire connaître pour défendre son innocence, au lieu que je dois demeurer dans l’obscurité pour ne pas perdre ma réputation. De sorte que, ne pouvant paraître, je vous remets le soin de m’acquitter envers mes célèbres approbateurs, et je prends celui de vous informer des nouvelles de la censure...
MONSIEUR,
Nous étions bien abusés. Je ne suis détrompé que d’hier ; jusque-là j’ai pensé que le sujet des disputes de Sorbonne était bien important, et d’une extrême conséquence pour la religion. Tant d’assemblées d’une compagnie aussi célèbre qu’est la Faculté de théologie de Paris, et où il s’est passé tant de choses si extraordinaires et si hors d’exemple, en font concevoir une si haute idée, qu’on ne peut croire qu’il n’y en ait un sujet bien extraordinaire...
Aux participants à la discussion économique.
Remarques relatives aux questions économiques soulevées à la discussion de novembre 1951
(22 novembre 1951)
L'Académie Pontificale des Sciences avait organisé une semaine d'études des problèmes de microséïsme ; les spécialistes de la question furent reçus en audience et le Pape prononça en cette occasion, le discours suivant :
[Cahiers du communisme, août 1950, p.47-54.]
(Publié dans la revue du Parti Communiste français Cahiers du communisme, en août 1950)
La campagne en faveur du « communisme » yougoslave bat son plein. Il n'est pas de semaine où quelque nouveau reportage ne chante les louanges de Tito, le vrai, le seul, l'unique chef d'Etat dont puissent se réclamer les « révolutionnaires authentiques ».
Les représentants des Partis Communistes de France, d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Belgique et du Luxembourg ont examiné les conséquences néfastes que comporterait l'application du plan dit Schuman pour la paix du monde et l'intérêt de leurs peuples.
Fernand Grenier, décembre 1949
Les représentants du Parti communiste de Bulgarie, du Parti ouvrier Roumain, du Parti des travailleurs hongrois, du Parti ouvrier unifié de Pologne, du Parti communiste (bolchévik) de l’U.R.S.S., du Parti communiste français, du Parti communiste italien et du Parti communiste de Tchécoslovaquie, après avoir discuté de la défense de la paix et de la lutte contre les fauteurs de guerre, sont arrivés à un accord unanime sur les conclusions suivantes.
Gaston Monmousseau, 1949
Vos lettres du 17 mai 1943 et du 20 mai 1943, portant les signatures des camarades Tito et Kardelj ont été reçues.
Le CC du PC (b) estime que les dirigeants du Parti communiste yougoslave font avec ces lettres un nouveau pas sur la voie qui aggrave les erreurs de principe les plus grossières dont le CC du PC (b) a souligné le danger et la nuisance dans sa lettre du 4 mai 1943.
Dans votre lettre, vous exprimez, le désir que nous vous communiquions quels sont les autres faits qui provoquent le mécontentement de l'URSS et qui entraînent l'aggravation des rapports entre l'URSS et la Yougoslavie.
De tels faits existent, en réalité, et bien qu'ils soient étrangers au rappel des conseillers civils et militaires, nous estimons nécessaire dé vous les communiquer.
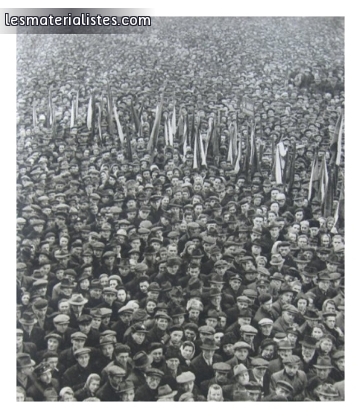


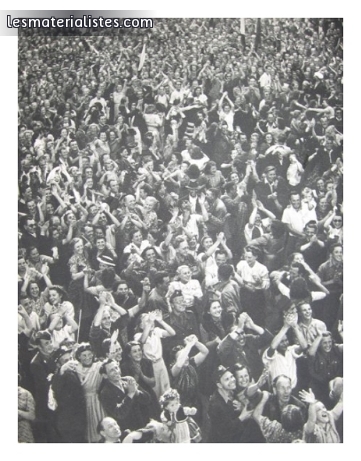
COMMUNIQUE SUR LA CONFERENCE D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DE QUELQUES PARTIS COMMUNISTES
LE DEVOIR ESSENTIEL DES PARTIS COMMUNISTES :
DEFENDRE, CONTRE LES PLANS IMPERIALISTES D’EXPANSION ET D’AGRESSION, L’HONNEUR ET LA SOUVERAINETE DE LEURS PAYS
RESOLUTION SUR L’ECHANGE DES EXPERIENCES ET LA COORDINATION DE L’ACTIVITE DES PARTIS REPRESENTES A LA CONFERENCE
La Conférence constate que l’absence de contacts entre les Partis Communistes qui y sont représentés comporte dans la situation de sérieux inconvénients.
DECLARATION SUR LES PROBLEMES DE LA SITUATION INTERNATIONALE
Les représentants du Parti Communiste de Yougoslavie, du Parti Ouvrier Bulgare (communiste), du Parti Communiste de Roumanie, du Parti Communiste Hongrois, du Parti Ouvrier Polonais, du Pari Communiste (bolchévik) de l’U.R.S.S., du Parti Communiste Français, du Parti Communiste de Tchécoslovaquie et du Parti Communiste d’Italie, après avoir échangé leurs vues sur les problèmes de la situation internationale, se sont mis d’accord sur la déclaration suivante :
RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE (1947)
PC(b) de l'URSS
Rapport présenté par Andreï Jdanov, membre du Bureau Politique du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S., le 22 septembre 1947, devant la Conférence d'Information des Partis Communistes (réunion constitutive du Kominform), à Szklarska Poreba (Pologne)
Ce rapport a été publié le 1er novembre 1947 dans Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, l'organe du Kominform.
Jacques Duclos, juin 1947
Discours au XIème congrès du Parti Communiste Français
25/28 Juin 1947
Après le magnifique rapport du Secrétaire général du Parti Communiste Français, Maurice Thorez, tous les délégués de notre Parti présents dans cette salle ne peuvent pas ne pas être convaincus du caractère sérieux et grave de la situation politique actuelle.
Déclaration de Maurice Thorez au journal anglais The Times du Le 18 novembre 1946, où il présente pour la première fois la voie française au socialisme, concept révisionniste liquidant définitivement la base scientifique et parachevant son oeuvre au sein du PCF.
QUESTION. - Comment jugez-vous le dernier discours prononcé par M. Churchill aux Etats-Unis?
RÉPONSE. - J'estime que ce discours est un acte dangereux, qui vise à semer des germes de discorde entre les Etats alliés et à rendre plus difficile leur collaboration.
QUESTION. - Peut-on estimer que le discours de M. Churchill compromet la paix et la sécurité mondiale?
LE PRÉSIDENT : La parole est à Joseph Vissarionovitch Staline. (L’apparition de Staline à la tribune est saluée par les électeurs d’une ovation enthousiaste qui dure plusieurs minutes. Tous les assistants, debout dans la salle du Grand Théâtre, acclament Staline : « Pour le grand Staline, hourra ! » « Vive le grand Staline, hourra ! » « Pour notre cher Staline, hourra ! »)
C'est une tâche bien difficile et une lourde responsabilité que j'ai prise de vouloir, en une brève conférence, résumer le prodigieux développement des sciences en U.R.S.S. et l'immense portée de l'œuvre déjà accomplie. J'essaierai toutefois de dégager les faits essentiels, de dresser un tableau de l'organisation actuelle de la recherche scientifique dans cette grande nation. Je serai soutenu dans cette tâche par le vif souvenir que j'ai gardé des divers séjours que j'ai faits en Union Soviétique, et les divers contacts que j'ai eus à plusieurs reprises avec les milieux scientifiques de ce pays.
En 1933, à Leningrad, j'ai participé avec plusieurs collègues français à une réunion de Physique nucléaire...
Jacques Duclos, août 1944
Au début de cette réunion de notre C.C. Que nous sommes heureux de voir présidée par notre vénéré Marcel Cachin, je veux rendre hommage à la mémoire de nos morts, membres du C.C., Pierre Sémart, fusillé ; Gabriel Péri, fusillé ; Félix Cadras, fusillé ; Pierre Rebière, fusillé ; Georges Wodli, pendu ; Jean Catelas, guillotiné ; Nédelec, mort de maladie dans la clandestinité.
André Marty, ALGER, le 22 août 1944.
Louis Aragon, 1944
[Honoré d’Estienne d’Orves est « celui qui croyait au ciel », Gabriel Péri « celui qui n’y croyait pas »; Gabriel Péri n'est par contre pas enterré au cimetière d'Ivry.]
Légende de Gabriel Péri
André Marty, 1944
Le 31 juillet 1914, Jaurès est assassiné. Les quartiers ouvriers de Paris roulent vers le centre, dans une émotion énorme. La colère est immense contre les gouvernants qui, de toute évidence, ont poussé l’assassin.
Louis Aragon, février 1942
Nous reproduisons ci-après, le texte paru dans L’Homme communiste (édité chez Gallimard en 1946) ainsi que les notes de bas de pages ajoutés par Aragon. Ce texte a été écrit en février 1942, à l’aide des lettres des internés de Châteaubriant et des renseignements recueillis sur place – le tout transmis à Aragon par la direction clandestine du Parti.
Parti Communiste SFIC, 1942
Chers camarades,
Gabriel Péri, avril 1941
1941
Au fur et à mesure que la guerre impérialiste se prolonge et s'amplifie, en même temps que s'aggravent partout les contradictions de classe et la sourde colère des masses populaires contre l'oppression nationale et contre l'esclavage colonial, la peur du communisme devient de plus en plus grande chez les ploutocrates des divers pays capitalistes.
Georges Guingouinv, août 1940
[appel a la lutte adressé aux militants par Georges Guingouin, Secrétaire du rayon communiste clandestin d'Eymoutiers, Haute-Vienne]
Pour comprendre les événements actuels il est bon de revenir en arrière.
André Marty, septembre 1939
Monsieur le Conseiller d'Etat,
Vous voici donc satisfait :
Après l'interdiction de l'Humanité et de la presse communiste, le Parti Communiste Français est dissous et ses membres traqués.
Le Parti Communiste déclare que ce serait une erreur gravissime que de chercher à cacher l’extrême gravité de la situation. La perte de la Catalogne, de l’Armée et du matériel de guerre qui s’y trouvait, constitue un coup très dur porté à la République, qui change profondément, en les aggravant, les conditions de notre lutte pour l’indépendance et la liberté de l’Espagne.
Mais la situation passerait de grave à catastrophique si les dirigeants des organisations et des partis, si le gouvernement, si les chefs de l’Armée perdaient leur sérénité et leur confiance en la capacité combative et en l’esprit de sacrifice des soldats et du peuple, et s’ils s’orientaient non pas vers la résistance, mais vers l’abandon de la lutte, vers la capitulation...
Il est très difficile de prononcer des mots d'adieu adressés aux héros des Brigades Internationales, par ce qu'ils sont et par ce qu'ils représentent.
Un sentiment d'angoisse, d'infinie douleur vous monte à la gorge vous la serrant comme des tenailles...
Angoisse pour ceux qui s'en vont, soldats de l'idéal le plus élevé de la Rédemption humaine, déracinés de leur patrie, poursuivis par la tyrannie de tous les peuples...
Gabriel Péri, septembre 1938
[Paru le 29 septembre 1938 dans L'Humanité]
Les coups de théâtre se succèdent. Hier, au début de l'après-midi, l'Europe a appris la grande nouvelle : MM. Daladier et Chamberlain rencontreront, aujourd'hui, à 15 heures, à Munich, Mussolini et Adolf Hitler.
La situation politique mondiale dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise historique de la direction du prolétariat.
La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. Les crises conjoncturelles, dans les conditions de la crise sociale de tout le système capitaliste, accablent les masses de privations et de souffrances toujours plus grandes. La croissance du chômage approfondit, à son tour, la crise financière de l'État et sape les systèmes monétaires ébranlés. Les gouvernements, tant démocratiques que fascistes, vont d'une banqueroute à l'autre...
Programme d'unité d'action de l'U.G.T. et de la C.N.T.
publié par le journal Frente Rojo le 18 mars 1938, rédigé à Barcelone
La C.N.T. et l'U.G.T., pénétrées du souci constant de remporter la victoire, d'assurer la défense des conquêtes politiques et économiques obtenues par le prolétariat pendant la révolution, et de tendre de toute manière à leur extension, créent un Comité national de liaison, dont elles définissent les fonctions sur les bases suivante...
C'est avec une joie et un enthousiasme sans bornes que les millions de travailleurs du monde entier, tous ceux qui luttent contre le brigandage capitaliste, la barbarie fasciste et les guerres impérialistes, fêtent le XXe anniversaire de la grande Révolution socialiste d'Octobre.
Dans tous les pays, les partisans honnêtes de la démocratie, du progrès et de la paix, l'élite de la science, de la culture et de l'art, saluent les vingt années d'existence du premier Etat socialiste du monde, comme un événement d'une portée historique universelle....
Raymond Guyot, septembre 1937
Convoqué à Paris, du 10 au 14 juillet, le IXe Congrès de la Fédération de Jeunesses Communistes de France s'est déroulé dans le cadre magnifique de la capitale de la France du Front Populaire, avec ses inoubliables manifestations du 14 Juillet et sa retentissante Exposition 1937.
Auguste Havez, juillet 1937
Gaston Monmousseau, mai 1937
Jacques Duclos, avril 1937
Les événements tragiques de Clichy dont les ligues factieuses reconstituées en Partis portent la lourde responsabilité, ont servi de prétexte à de nouvelles attaques de la réaction contre le Parti communiste et contre le Front populaire.
Parti Comuniste SFIC, mars 1937
[Procès verbal de la séance du Bureau politique]
Le Bureau politique a tenu séance jeudi matin 25 mars sous la présidence de François Billoux, député de Marseille, retour d'Espagne.
Il s'est préoccupé de la grave menace contre la paix que constituent les déclarations faites au nom du dictateur italien par M. Grandi, ambassadeur à Londres.
mars 1937
Peuple de Paris !
Tu vas, cet après-midi, en un émouvant cortège, accompagner à leur dernière demeure les morts de Clichy : Émile Mahé, Arthur Lepers, René Chrétien, Marcel Cerrutti et Victor Mangemann, dont les noms sont venus s'ajouter à la liste de tous ceux qui sont tombés pour la cause de la liberté et de la paix.
Parti communiste SFIC, mars 1937
[proclamation du parti communiste français]
Parti Communiste SFIC, mars 1937
Le Bureau politique du Parti communiste français s'est réuni ce matin, jeudi, au siège du Comité central, sous la présidence de Marcel Cachin.
Douloureusement ému par les sanglants événements de Clichy, le Bureau politique s'incline devant les malheureuses victimes qui s'ajoutent à la liste déjà longue des meilleurs fils de la classe ouvrière qui ont donné leur vie pour la défense de la République, pour la sauvegarde de la démocratie et de la paix.
Ensuite, la tâche du fascisme est d’affaiblir par tous les moyens possibles le gouvernement de la République ainsi que le gouvernement de la Généralité de Catalogne. Dans ce sens aussi, les trotskistes leur rendent des services merveilleux.
Cecile Vassart, janvier 1937
Les femmes, dans le Parti communiste, sont égales aux hommes. Elles adhèrent à notre Parti au même titre que les hommes, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
décembre 1936
Notre camarade Maurice Thorez, dans son rapport présenté au VIIIè Congrès national du Parti communiste français a déclaré
Gabriel Péri, décembre 1936
Quelques inculpations ont été lancées récemment contre différents chefs des organisations fascistes.
Rapport présenté au VIIIe congres extraordinaire des Soviets de l'URSS le 25 novembre 1936.
I - LA COMMISSION DE LA CONSTITUTION, SA FORMATION ET SES TACHES
Camarades,
Daniel Marecot, octobre 1936
I
« Le trotskisme, c'est le détachement d'avant-garde de la bourgeoisie contrerévolutionnaire. » Ces paroles du camarade Staline, prononcées il y a déjà quelques années, qui en aurait imaginé une confirmation aussi complète que celle que vient d'apporter le récent procès de Moscou ?
Georgi Dimitrov
Intervention à la réunion du secrétariat du Comité exécutif de l'Internationale communiste concernant la question espagnole (extrait)
18 septembre 1936
L'élément nouveau en rapport avec la réalisation de la politique de front populaire est celui dont nous avons déjà parlé au VIIe Congrès.
André Seigneur, aout 1936
Voici plus de 20 ans, Lénine, le génial chef du prolétariat, et Camille Pelletan, un des chefs du radicalisme français, parlant des maux de notre peuple, indépendamment l'un de l'autre, aboutissaient à la dénonciation de quelques dizaines de familles toute puissantes qui défendent leurs intérêts particuliers aux dépens de ceux de l'écrasante majorité de notre peuple.
Ouvriers ! Paysans !
Antifascistes ! Espagnols patriotes !
Face au soulèvement militaire fasciste, tous debout ! Défendons la République ! Défendons les libertés populaires et les conquêtes démocratiques du peuple !...
Etienne Fajon, juin 1936
Au VIIè Congrès du Parti, en mars 1932, fut votée unanimement une résolution spéciale sur le travail théorique du Parti. Cette résolution invitait les régions et rayons à « accorder une attention soutenue au travail d'éducation, en intégrant ce travail dans l'ensemble de leurs tâches politiques ».
Pierre Donnier, juin 1936
Question -
Il paraît que la région normande vient de faire une expérience intéressante pour le Parti. Toi qui en reviens, voudrais-tu nous dire quelle était la situation là-bas au point de vue de nos directions et de nos cadres ?
Réponse -
Charles Roth, juin 1936
Nous assistons, au cours de cette dernière période, à une recrudescence d'activité des ligues factieuses, en particulier de l'armée des trusts du colonel de La Rocque dont les rassemblements se sont multipliés ; les raisons de cette activité sort dues à la crainte que leur inspirent les résultats du scrutin du 26 avril, pour lequel notre grand Parti communiste a engagé une vaste et puissante campagne.
En regard de cette activité, il nous a paru intéressant de fournir à nos camarades, au travers de cette étude quoique encore très incomplète, quelques renseignements sur la politique des Croix de feu qui est, comme écrit notre vénéré camarade Cachin : « Le gros de l'armée hitlérienne française »...
Charles Roth, avril 1936
La composition du Parti se modifie
Au 7 mars 1936, l'administration du Parti avait délivré 92.541 cartes ; l'année dernière, fin mars, nous en avions délivré 61.730. En 1934, fin mars, 43.208.
Jamais encore depuis 1914, la menace d'une guerre mondiale n'a été aussi grande qu'aujourd'hui.
Et jamais encore la nécessité n'a été aussi urgente de mobiliser toutes les forces pour détourner cette catastrophe, qui menace toute l'humanité. Mais, pour cela, il est nécessaire avant tout de comprendre clairement d'où vient le danger, quels en sont les agents, quels sont les pays qu'ils s'apprêtent à assaillir.
Il serait faux de croire que la guerre qui vient, menace seulement l'Union soviétique, ou du moins la menace en premier lieu. N'est-ce pas un fait que l'occupation de la zone rhénane, par l'armée de Hitler crée une menace directe pour la France, la Belgique et d'autres pays européens ?...
Les Croix de feu et leur stratégie
Ce n'est pas seulement au point de vue numérique et d'organisation que la ligue des Croix de feu est, de loin, la plus importante et la plus dangereuse pour la classe ouvrière. C'est aussi et surtout au point de vue social et idéologique.
Pierre Semard, février 1936
A la veille de la reconstitution de l'unité du mouvement syndical dans une seule C.G.T., il est utile de rappeler quelques pages de son histoire.
Notre mouvement ouvrier et son organisation sur le plan syndical est, en effet, extrêmement riche en expériences, en réalisations et en luttes contre le capitalisme.
José Diaz, Parti Communiste d'Espagne
Discours prononcé à Madrid, le 9 février 1936
La presse a pris une extension parallèle au développement du régime de capitaliste. Elle est devenue en France, comme dans les autres pays, une puissance considérable, arme de classe, bien entendu. On compte environ 3.000 journaux dans notre pays. La plupart dépendent des grandes organisations financières dont elles expriment la politique dans les différentes couches de la population.
Marcel Cachin, janvier 1936
Le VIIIè congrès du Parti attestera la puissance croissante du communisme français. Nous devrons surtout marquer ses progrès magnifiques en 1934 et 1935.
Depuis le jour du 6 février 1934, où le fascisme a tenté ici de se saisir du pouvoir par la force, l'élan a été donné.
Au VIIè congrès de l'Internationale communiste, Dimitrov – dont le nom est l'évocation du peuple dressé de toute sa puissance contre le fascisme – en termes clairs, indiqua que si par son activité le Secours Rouge International a « gagné l'amour, l'attachement et la profonde reconnaissance de centaines de milliers de prolétaires et d'éléments révolutionnaires, paysans, intellectuels », sa tâche se pose maintenant de se transformer en une véritable organisation de masse de travailleurs de tous les pays capitalistes, pour devenir une sorte de « Croix Rouge », englobant des millions d'hommes, de femmes, de jeunes .
A la veille du VIIIè congrès de notre Parti communiste français, je veux, par cette contribution, montrer comment les communistes doivent être les meilleurs, les plus fraternels, les plus affectueux parmi les membres du Secours Rouge en France...
Le VIIe congrès mondial de l'Internationale communiste, le congrès des communistes de tous les pays et de tous les continents du monde, termine ses travaux.
Quel en est le bilan, qu'est-ce que le congrès représente pour notre mouvement, pour la classe ouvrière mondiale, pour les travailleurs de tous les pays ?
Ce congrès a été le congrès du triomphe complet de l'unité entre le prolétariat de l'Union soviétique, - le pays où le socialisme a vaincu, - et le prolétariat du monde capitaliste en lutte pour son affranchissement. La victoire du socialisme dans l'Union soviétique, victoire qui intéresse l'histoire mondiale, provoque dans tous les pays capitalistes un puissant mouvement vers le socialisme...
LA VICTOIRE DU SOCIALISME EN U.R.S.S. ET SA PORTÉE HISTORIQUE MONDIALE
Résolution sur le rapport du camarade Manouilski, adoptée le 20 août 1935
LES TÂCHES DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE EN LIAISON AVEC LA PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE GUERRE MONDIALE PAR LES IMPÉRIALISTES
Résolution sur le rapport du camarade Ercoli, adoptée le 20 août 1935
L’OFFENSIVE DU FASCISME ET LES TÂCHES DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE DANS LA LUTTE POUR L’UNITÉ DE LA CLASSE OUVRIÈRE CONTRE LE FASCISME
Résolution sur le rapport du camarade Dimitrov, adoptée le 20 août 1935.
Georgi Dimitrov
Discours au 7e congrès de l'Internationale communiste à la séance de clôture: Congrès de large mobilisation des forces contre le fascisme et la guerre
20 aout 1935
Le VIIe congrès mondial de l'Internationale communiste, le congrès des communistes de tous les pays et de tous les continents du monde, termine ses travaux.
Le 25 juillet dernier s'est ouvert à Moscou, dans l'ancien Cercle de la Noblesse, le VIIème congrès de l'Internationale communiste.
Soixante-trois nations sont représentées dans ce congrès et cette représentation unique souligne le caractère d'universalité de notre Internationale, qui groupe les prolétaires des grands pays capitalistes et les exploités des colonies les plus lointaines.
Georgi Dimitrov
Discours au 7e congrès de l'Internationale communiste en conclusion aux débats après son rapport: Pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme
13 aout 1935
Maurice Thorez
Discours au 7e congrès de l'Internationale communiste: Les succès du front unique antifasciste
3 aout 1935
Georgi Dimitrov 2 aout 1935
Rapport au 7e congrès mondial de l'Internationale communiste: L'Offensive du fascisme et les tâches de l'Internationale communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme
Adoptée le 1er août 1935 sur le rapport du camarade Pieck.
1. Le VIIe Congrès mondial de l’I.C. approuve la ligne politique et l’activité pratique du C.E. de l’I.C.
7e congrès de l'Internationale communiste
Résolution sur le rapport d'activité du Comité exécutif de l'IC (Rapport de Wilhelm Pieck)
1er aout 1935
1. Le VIIe Congrès mondial de l'IC approuve la ligne politique et l'activité pratique du CE de l'IC.
Wilhelm Pieck
Rapport sur l'activité du Comité exécutif de l'IC au 7e congrès de l'Internationale communiste: Entre le 6e et le 7e congrès de l'Internationale communiste
26 juillet 1935
Camarades,
Les élections municipales et les élections au conseil général de la Seine ont marqué une avance importante de la classe ouvrière et un large développement du Front populaire, tant à la ville qu'à la campagne.
Les forces réactionnaires et fascistes, qui étaient parvenues à maintenir leurs positions lors des élections cantonales en octobre dernier, accusent un recul certain.
Le trait particulier du problème minier dans la région du Nord de la France consiste en ceci, que l'effectif minier se compose de plus de 50 % de mineurs polonais.
Dans certains puits, cet effectif est supérieur et atteint même 70 à 80 %.
Les mineurs polonais sont occupés surtout au travail du fond, à l'abattage, à l'accrochage et au boisage – travail déterminant dans les mines et, en même temps, le plus dur et le plus dangereux...
Maurice Thorez, mai 1935
Vous êtes venus des pays du Capital au pays, de la dictature du prolétariat, dans l'Union soviétique, qui est le premier, mais non pas le dernier Etat du prolétariat mondial.
Vous avez et vous aurez encore la possibilité de constater de vos propres yeux la prodigieuse différence entre la situation de la classe ouvrière dans les pays où dominent le Capital et le fascisme, et la situation ici, dans un pays où la classe ouvrière, après avoir vaincu la bourgeoisie, édifie victorieusement le socialisme sous la direction du glorieux le rempart de la paix entre les peuples. L'Etat soviétique est la citadelle de la révolution prolétarienne mondiale...
Nous ne nous lasserons pas de répéter que les communistes ne séparent pas leur lutte pour la libération définitive des travailleurs, de leur activité quotidienne pour l'amélioration immédiate des conditions de vie des classes laborieuses. Les communistes luttent en faveur des revendications immédiates des travailleurs, pour diminuer sans délai la misère de leur classe et parce que loin de s'opposer aux possibilités d'action pour la révolution, c'est le meilleur moyen de se lier aux masses et de les entraîner à des luttes plus décisives. C'est dans cet esprit que le Parti communiste participe de toutes ses forces aux élections municipales. La période électorale sera pour notre parti un excellent moyen d'accentuer le courant de masse contre le fascisme et la guerre, et de rallier les exploités à nos solutions révolutionnaires à la crise, mais nous interviendrons pour la conquête des municipalités par la classe ouvrière, sous la direction de notre Parti.
Le Parti communiste a son programme municipal, il aura partout où ce sera possible ses candidats et son programme local. Le programme local élaboré sur les bases du programme municipal général du Parti reproduira les revendications immédiates de la population laborieuse sur la base de chaque localité...
La situation actuelle, tant nationale qu'internationale nous montre que nous allons avec rapidité vers de nouveaux combats plus âpres et plus durs.
Notre Parti avec sa politique d'unité d'action du prolétariat a su, dans la dernière période attirer dans la lutte contre le fascisme des centaines de milliers de nouveaux combattants. Notre Parti a su acquérir la confiance des larges masses, car il a montré qu'il est le seul Parti capable de les conduire à la victoire.
Nous avons acquis cette confiance des masses grâce à notre politique juste en appliquant les directives de notre Internationale communiste et grâce aussi à l'activité de militants dévoués attachés à notre Parti et ayant confiance en lui...
février 1935
La campagne contre les ouvriers immigrés se poursuit, en premier lieu, sous le prétexte de la défense des intérêts des ouvriers français frappés par la crise.
On répète de tous les côtés le chiffre de 300.000 ouvriers étrangers en France et de 350.000 chômeurs. Il suffit donc d'expulser les 350.000 ouvriers étrangers, et le problème du chômage, sera résolu en France.
Voici un an que l' émeute fasciste de la Place de la Concorde, visant à instaurer en France un régime semblable à celui de Hitler, était refoulée par l'action des masses populaires réalisant leur front unique dans le combat.
Le Comité central du Parti communiste français adresse un vibrant salut bolchevik au camarade Staline, à l'occasion de son cinquante-cinquième anniversaire.
Nous saluons en Staline le meilleur disciple et le continuateur de Lénine, le chef du glorieux Parti bolchevik qui a assuré la victoire d'Octobre et le triomphe de l'édification du socialisme, le chef du prolétariat mondial, le chef des millions d'exploités du monde entier, qui veulent secouer le joug du capitalisme, battre le fascisme et se libérer par la révolution.
La vie du camarade Staline est un modèle de fermeté révolutionnaire, de fidélité et de dévouement à la cause des travailleurs...
La jeunesse participe activement au grand mouvement popu laire qui pousse les masses laborieuses de notre pays à s'unir contre l'offensive de la bourgeoisie, contre le fascisme et la guerre.
Tandis que les hitlériens français s'efforcent d'opposer les jeunes générations à leurs aînés, la partie la plus active de la jeunesse travailleuse a rejoint le front antifasciste et combattu, coude à coude, avec les travailleurs adultes.
Cette union s'est créée et élargie au cours de l'action menée en commun, depuis février, pour repousser l'offensive fasciste. Dans chaque meeting et manifestation antifasciste apparaissent, et quelquefois dominent, les visages jeunes...
Quels sont les premiers enseignements de la grande bataille d'octobre en Espagne et plus particulièrement de l'insurrection armée des Asturies ?
1. La classe ouvrière peut battre une armée moderne
II est possible dans des circonstances économiques et politiques bien déterminées, circonstances qui sont nettement précisées par notre Internationale, par l'énorme expérience du Parti bolchévik, par la tactique léniniste, il est possible – et les Asturies l'ont prouvé – que les ouvriers remportent la victoire sur une armée moderne...
Nous devons revenir sur la liste des mouvements, manifestations, protestations de masse contre les patrons et contre le fascisme que nous avons publié au cours des numéros de la présente revue. Elle contient une grande quantité d'éléments intéressants la situation italienne, que nous entendons mettre en lumière ici.
Le premier fait notable est l'abondance de mouvements, de manifestations et de protestations de masse dans les provinces habitées par les minorités slovènes et croates opprimées par l'impérialisme italien. L'indignation et la disposition à la lutte des masses laborieuses son dans cette province est plus grande qu'ailleurs, parce que le mécontentement de la misère, du chômage et des bas salaires s'unit au mécontentement dû aux provocations de l'oppression nationale de la politique de dénationalisation violente conduite par l'Etat italien, sous l'autorité fasciste...
Le congrès du Parti ouvrier se réunit en septembre 1898 à Montluçon. Sans doute il condamne le nationalisme et l'antisémitisme. Mais il ne donne aucune directive précise.
Et peut-être allait-il un peu vite en besogne quand il affirmait dans une résolution que l'antisémitisme « malgré toutes ses pétarades démagogiques n'a jamais pu faire illusion à une fraction quelconque de la classe ouvrière consciemment organisée ».
En fait les ouvriers étaient dans la rue, se battant contre la police et les nationalistes : le Parti ouvrier de Guesde ne les guidait plus.
Le mouvement de masse grandit, il se développe au milieu de l'agitation revendicative du prolétariat.
En octobre 1898 une grève importante éclate à Paris parmi les ouvriers du bâtiment. On compte plus de 20.000 grévistes. Contre eux le président du Conseil Brisson fait donner la troupe. (...) Tout se mêle étroitement : les cris de « Vive Dreyfus ! » et les cris qui expriment la volonté revendicative des gars du bâtiment...
Les batailles d'avant-postes du nouveau cycle de révolutions et de guerres viennent d'être livrées en France et en Autriche.
Le Parti socialiste de France est fondé depuis quatre mois. II donne déjà des signes non équivoques de dégénérescence et de décomposition.
C'est qu'il fut, dès sa naissance, soumis à l'épreuve du feu - nous voulons dire des combats de classe, - et qu'il en a sévèrement pâti.
Il s'était créé dans une confusion inouïe de doctrine, que seuls pouvaient ignorer les observateurs superficiels aux yeux desquels, pour un parti bourgeois, un congrès unanime est l'indice d'une unité politique profonde.
Le Congrès de la Mutualité avait donné ce spectacle de l'unanimité : elle n'a point survécu aux événements de cet hiver. Comment naquit le Parti « néo » ?...
Rappelons les faits.
Dès qu'en octobre 1918 l'effondrement du front turco-bulgare apporte la certitude de la défaite militaire du bloc impérialiste d'Europe centrale au bénéfice des impérialistes de l'Entente (France-Angleterre-Italie-japon), ceux-ci décident d' « en finir avec le bolchevisme », suivant l'expression du ministre français des Affaires étrangères, Pichon.
Une base est déjà créée à Arkhangelsk dans l'Extrême Nord. Les forces japonaises avancent en Sibérie et le général français, Janin, y dirige les forces militaires alliées, Russes-blancs com pris ; enfin le Kouban et le Don sont aux mains de Dénikine...
Les événements qui se sont déroulés en France au cours de ces dernières semaines, et particulièrement pendant la période du 5 au 12 février sont, à tous les points de vue, une confirmation éclatante des thèses du 13è Exécutif de l'I.C. Et en particulier, ils illustrent de façon saisissante la conclusion du Comité exécutif de l'Internationale qui fait un devoir à toutes les sections de l'internationale d'être prêtes à chaque tournant des événements et sans perdre un instant de tendre toutes leurs forces pour la préparation révolutionnaire du prolétariat en vue des prochaines batailles décisives pour le pouvoir.
L'énergie et l'ampleur de la riposte faite dans tout le pays par le prolétariat aux menées fascistes, la combativité admirable des ouvriers parisiens luttant pendant des heures contre la police, élevant des barricades pour résister aux charges ; les multiples exemples d'initiative donnés par les organisations du Parti au cours de ces journées pour mobiliser les masses et les entraîner à l'action, montrent éloquemment les énormes possibilités qui nous sont actuellement données pour développer l'action de masse contre la bourgeoisie et ses bandes policières ou fascistes...
– Une pareille campagne, née d'une cause internationale, est presque sans précèdent : quelle en est, selon vous, l'explication ?
– Cette solidarité démontre, je le pense, qu'on ne s'est pas seulement intéressé à la personne des accusés.
Cet intérêt considérable qu'ont manifesté les ouvriers, et aussi d'autres couches sociales, exprimait leur satisfaction devant notre combat contre le fascisme allemand et la volonté d'y prendre une part active...
Les événements de ces dernières semaines vérifient dans les faits la justesse des résolutions adoptées par la XIIIe assemblée plénière du Comité exécutif de l'I.C. Et par le Comité central dans sa session de janvier.
Les événements de cette dernière période soulignent l'accentua tion de l'essor révolutionnaire dans les pays capitalistes (Au triche-Espagne, etc.).
En face du monde capitaliste en pleine crise, l'Union soviétique obtient de nouvelles victoires dans l'édification du socialisme. « Le mouvement des masses ouvrières et paysannes et des sol dats est en développement et passe à un niveau plus élevé », comme l'ont montré les combats de classe de février en France. L'activité du Parti communiste a largement contribué à déclen cher l'action des masses travailleuses qui, jeunes en tête, ont ri posté magnifiquement aux attaques du fascisme, notamment dans la grande manifestation du 9 février ; elles ont réalisé leur front unique d'action auquel s'est toujours opposé le Parti socialiste...
Les éléments les plus réactionnaires et les plus sinistres de l'Autriche, la clique vénale qui ne pense qu'au râtelier étranger où elle pourrait manger le mieux, réunie par un seul sentiment - la haine contre le prolétariat – fête sa « victoire ».
Tous les débris du corps d'officiers impérial enragés par l'effon drement de l'empire des Habsbourg, tous les déchets de la bu reaucratie impériale ayant perdu complètement le sens de la réalité, et avec eux la grande bourgeoisie autrichienne, tous les épigones et avortons dont le « courage » n'a pu être rétabli que par le soutien de koulaks et de la paysannerie montagnarde d'Autriche trompée par les fascistes, ils ont tous voulu montrer au monde leurs exploits.
Ces héros s'avéraient incapables d'insuffler la vie à l'organisme mort-né créé à Versailles ; ils se vendaient aussi bien au pape qu'aux financiers, ils mendiaient honteusement auprès de la So ciété des nations et ses banquiers, ils se prostituaient dans toutes les antichambres de gouvernements européens ; ils se transformèrent depuis longtemps moralement et matériellement en loques...
Le marxisme exige que le travail théorique soit lié au travail pratique.
Essayer de faire des cadres rien que par le travail pratique sans leur donner les connaissances théoriques nécessaires cela veut dire préparer des dirigeants aveugles.
Mais l'aveugle ne va pas loin sans se casser la tête. Le problème de l'éducation de l'ensemble des membres du parti et la formation de cadres se pose actuellement devant le parti comme une nécessité vitale...
La région du Nord et du Pas-de-Calais occupe une place pré pondérante dans l'économie française. Des centaines de milliers d'ouvriers s'y trouvent concentrées. Avant la crise, la mine occupait 200.000 travailleurs. L'industrie textile 250.000 rien que dans Ie secteur le plus important Lille-Roubaix-Tourcoing-Halluin-Armentières. 60.000 métallurgistes environ étaient employés dans les sec teurs de Valenciennes et Lille.
Parmi cette main-d'œuvre se trouvaient et se trouvent encore de nombreux ouvriers immigrés et frontaliers belges.
Ces derniers venant chaque jour des localités belges sur tout le long de la frontière du département du Nord ont atteint jusqu'à 50.000...
Ce que nous devons dire d'abord, c'est la reconnaissance sans bornes que nous éprouvons pour le prolétariat international, pour les couches les plus larges de travailleurs de tous les pays, pour les intellectuels loyaux qui ont lutté en faveur de notre libération.
Et nos chaleureux remerciements, avant tout, aux ouvriers et aux kolkhoziens du pays soviétique, de notre pays...
Les événements qui viennent de se dérouler en France illustrent de la manière la plus éclatante les thèses de la XIIè Assemblée plénière de l'Internationale Communiste soulignant que « s'accroît toujours plus l'indignation révolutionnaire des masses laborieuses et leur volonté de renverser le joug insupportable de classes exploiteuses ».
« Le Parti doit concentrer l'attention la plus vigilante sur la fraction Blum-Faure-Zyromski-Pivert. Cette fraction est l'instrument le plus efficace de la bourgeoisie pour tromper et trahir les ouvriers. Elle est l'obstacle principal à la réalisation de l'unité d'action du prolétariat contre la classe bourgeoise.
Il est particulièrement nécessaire de démasquer devant les masses la tentative de cette fraction de se présenter sous l'au réole de redresseur de gauche du Parti socialiste ».
Le camarade Havez, dans son article sur le problème du renforcement idéologique du Parti traite une question qui tourmente maintes cellules et plus d'un rayon : Les moyens de retenir les nouveaux membres du Parti.
Mais il n'est pas douteux que le souci de retenir les nouveaux adhérents n'est qu'un aspect particulier du problème de parer aux flottements des effectifs de notre parti, problème qui lui-même est étroitement lié à la question de la formation des cadres. Il ne peut y avoir de solution sérieuse à la question posée par le camarade Havez, sans une solution du problème de l'arrêt de la fluctuation...
Une des questions que notre parti doit étudier d'une façon particulière est la question de l'autodéfense prolétarienne. Plusieurs articles ont paru dans les Cahiers du bolchévisme sur cette question ; nous voulons aujourd'hui apporter notre point de vue.
Ce qui a été fait .
Jusqu'ici le fascisme a réussi à faire prévaloir son influence au sein des masses laborieuses italiennes et au sein même du prolétariat industriel. Ce problème s'est posé un certain nombre de fois à notre Parti, mais nous n'avons pas toujours été en mesure de lui apporter une réponse appropriée.
C'est une erreur que d'exclure que le fascisme puisse influencer une partie des masses laborieuses. Cette erreur est due au sectarisme et dénote d'une séparation avec les masses. Celle ci provient du fait que nous attribuons aux larges masses les positions, les convictions, les mouvements et les tendances qui existent uniquement dans la partie la plus avancée des masses...
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Durant la période écoulée depuis la Xe session plénière, le P.C.A. a fait un grand progrès dans la lutte pour la conquête de la majorité de la classe ouvrière, pour la consolidation organique de son influence politique dans les masses.
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Présidium Elargi du Comité Executif de l'Internationale Communiste
25 Février 1930
Résolution de la X° session plénière du C.E. de l'I.C.
Après avoir pris connaissance de la décision de la session plénière du 23 avril du C.C. et de la C.C.C. du P.C. d'U.S. relevant le camarade Boukharine de ses fonctions à l'I.C., la séance plénière du C.E. de l'I.C. constate ce qui suit :
§ 1. L'Internationale communiste, association internationale des travailleurs, est l'organisation des Partis communistes des différents pays en un Parti communiste unique mondial. Guide et organisateur du mouvement révolutionnaire mondial du prolétariat, champion des principes et des buts du communisme, l'Internationale communiste lutte pour la conquête de la majorité de la classe ouvrière et des grandes couches de paysans pauvres, pour les principes et les buts du communisme, pour l'instauration de la dictature mondiale du prolétariat, por la création d'une Fédération mondiale des Républiques socialistes soviétiques, pour l'abolition complète des classes et la réalisation du socialisme, première étape de la société communiste.
§ 2. Les Partis adhérant à l'Internationale communiste portent le nom de : 'Parti communiste de ... (Section de l'Internationale communiste'.) Dans chaque pays, il ne peut exister qu'u seul Parti adhérant comme section à l'Internationale communiste.
Programme de l'Internationale communiste (Adopté par le VIe Congrès mondial - le 1er septembre 1928 à Moscou)
L'époque de l'impérialisme est celle du capitalisme mourant. La guerre mondiale de 1914-1918 et la crise générale du capitalisme qu'elle a déchaînée furent le résultat d'une profonde contradiction entre le développement des forces productives de l'économie mondiale et les frontières des États.
Lors de nos récentes campagnes, il apparaît que nos cellules d'entreprises n'ont pas pris une part active à la préparation de ces campagnes.
Certains échos, d'autre part, nous indiquent que dans notre Parti, un grand nombre de camarades délaissent leurs cellules d'entreprises pour se réfugier sur leur lieu d'habitation et qu'en général, nos cellules n'ont pas suffisamment d'activité.
Nous sommes en face d'une situation économique et politique tout à fait favorable pour montrer à nos camarades du Parti l'importance de l'organisation sur la base de la production et leur rappeler que cette structure est le résultat de l'expérience acquise par les nombreuses années de lutte du parti bolcheviste et des différentes sections de l'Internationale Communiste...
[1926]
Le Parti communiste français dans la situation actuelle a la tâche immense de mobiliser les masses pour les luttes de défense contre la vie chère, l'insuffisance des salaires, les impôts insupportables, les guerres “coloniales, les menées réactionnaires, etc.
La crise grandissante de la bourgeoisie française lui imposera dans un avenir prochain des tâches plus grandes encore.
Notre Parti est né en janvier 1921, au moment le plus critique de la crise générale de la bourgeoisie italienne et de la crise du mouvement ouvrier. Si la scission était historiquement nécessaire et inévitable, les grandes masses, hésitantes, n'y étaient pas préparées. Dans cette situation, l'organisation matérielle du nouveau Parti a dû se faire dans des conditions extrêmement difficiles.
Le travail organisationnel a ainsi absorbé, à lui seul, la quasi-totalité des énergies créatrices...
XIV. La défaite du prolétariat révolutionnaire dans cette période décisive est due aux déficiences politiques, organisationnelles, tactiques et stratégiques du parti des travailleurs. En raison de ces déficiences, le prolétariat ne parvient pas à prendre la tête de l'insurrection de la majorité de la population, et à la faire déboucher sur la création d'un État ouvrier ; bien au contraire, il subit lui-même l'influence des autres classes sociales qui paralysent son action.
La victoire du fascisme en 1926 doit donc être considérée non comme une victoire remportée sur la révolution mais comme la conséquence de la défaite subie par les forces révolutionnaires en raison de leurs faiblesses intrinsèques...
En commémorant, devant une assemblée de communistes, le Congrès de l'Internationale, un militant du nationalisme allemand fusillé dans la Ruhr par les nationalistes français, le camarade Radek a employé une formule incisive qui nous revient à l'esprit chaque fois que nous pensons au destin de Giacomo Matteotti.
« Le pèlerin du néant » : c'est ainsi que Radek a désigné le combattant malheureux, mais tenace jusqu'au sacrifice de soi, défenseur d'une idée qui ne peut conduire ses fidèles et ses militants à autre chose qu'un inutile cercle vicieux de luttes, d'agitations, de sacrifices sans résultat et sans issue. Un « pèlerin du néant », c'est ainsi que nous apparaît Giacomo Matteotti lorsque nous confrontons sa vie et sa fin à toutes les circonstances qui leur confèrent une valeur, non plus « personnelle », mais d'exemple universel et de symbole...
Le Vatican est sans doute la plus vaste et la plus puissante organisation privée qui ait jamais existé au monde. Il a, par certains aspects, le caractère d’un État, il est reconnu comme tel par nombre de gouvernements. Quoique le démembrement de la monarchie austro-hongroise ait considérablement diminué son influence, il n’en demeure pas moins une des forces politiques les plus efficientes de l’histoire moderne. La base d’organisation du Vatican est en Italie. C’est là que résident les organes dirigeants des organisations catholiques dont le réseau complexe s’étend sur une grande partie du globe.
L’appareil ecclésiastique du Vatican se, compose, en Italie, d’environ 200 000 personnes, ce chiffre est imposant, surtout si l’on pense qu’il comprend des milliers et des milliers de personnes, supérieures par leur intelligence, leur culture, leur habileté, consommée dans l’art de l’intrigue et dans la préparation et la conduite méthodique et silencieuse des desseins politiques. Beaucoup de ces hommes incarnent les plus vieilles traditions d’organisation de masses et de propagande que l’histoire connaisse...
À une conférence des chefs de l'industrie italienne et des principaux dirigeants du syndicalisme fasciste tenue le 19 décembre, à Rome, sous les auspices et en présence du Président du conseil Mussolini, il a été formellement reconnu que le programme et les méthodes du fascisme, dans le domaine syndical, ont fait complètement faillite.
On se rappelle les tentatives acharnées du fascisme, avant et après son avènement au pouvoir, de créer un mouvement syndical à son service. On se rappelle également que ces tentatives, pour avoir donné des résultats relativement favorables parmi les travailleurs des campagnes, ont complètement échoué en ce qui concerne les ouvriers industriels. Il a été facile aux fascistes, vu les conditions de vie et de travail des paysans pauvres et des journaliers, dispersés dans les villages et seulement unis par de faibles liens syndicaux, de détruire les organisations socialistes des travailleurs agricoles et de contraindre, par la terreur et le boycottage économique, les masses laborieuses de la campagne d'entrer dans les corporations fascistes...
Dans le récent discours prononcé à la Chambre pour arracher l'approbation de la nouvelle loi électorale, Mussolini a encore une fois répété avec ostentation la critique de la démocratie parlementaire, allant jusqu'à se battre contre les pauvres ombres de Cavallotti et de Brofferio. Et il a fait appel à l'argument, guère nouveau, selon lequel les adversaires les plus radicaux du fascisme sont anti-démocrates et anti-parlementaires et selon lequel en Russie les garanties démocratiques sont abolies pour tous les partis opposés au régime bolchevik.
Il est vrai qu'il y a une espèce de convergence, sur cette question, des points de vue des deux groupes politiques extrêmes. Mais l'argument ne s'adresse qu'à une bien petite partie des opposants du fascisme – les communistes – puisque les autres partis socialistes sont, dans leurs divers comportements théoriques, à la fois imbibés et avides de parlementarisme; quant aux syndicalistes-révolutionnaires et aux anarchistes, a-parlementaires il est vrai, ils s'opposent eux à toutes les dictatures...
Pendant et après la guerre, il s'est développé parmi les peuples coloniaux et semi-coloniaux, un mouvement de révolte contre le pouvoir du capital mondial, mouvement qui fait de grands progrès. La pénétration et la colonisation intense des régions habitées par des races noires pose le dernier grand problème dont dépend le développement futur du capitalisme.
Le 4° Congrès de l'Internationale Communiste proteste énergiquement contre l'exécution de cinq révolutionnaires nationalistes, qui eut lieu les 17 et 25 novembre, sur l'ordre de l'Etat Libre d'Irlande. Il attire l'attention de tous les travailleurs du monde sur cet acte sauvage qui couronne la terreur féroce sévissant en Irlande.
Se fondant sur l'expérience de l'édification soviétique en Orient et sur la croissance des mouvements nationalistes révolutionnaires aux colonies, le 2° Congrès de l'Internationale Communiste a fixé la position principale de l'ensemble de la question nationale et coloniale à une époque de lutte à longue échéance entre l'impérialisme et la dictature prolétarienne.
1. Le rapport des délégués du Parti Socialiste d'Egypte, soumis à la commission, a prouvé que ce parti représente un sérieux mouvement révolutionnaire, conforme au mouvement général de l'Internationale Communiste.
2. La commission considère cependant que l'affiliation du Parti Socialiste d'Egypte doit être ajournée jusqu'à ce qu'il ait :
exclu certains éléments indésirables ;
Le Parti Communiste yougoslave a été constitué par les organisations de l'ex-parti social-démocrate dans les provinces qui forment actuellement la Yougoslavie ; sa création a été le résultat de l'exclusion des éléments de droite et du centre et de l'adhésion à l'Internationale Communiste au Congrès de Boukovar en 1920.
1. Le Parti Communiste espagnol qui, à la séance de l'Exécutif élargi de février, vota avec la France et l'Italie contre la tactique du front unique, ne tarda pas à reconnaître son erreur et, dès le mois de mai, à l'occasion de la grande grève des aciéries, il expliqua, non par discipline formelle mais avec compréhension, conviction et intelligence, la tactique du front unique.
Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, le Congrès décide :
Les 2° et 3° Congrès de l'Internationale Communiste se sont déjà occupés en détail de la question italienne. Le 4° Congrès est donc en mesure de tirer certaines conclusions.
Vers la fin de la guerre impérialiste mondiale, la situation en Italie était objectivement révolutionnaire.
La tâche la plus pressante du Parti est d'organiser la résistance du prolétariat à l'offensive du Capital, qui se déploie en France comme dans les autres grands Etat industriels.
La défense de la journée de huit heures, la conservation et l'augmentation des salaires acquis, la lutte pour toutes les revendications économiques journalières constituent la meilleure plate-forme pour rassembler le prolétariat dispersé, lui rendre la confiance en sa force et en son avenir.
La guerre mondiale s'est terminée par l'écroulement de trois puissances impérialistes : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Quatre grands rapaces sont sortis victorieux de la lutte : les Etats-Unis, l'Angleterre, la France et le Japon.
Indications pour l'application des thèses du 2° Congrès sur la question agraire
Les bases de nos rapports vis-à-vis des masses laborieuses de la campagne ont déjà été fixées dans les thèses agraires du 2° Congrès. Dans la phase actuelle de l'offensive du Capital, la question agraire acquiert une importance primordiale.
Le 4° Congrès demande à tous les partis de s'efforcer de gagner les masses laborieuses de la campagne et établit pour ce travail les règles suivantes :
Le 2° Congrès mondial de l'Internationale des Jeunesses Communistes a décidé, d'accord avec les résolutions du 3° Congrès de l'I.C., de subordonner au point de vue politique les Jeunesses Communistes aux Partis Communistes.
L'organisation d'un travail d'éducation marxiste est une tâche indispensable de tous les partis communistes. Le but de ce travail d'éducation est l'élévation du niveau intellectuel et des capacités de lutte et d'organisation des membres et fonctionnaires des partis. Parallèlement à l'éducation marxiste générale, les fonctionnaires du parti devront recevoir l'éducation qui leur est nécessaire dans leur spécialité.
Le 4° Congrès mondial de l'Internationale Communiste approuve l'activité du Secrétariat féminin international de Berlin. Le Secrétariat féminin a fait en sorte que dans tous les pays ayant un mouvement révolutionnaire, les femmes communistes adhèrent aux sections de l'Internationale Communiste, soient éduquées, et attirées par les travaux et les luttes du Parti. En outre, le Secrétariat a répandu l'agitation et la propagande communiste dans les grandes masses féminines, et a mis ces dernières en mouvement pour les intérêts des masses laborieuses.
Durant les dernières années qui précédèrent la guerre mondiale et encore plus durant cette guerre, la Coopération a pris dans presque tous les pays un essor puissant et a entraîné dans ses rangs de larges masses d'ouvriers et de paysans. L'offensive presque universelle engagée par le capital oblige les ouvriers, et surtout les ouvrières, à apprécier encore davantage l'aide que peut leur apporter la coopération de consommation.
Cinq ans de révolution russe et les perspectives de la révolution mondiale
Rapport présenté au IVe congrès de l'Internationale Communiste, le 13 novembre 1922
(L'apparition du camarade Lénine est saluée par de vifs applaudissements prolongés et les ovations de toute l'assistance. Toute la salle se lève et chante l'« Internationale ».)
Camarades,
L'offensive du capitalisme dans tous les pays bourgeois a pour résultat d'augmenter le nombre des communistes et des ouvriers sans parti, luttant contre le capitalisme, et qui gémissent dans les cachots.
Le 4° Congrès demande à tous les partis communistes de créer une organisation qui aura pour but d'aider matériellement et moralement tous les prisonniers du capitalisme, et salue l'initiative de l'association des vieux bolchéviks russes qui a commencé la création d'une association Internationale de ces organisations de secours.
1. Les ouvriers de tous les pays, sans distinction d'opinions politiques ou syndicales sont intéressés au maintien et à la consolidation de la Russie soviétique. Outre le sentiment profondément enraciné de solidarité prolétarienne, la conscience de cet intérêt avant tout a déterminé tous les partis et organisations ouvrières à appuyer l'action de secours aux affamés de Russie et a décidé des millions de travailleurs de tous les pays à faire avec enthousiasme les plus grands sacrifices.
Le 4° Congrès mondial de l'Internationale Communiste exprime au peuple travailleur de la Russie des Soviets ses remerciements les plus profonds et son admiration sans bornes pour avoir, non seulement conquis le pouvoir au moyen de la lutte révolutionnaire et établi la dictature du prolétariat, mais pour avoir su défendre victorieusement jusqu'à aujourd'hui contre tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur les conquêtes de la révolution. Il a ainsi rendu des services immortels à la libération des opprimés et des exploités de tous les pays.
Un nombreux essaim d’abeilles habitait une ruche spacieuse. Là, dans une heureuse abondance, elles vivaient tranquilles. Ces mouches, célèbres par leurs lois, ne l’étaient pas moins par le succès de leurs armes, et par la manière dont elles se multipliaient. Leur domicile était un séminaire parfait de science et d’industrie. Jamais abeilles ne vécurent sous un plus sage gouvernement : cependant, jamais il n’y en eut de plus inconstantes et de moins satisfaites. Elles n’étaient, ni les malheureuses esclaves d’une dure tyrannie, ni exposées aux cruels désordres de la féroce démocratie. Elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient errer, parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois.
Ces insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l’armée ou au barreau, vivaient parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu’en petit, toutes leurs actions...
Tous les projets de programme seront transmis au Comité Exécutif de l'Internationale Communiste ou à une Commission désignée à cet effet, pour être étudiés et élaborés en détail. L'Exécutif est tenu de publier dans le plus bref délai tous les projets de programme qui lui parviennent.
Le mouvement international traverse en ce moment une période de transition qui pose devant l'Internationale Communiste et devant ses sections de nouveaux et importants problèmes tactiques.
Le 4° Congrès constate avant tout que les résolutions du 3° Congrès mondial :
sur la crise économique mondiale et les tâches de l'I.C. ;
sur la tactique de l'I.C. ;
ont été complètement confirmées par le cours des événements et le développement du mouvement ouvrier dans l'intervalle entre les 3° et 4° Congrès.
Le 4° Congrès de l'Internationale Communiste approuve complètement le travail politique du Comité Exécutif et déclare qu'au cours des quinze derniers mois, il a bien appliqué les décisions du 3° Congrès Mondial, en tenant compte de la situation politique.
En particulier, le 4° Congrès approuve complètement la tactique du front unique, telle qu'elle a été formulée par le Comité Exécutif dans ses thèses de décembre 1921 et ultérieurement.
Au IVe Congrès mondial de l'Internationale Communiste, au Soviet des député des ouvriers et des soldats rouges de Pétrograd
Je regrette très vivement de ne pouvoir assister à la première séance du Congrès et de devoir me limiter à un message écrit.
Pour la convocation immédiate d'un congrès international
La délégation de l'Exécutif de l'Internationale Communiste au Comité des Neuf (composé des camarades Karl Radek, Clara Zetkin et L.-O. Frossard adresse le manifeste suivant aux ouvriers et aux ouvrières de tous les pays :
OUVRIERS ET OUVRIERES !
TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS !
Le 1er mai 1922, les exploités de toute la terre manifesteront leur volonté d'émancipation dans une phase particulièrement intense de te lutte des classes.
L’emploi de certains termes dans l’exposition des problèmes du communisme engendre bien souvent des équivoques du fait des sens différents qu’on peut leur donner. C’est le cas des mots démocratie et démocratique. Dans ses affirmations de principe, le communisme marxiste se présente comme une critique et une négation de la démocratie; d’autre part les communistes défendent souvent le caractère démocratique, l’application de la démocratie au sein des organisations prolétariennes : système étatique des conseils ouvriers, syndicats, parti.
Il n’y a évidemment là aucune contradiction, et rien qu’on puisse opposer à l’emploi du dilemme : démocratie bourgeoise ou démocratie prolétarienne, en tant que parfait équivalent de la formule : démocratie bourgeoise ou dictature prolétarienne...
Les présentes thèses ont pour objet le problème général des critères auxquels le Parti communiste doit obéir dans son action pour réaliser son programme et atteindre son but, de la méthode qu'il doit suivre pour déterminer les initiatives à prendre et la direction à donner à ses mouvements.
Dans les différentes sphères de l'action du Parti (question parlementaire, syndicale, agraire, militaire, nationale et coloniale, etc.), ce problème revêt des aspects particuliers, qui ne seront pas traités ici séparément car ils font l'objet d'autres discussions et résolutions des congrès internationaux et nationaux...
Les Comités Exécutifs de l'Internationale Communiste et de l'Internationale des Syndicats Rouges, après avoir étudié au cours de trois séances la situation mondiale et celle du prolétariat international, ont acquis la conviction que les circonstances présentes rendaient nécessaires la concentration de toutes les forces du prolétariat mondial et la formation sur un front unique de tous les partis qui ont leur appui dans la classe ouvrière, sans égards aux divergences qui les séparent, pourvu qu'ils soient tous animés du désir de combattre pour les revendications les plus p
Le mouvement ouvrier international vit actuellement dans une étape transitoire particulière qui pose devant l'Internationale Communiste dans son entier et devant ses diverses sections de nouveaux problèmes de tactique importants.
Chers camarades,
L'Internationale Communiste adresse à sa section française réunie en Congrès un salut fraternel.
Il y a un an qu'à Tours vous avez fait un grand effort pour liquider le « socialisme » de guerre, pour vous dégager de l'équivoque du réformisme, en adhérant a l'Internationale Communiste.
En même temps que le manifeste du parti, le quotidien fasciste a publié un article destiné (ainsi qu'une série d'autres) à défendre le mouvement contre l'accusation de n'avoir ni programme ni idéologie ni doctrine qui a été portée de toutes parts contre lui.
Le leader fasciste répond à ce chœur de reproches avec une certaine irritation: Vous réclamez de nous un programme ? Vous le réclamez de moi ? Il ne vous semble pas que j'ai réussi à le formuler dans mon discours de Rome ? et il trouve une parade non dépourvue de valeur polémique : les mouvements politiques qui disent avoir été déçus dans leur attente auraient-ils donc eux-mêmes un programme ?...
Le mouvement fasciste a apporté à son congrès [de trois jours à Rome, en 1921, marqué par une grève générale antifasciste d'une semaine] durant le bagage d'une puissante organisation, et tout en se proposant de déployer spectaculairement ses forces dans la capitale, il a également voulu jeter les bases de son idéologie et de son programme sous les yeux du public, ses dirigeants s'étant imaginés qu'ils avaient le devoir de donner à une organisation aussi développée la justification d'une doctrine et d'une politique "nouvelles".
L'échec que le fascisme a essuyé avec la grève romaine n'est encore rien à côté de la faillite qui ressort des résultats du congrès en ce qui concerne cette dernière prétention. Il est évident que l'explication et, si l'on veut, la justification du fascisme ne se trouvent pas dans ces constructions programmatiques qui se veulent nouvelles, mais qui se réduisent à zéro aussi bien en tant qu'œuvre collective qu'en tant que tentative personnelle d'un chef: infailliblement destiné à la carrière d'"un homme politique" au sens le plus traditionnel du mot, celui-ci ne sera jamais un "maître"...
Dans la résolution du 3e Congrès mondial de l'Internationale Communiste, résolution relative à la question d'organisation, un chapitre spécial traite de la question de nos journaux communistes. Dans la présente circulaire, le Comité Exécutif se donne pour tâche de compléter cette résolution.
La crise du fascisme, dont les origines et les causes font couler tant d'encre ces jours-ci, est facilement explicable par un sérieux examen du développement du mouvement fasciste.
Les Fasci de combat, nés au lendemain de la guerre, étaient marqués de ce caractère petit-bourgeois propre aux diverses associations d'anciens combattants qui se sont créées à l'époque. Par leur caractère d'opposition radicale au mouvement socialiste, opposition en partie héritée des luttes du temps de guerre entre le Parti socialiste et les associations interventionnistes, les Fasci obtinrent l'appui des capitalistes et celui des autorités...
La Russie des Soviets vient d'être frappée comme en l'année 1891, par une catastrophe due à des phénomènes naturels.
Une grande sécheresse, qui a persisté du mois de mars au mois de juin, a provoqué la famine et la détresse dans les gouvernements de la Volga qui, jusqu'ici, produisaient 30 % de toute la récolte russe. On craint même de manquer de semences, pour les prochaines semailles. VINGT MILLIONS D'ÊTRES HUMAINS SONT MENACÉS DE MOURIR D'INANITION.
Le 3° Congrès de l'Internationale Communiste est terminé, la grande revue du prolétariat communiste de tous les pays est finie.
Xe CONGRÈS DU P.C. (b)R.
RAPPORT SUR LA SUBSTITUTION DE L'IMPÔT EN NATURE AUX RÉQUISITIONS
15 mars 1921
Programme du Parti communiste d'Italie
Dans l'actuel régime capitaliste se développe un contraste toujours plus important entre les forces productives et les rapports de production, donnant naissance à l'antithèse des intérêts et à la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie dominante.
Les actuels rapports de production sont protégés par le pouvoir de l'État bourgeois, qui créé sur le système représentatif de la démocratie, constitue l'organe pour la défense des intérêts de la classe capitaliste.
Un des membres de la délégation italienne qui vient de rentrer de Russie soviétique a appris aux travailleurs de Turin que sur la tribune dressée à Kronstadt pour accueillir la délégation on pouvait lire l'inscription suivante :
C'est une nouvelle que les ouvriers ont apprise avec beaucoup de plaisir et avec une profonde satisfaction. La plupart des membres de la délégation italienne en Russie avaient été opposés à la grève générale d'avril. Ils soutenaient dans leurs articles contre la grève que les ouvriers turinois avaient été victimes d'une illusion et qu'ils avaient surestimé l'importance de leur grève...
Conférence de la province de Moscou du PC(b)R
21 novembre 1920
(Applaudissements) Camarades !
La crise qui depuis longtemps tourmente notre parti, sur laquelle votre attention a, été fréquemment appelée, soit à la suite des récents événements en Italie, soit par suite des délibérations du second Congrès de la 3e Internationale, rend nécessaire et urgent, à l'approche du Congrès du Parti, un effort harmonieux des éléments de gauche du parti pour sortir enfin d'une situation intolérable et qui contraste avec les exigences de la lutte révolutionnaire du prolétariat italien.
Tout cela nous a induits à prendre l'initiative d'un mouvement de préparation au Congrès dans le but d'arriver à une entente harmonieuse entre tous ces camarades qui sentent vraiment la nécessité que le Congrès indique une solution définitive et énergique du vaste problème...
Document du "Parti Communiste français" de 1919.
L'attitude de la IIIe Internationale envers le parlementarisme n'est pas déterminée par une nouvelle doctrine, mais par la modification du rôle du parlementarisme même.
Les tâches dans les campagnes.
LE MOUVEMENT SYNDICAL, LES COMITÉS DE FABRIQUE ET D’USINES
I
Le prolétariat mondial est à la veille d'une lutte décisive...
Lénine traite de la question du rapport du Parti Communiste de Grande-Bretagne avec le Labour Party.
"Dans tous les pays capitalistes, il y a des éléments arriérés de la classe ouvrière, qui sont convaincus que le Parlement est la véritable représentation du peuple et qui ne voient pas les procédés malpropres auxquels on y a recours."
Lénine expose son point de vue concernant les conditions d'admissions au komintern comme nécessaire rupture avec l'opportunisme.
Le Parlement est la forme de représentation politique propre au régime capitaliste. La critique de principe que font les communistes marxistes du parlementarisme et de la démocratie bourgeoise en général démontre que le droit de vote ne peut empêcher que tout l’appareil gouvernemental de l’Etat ne constitue le comité de défense des intérêts de la classe capitaliste dominante. En outre, bien que ce droit soit accordé à tous les citoyens de toutes les classes sociales dans les élections aux organes représentatifs de l’Etat, ce dernier ne s’en organise pas moins en instrument historique de la lutte bourgeoise contre la révolution prolétarienne.
Les communistes nient carrément que la classe ouvrière puissent conquérir le pouvoir en obtenant la majorité parlementaire. Seule la lutte révolutionnaire armée lui permettra d’atteindre ses objectifs. La conquête du pouvoir par le prolétariat, point de départ de l’œuvre de construction économique communiste, implique la suppression violente et immédiate des organes démocratiques qui seront remplacés par les organes du pouvoir prolétarien : les Conseils ouvriers...
Lénine expose les principes du matérialisme historique par rapport aux tâches dans les colonies.
Le point de vue de Lénine sur le rôle du Parti Communiste, exprimé lors du second congrès de l'Internationale Communiste en 1920.
L'objectif: la dictature du prolétariat.
"Il n'y a sur la terre qu'un seul drapeau qui mérite que l'on combatte et qu'on meure sous ses plis, c'est le drapeau de l'Internationale Communiste !"
Lénine évalue la situation au début du second congrès de l'Internationale Communiste.
Les fameuses "21 conditions".
"La IIIe Internationale Communiste, fondée en mars 1919, dans la capitale de la République Socialiste Fédérative des Soviets, à Moscou, a déclaré solennellement à la face du monde qu'elle se chargeait de poursuivre et d'achever la grande œuvre entreprise par la Première Internationale des Travailleurs."
"La façon abstraite ou formelle de poser la question de l'égalité en général, y compris l'égalité nationale, est inhérente à la démocratie bourgeoise de par sa nature."
La révolution prolétarienne n'est pas l'acte arbitraire d'une organisation qui s'affirme révolutionnaire ou d'un système d'organisations qui s'affirment révolutionnaires. La Révolution prolétarienne est un processus historique très long qui s'incarne dans le surgissement et le développement de forces productives déterminées (que nous résumons dans l'expression – prolétariat –) dans un contexte historique déterminé (que nous résumons dans les expressions "mode de propriété individuelle, mode de production capitaliste, système de la fabrique, mode d'organisation de la société dans l'État démocratico-parlementaire").
Dans une phase déterminée de ce processus, les forces productives nouvelles ne peuvent plus se développer et s'organiser de façon autonome dans les schémas officiels dans lesquels se déroule la vie collective : dans cette phase déterminée intervient l'acte révolutionnaire qui consiste à briser violemment ces schémas, à détruire tout l'appareil du pouvoir économique et politique, dans lequel les forces productives révolutionnaires sont opprimées, c'est-à-dire à anéantir la machine de l'État bourgeois pour constituer un type d'État dans lequel les forces productives libérées trouvent la forme adéquate à leur développement ultérieur et l'organisation nécessaire et suffisante pour la suppression de leurs adversaires...
Message de salutation à l'Association révolutionnaire indienne en 1920.
Pendant les premiers mois qui suivirent la conquête du pouvoir politique par le prolétariat en Russie (25 octobre - 7 novembre 1917), il pouvait sembler que les différences très marquées entre ce pays arriéré et les pays avancés d'Europe occidentale y rendraient la révolution du prolétariat très différentes de la nôtre.
Aujourd'hui nous avons par devers nous une expérience internationale fort appréciable, qui atteste de toute évidence que certains traits essentiels de notre révolution n'ont pas une portée locale, ni particulièrement nationale, ni uniquement russe, mais bien internationale...
Les éléments de la crise italienne, qui a reçu une solution violente par l'avènement, au pouvoir du parti fasciste, peuvent être brièvement résumés comme suit :
La bourgeoisie italienne a réussi à organiser son État moins par sa propre force intrinsèque que parce qu'elle a été favorisée dans sa victoire sur les classes féodales et semi-féodales par toute une série de conditions d'ordre international (la politique de Napoléon III en 1852-1860, la guerre austro-prussienne de 1866, la défaite de la France à Sedan et le développement que prit à la suite de cet événement l'empire germanique).
L'État bourgeois s'est ainsi développé plus lentement et suivant un processus qu'on ne peut point observer dans beaucoup d'autres pays...
Un document parisien pro "soviet" de 1920.
"Nous lançons ce journal, nous l’improvisons, nous lui donnons ce titre, "Le Soviet", parce que nous estimons qu’il est urgent d’appeler vivement et fortement l’attention du prolétariat sur l’idée communiste soviétique, sur le régime soviétique."
Le manifeste de l'organisation française ayant pris le nom de Fédération Communiste des Soviets et s'imaginant en accord avec les positions de l'Internationale Communiste.
Un après la fondation du Komintern, Lénine expose son point de vue.
Les agitations des derniers jours en Ligurie ont montré un phénomène qui se répète depuis peu avec une certaine fréquence et qui mérite d’être noté en tant que symptôme d’un état d’esprit spécial des masses travailleuses.
Les ouvriers, plutôt que d’abandonner le travail, se sont, pour ainsi dire, emparés des usines et ont cherché à les faire fonctionner pour leur propre compte ou mieux sans la présence des principaux dirigeants. Ceci veut avant tout dire que les ouvriers s’aperçoivent que la grève est une arme qui ne répond pas à tous les besoins, spécialement dans certaines conditions...
A propos des propositions et des initiatives prises pour la constitution des Soviets en Italie, nous avons recueilli du matériel que nous voulons exposer dans l’ordre. Pour l’instant nous ferons quelques considérations d’ordre général, considérations que nous avons déjà exposé dans les numéros précédents.
Le système de représentation prolétarien, qui a été introduit pour la première fois en Russie, exerce des fonctions de deux ordres politique et économique...
Lettre de Lénine aux révolutionnaires en France, en 1919.
Lénine salue les efforts révolutionnaires et rejette l'opportunisme n'assumant pas la révolution socialiste.
Camarades,
La nouvelle forme prise dans votre usine par le comité d'entreprise, avec la nomination de délégués d'ateliers ainsi que les discussions qui ont précédé et accompagne cette transformation, ne sont pas passées inaperçues dans le monde ouvrier ni dans le monde patronal turinois. Dans l'un des camps, les ouvriers d'autres établissements de la ville et de la province s'appliquent à vous imiter, dans l'autre, les propriétaires et leurs agents directs, les dirigeants des grandes entreprises industrielles, observent ce mouvement avec un intérêt croissant, et ils se demandent, et ils vous demandent, quel peut être son but, quel est le programme que la classe ouvrière turinoise se propose de réaliser...
Lénine critique l'opportuniste Ramsay Macdonald.
Le manifeste du "Parti Communiste français" de 1919.
Une analyse de Lénine du révisionnisme sévissant dans la social-démocratie.
L'époque actuelle est l'époque de la décomposition et de la faillite de tout le système capitaliste mondial, qui signifiera la faillite de la civilisation européenne si le capitalisme n'est pas supprimé avec tous ses antagonismes irrémédiables. La tâche du prolétariat à l'heure actuelle consiste dans la conquête des pouvoirs de l'État. Cette conquête signifie : suppression de l'appareil de gouvernement de la bourgeoisie et organisation d'un appareil gouvernemental prolétarien...
L'analyse de la place historique de la 3e Internationale dans la bataille pour le communisme.
Article français de 1919, du mouvement donnant naissance à un "Parti Communiste français" dès 1919.
Lénine prend la parole à la fin du congrès de fondation du Komintern.
Le système capitaliste fut dès son début un système de rapine et d'assassinats massifs...
"Les expériences de la guerre mondiale ont démasqué la politique impérialiste des « démocraties » bourgeoises comme étant la politique de lutte des grandes puissances, tendant au partage du monde et à l'affermissement de la dictature économique et politique du capital financier sur les masses exploitées et opprimées."
Article écrit à l'occasion de l'ouverture du Ier Congrès de l'Internationale communiste.
4 mars 1919
La croissance du mouvement révolutionnaire prolétarien dans tous les pays suscite les efforts convulsifs de la bourgeoisie et des agents qu'elle possède dans les organisations ouvrières pour découvrir les arguments philosophico-politiques capables de servir à la défense de la domination des exploiteurs.
"Arme contre arme ! Force contre force ! À bas la conspiration impérialiste du capital ! Vive la République internationale des Soviets prolétaires !"
Par mandat du Comité Central du Parti Communiste russe, j'ouvre le premier Congrès international.
"Sous le drapeau des Soviets ouvriers, de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir et la dictature du prolétariat, sous le drapeau de la IIIe Internationale, prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"
"La reconnaissance des paragraphes suivants, établis ici comme programme et élaborés sur la base des programmes du Spartakusbund en Allemagne et du Parti communiste (bolchéviks) en Russie doit, selon nous, servir de base à la nouvelle Internationale."
Un message de Lénine, en 1919.
Ils vont être innombrables demain, ces vieillards de tous les âges qui par la France entière vont courir au devant de nous, rayonnants d'une longue quiétude, tranquilles dans leur égoïsme satisfait et qui, secouant nos mains que les crosses auront polies, que les canons des mitrailleuses auront brûlées, que le gel et la pluie auront crevassées, s'écrieront : « Enfin, vous voilà revenus, les vainqueurs ! Vous allez passer sous l'Arc de triomphe ! Vous allez être fêtés, choyés ! A vous tous les lauriers ! Nous ne vivions plus, dans l'attente de votre retour. Il va falloir oublier bien vite toutes vos misères, oublier la guerre, oublier... »...
5 mai 1918
28 avril 1918
Grâce à la paix que nous avons obtenue, si douloureuse et si précaire qu'elle soit, la République des Soviets de Russie est désormais en mesure de concentrer pendant un certain temps ses forces sur le secteur le plus important et le plus difficile de la révolution socialiste, à savoir sa tâche d'organisation.
24 au 27 décembre 1917 (6-9 janvier 1918)
Ici un extrait de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, abordant la question de l'aristocratie ouvrière.
« Précisément dans le parasitisme et la putréfaction qui caractérisent le stade historique suprême du capitalisme, c'est-à-dire l'impérialisme...
N’étant arrivé à Petrograd que dans la nuit du 3 au 4 avril, je ne pouvais naturellement, à la réunion du 4, présenter un rapport sur les tâches du prolétariat révolutionnaire qu'en mon nom propre et en faisant les réserves motivées par mon manque de préparation.
Existe-t-il un lien entre l'impérialisme et la victoire ignoble, monstrueuse, que l'opportunisme (sous les espèces du social-chauvinisme) a remportée sur le mouvement ouvrier européen ?
Telle est la question fondamentale du socialisme contemporain. Et maintenant que nous avons parfaitement établi dans notre littérature du parti :
le caractère impérialiste de notre époque et de la guerre actuelle ;
RAPPORT VANDERVELDE
On ne se propose pas de décrire, dans ce rapport, le mal immense, que l’alcool fait à la classe ouvrière en absorbant une notable partie de ses ressources, en peuplant d'alcooliques les hôpitaux, les prisons, les asiles d’aliénés, en l'atteignant, à la fois, dans sa force de travail, dans son énergie combative, dans la valeur collective des générations qu’elle procrée...
Les boissons alcooliques contiennent de l’alcool éthylique agissant comme d’autres stimulants de nerfs (café, thé, tabac), ayant un effet toxique dès qu’ils dépassent en force et en quantité les limites permises pour chaque individu. L’alcool n’est donc pas un poison absolu, mais son pouvoir toxique exige une certaine quantité et une concentration de la boisson. Il a pour effet de commencer par exciter les nerfs, il semble les animer, puis il les engourdit, les étourdit, les endort...
Citoyens,
Je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis quarante ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah! citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demie heure, entre l'Autriche et la Serbie, signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe, mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter.
Publié dans Le Socialisme, 2 novembre 1912.
Ce n’est pas une question de savoir si la solidarité internationale du prolétariat moderne se trouve en opposition irréconciliable avec tout choc belliqueux entre deux Etats européens. L’Internationale tout entière est une pour condamner toute guerre qui pourrait sortir de l’actuelle crise balkanique...
Publié dans la Neue Zeit, 1912.
Souvenirs de jeunesse : Victor Adler
Le 24 juin, il y a eu soixante ans que Victor Adler a vu le jour. Une circonstance particulière double pour moi l’importance de cette date. C’est presque le même jour qu’il me sera donné de fêter le trentième anniversaire du moment où je suis entré avec Adler dans des relations qui devait finir par être un lien d’amitié pour la vie...
Paris, 17 novembre 1901
Mon cher Péguy,
La ténacité flamande et l’élan wallon, son intrépidité, son esprit de sacrifice et les dispositions favorables de son intelligence font du prolétaire belge un combattant idéal dans la lutte des classes, du moment qu’il atteint à la clarté des conceptions théoriques.
L’Armée nouvelle de Jean Jaurès, article de Rosa Luxembourg, publié dans la Leipziger Volkszeitung le 9 juin 1911.
Réponse à la Conférence du citoyen Jean Jaurès
Citoyennes et Citoyens,
Vous comprendrez que c'est avec hésitation que j'ai assumé la tâche de répondre à Jaurès, dont l'éloquence fougueuse sait passionner les thèses les plus abstraites de la métaphysique. Pendant qu'il parlait, je me suis dit et vous avez dû vous dire : il est heureux que ce diable d'homme soit avec nous. Les mineurs de Carmaux ont richement payé leur dette au parti socialiste, qui a fait triompher leur grève, en libérant Jaurès de l'Université et en le rejetant dans la politique.
Conférence de Jean Jaurès
devant les Etudiants collectivistes, décembre 1894, salle d’Arras, à Paris
Citoyennes et citoyens,
Je vous demande d’abord toute votre patience, parce que c’est à une déduction purement doctrinale que j’entends me livrer ce soir devant vous.
Je veux aussi, tout d’abord, vous prémunir contre une erreur qui pourrait résulter de ce fait que le sujet que je vais traiter devant vous, j’en ai déjà parlé il y a quelques mois. J’ai, alors, exposé la thèse du matérialisme économique, l’interprétation de l’histoire, de son mouvement selon Marx ; et je me suis appliqué à ce moment à justifier la doctrine de Marx, de telle sorte qu’il pouvait apparaitre que j’y adhérais sans restriction aucune...
La justice Harmonique. Mais il ne suffit pas d'avoir ainsi disposé ces quatre points en proportion Géométrique, et en partie Arithmétique, si on ne les couple ensemble par proportion Harmonique, qui unit et conjoint les deux nombres du milieu, 6 et 8 et le second au quart, et le premier au tiers, dont il résulte une harmonie mélodieuse, composée de la quarte, de la quinte et des octaves.
Autrement, si vous ôtez le lien Harmonique de la quarte, qui est entre 6 et 8, la proportion Géométrique demeurera disjointe ; et si vous disposez les quantités en proportion Géométrique continue, l'Harmonie périra, comme on peut voir en ces quatre nombres 2, 4, 8, 16 où les raisons se trouvent bien conjointes en quelque sorte qu'on les prenne...
Or, la plus noble différence du roi et du tyran est que le roi se conforme] aux lois de nature, et le tyran les foule aux pieds.
L'un entretient la piété, la justice, et la foi ; l'autre n'a ni Dieu, ni foi, ni loi.
L'un fait tout ce qu'il pense servir au bien public, et tuition des sujets ; l'autre ne fait rien que pour son profit particulier, vengeance, ou plaisir...
Préambule. — Les cavales qui m’emportent au gré de mes désirs, | se sont élancées sur la route fameuse | de la Divinité, qui conduit partout l’homme instruit ; | c’est la route que je suis, c’est là que les cavales exercées |5| entraînent le char qui me porte. Guides de mon voyage, | les vierges, filles du Soleil, ont laissé les demeures de la nuit | et, dans la lumière, écartent les voiles qui couvraient leurs fronts. | Dans les moyeux, l’essieu chauffe et jette son cri strident | sous le double effort des roues qui tournoient |10| de chaque côté, cédant à l’élan de la course impétueuse. | Voici la porte des chemins du jour et de la nuit, | avec son linteau, son seuil de pierre, | et fermés sur l’éther, ses larges battants, | dont la Justice vengeresse tient les clefs pour ouvrir et fermer. |15| Les nymphes la supplient avec de douces paroles | et savent obtenir que la barre ferrée | soit enlevée sans retard ; alors des battants | elles déploient la vaste ouverture | et font tourner en arrière les gonds garnis d’airain |20| ajustés à clous et à agrafes ; enfin par la porte | elles font entrer tout droit les cavales et le char. | La Déesse me reçoit avec bienveillance, prend de sa main | ma main droite et m’adresse ces paroles : | « Enfant, qu’accompagnent d’immortelles conductrices, |25| que tes cavales ont amené dans ma demeure, | sois le bienvenu ; ce n’est pas une mauvaise destinée qui t’a conduit | sur cette route éloignée du sentier des hommes ; | c’est la loi et la justice. Il faut que tu apprennes toutes choses, | et le cœur fidèle de la vérité qui s’impose, |30| et les opinions humaines qui sont en dehors de le vraie certitude. | Quelles qu’elles soient, tu dois les connaître également, et tout ce dont on juge. | Il faut que tu puisses en juger, passant | toutes choses en revue...
1. Il est un seul dieu suprême parmi les dieux et les hommes ; il ne ressemble aux mortels ni pour le corps ni pour la pensée.
2. Tout entier il voit, tout entier il pense, tout entier il entend.
3. Mais, sans labeur aucun, son penser mène tout...
Retranscription des avis de Xénophane par d'autres philosophes grecs.
Manifeste du futurisme, publié le 11 janvier 1909 dans Le Figaro.
Fondation et Manifeste du Futurisme : Nous avions veillé toute la nuit, mes amis et moi, sous des lampes de mosquée dont les coupoles de cuivre aussi ajourées que notre âme avaient pourtant des cœurs électriques.
Et tout en piétinant notre native paresse sur d'opulents tapis Persans, nous avions discuté aux frontières extrêmes de la logique et griffé le papier de démentes écritures. Un immense orgueil. gonflait nos poitrines, à nous sentir debout tout seuls, comme des phares ou comme des sentinelles avancées, face à l'armée des étoiles ennemies, qui campent dans leurs bivouacs célestes...
Préface à la première édition allemande
La brochure qu’on va lire a pour origine trois chapitres de mon travail : M. E Dühring bouleverse la science, Leipzig 1878. Je l’ai composée pour mon ami Paul Lafargue aux fins de traduction en français et j’ai ajoute quelques développements nouveaux. La traduction française, que j’avais revue, parut d’abord dans la Revue socialiste, puis en brochure sous le titre Socialisme utopique et socialisme scientifique, Paris 1880. Une transposition en polonais, d’après la traduction française, vient de paraître à Genève sous le titre : Socyjalism utopijny a naukowy, Imprimerie de l’Aurore, Genève 1882...
Il y eut cinquante ans, le 14 mars 1908, que mourut Karl Marx, et il y a déjà un siècle que parut le Manifeste Communiste où sa doctrine fut exposée, dans ses grandes lignes, pour la première fois.
Ce sont là des époques déjà bien lointaines pour nous qui sommes d’un temps où la vie est si trépidante et où les conceptions scientifiques et esthétiques changent plus souvent que la mode. Cependant Karl Marx vit encore d’une vie intense parmi nous. Il domine plus que jamais la pensée contemporaine, malgré toutes les crises de marxisme et malgré toutes les objections et les réfutations des représentants officiels de la science bourgeoise...
Je remercie La Revue de Paris de son libéralisme. Je sais que la plupart de ses lecteurs n’acceptent pas l’idée socialiste. Mais peut-être ne m’en voudront-ils pas si j’essaie de dissiper un malentendu.
Il y a une partie notable de la bourgeoisie, qui n’est pas séparée du socialisme par des intérêts de classe : et elle a d’ailleurs, par l’effet d’une haute culture, assez de générosité pour ne pas faire de son intérêt étroit la mesure du vrai. Mais elle tient par-dessus tout à la liberté...
Le présent ouvrage a été écrit à la veille de la révolution russe, pendant l’accalmie qui a suivi l’explosion des grandes grèves de 1895-1896. Le mouvement ouvrier s’était alors comme replié sur lui-même; il s’étendait en largeur et en profondeur et préparait la vague de manifestations de 1901.
L’analyse du régime économique et social et, partant, de la structure de classe de la Russie, que nous présentons dans cet ouvrage en nous basant sur des recherches économiques et sur un examen critique des renseignements statistiques, se trouve confirmée actuellement par l’action politique directe de toutes les classes dans le cours de la révolution...
Nous avons déjà longuement démontré que la supplantation de la production capitaliste par la production socialiste est non seulement conforme aux intérêts des non-possédants et des exploités, mais encore de toute l’évolution sociale et même, en un certain sens conforme aux intérêts des possédants et des exploiteurs, Ces derniers, eux aussi, ont à souffrir des contradictions dues au mode de production actuel.
Les uns deviennent la proie de la paresse, les autres s’épuisent dans une chasse effrénée au profit, et sur les uns et les autres est suspendue l’épée de Damoclès, la banqueroute, la chute dans le prolétariat...
Les forces productives qui se sont développées au sein de la société capitaliste ne sont plus compatibles avec le mode de propriété qui forme sa base. Vouloir maintenir cette forme de propriété, c’est rendre à l’avenir son progrès social impossible, c’est condamner la société au repos, à la corruption, mais à une corruption la frappant en pleine vie, s’accompagnant des convulsions les plus douloureuses.
Tout progrès ultérieur des forces productives accuse la contradiction où se trouvent ces forces et le mode de propriété existant. Toutes les tentatives de résoudre cette contradiction ou simplement de l’atténuer sans toucher à la propriété ont montré leur inutilité et devaient le faire...
Nous avons vu que, dans les pays où règne le mode de production capitaliste, la masse de la population devient de plus en plus des prolétaires , des ouvriers ne possédant plus leurs moyens de production, qui, par suite, ne peuvent produire avec ce dont ils disposent et se voient contraints, s’ils ne veulent mourir de faim, de vendre la seule chose qu’ils possèdent, leur force de travail . En fait, la majorité des paysans et des petits industriels appartient au prolétariat.
Ce qui les en distingue, leur propriété, n’est qu’une vaine apparence, plus propre à dissimuler l’exploitation dont ils sont l’objet, leur asservissement, qu’à l’empêcher. C’est un voile que la moindre brise assez forte soulève et emporte...
Nous avons déjà vu dans le précédent chapitre que la production capitaliste des marchandises a pour condition préalable la séparation de l’ouvrier d’avec ses moyens de travail. Dans la grande exploitation capitaliste, nous rencontrons, d’une part, le capitaliste qui possède les moyens de production, mais ne prend pas part à cette production ; et, d’autre part, les salariés, les prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail qu’ils vendent pour vivre et dont le travail crée tous les produits de cette industrie.
A l’origine, il fallait avoir recours à la violence pour se procurer la quantité de prolétaires nécessaires au capital. Aujourd’hui, ce n’est plus indispensable...
Plus d’une personne croit faire preuve de sagesse quand elle nous déclare : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Il en est aujourd’hui comme il en a toujours été et comme il en sera toujours. » Rien de plus inexact, de plus faux que cette affirmation. La science la plus récente nous enseigne qu’il n’y a jamais repos, que, dans la société comme dans la nature, on peut observer une constante évolution.
Nous savons aujourd’hui, qu’à l’origine, l’homme, comme l’animal, ne vivait que des produits que la nature lui offrait spontanément et qu’il recueillait...
Cet écrit parut d’abord en Allemagne, en, 1892, comme commentaire du programme que la Social-Démocratie allemande venait de se donner à Erfurt à l’automne de 1892. J’ai fait subir au texte original, pour l’édition française, quelques modifications, d’ailleurs sans grande importance.
Les programmes de presque tous les partis socialistes reposent aujourd’hui sur les mêmes principes théoriques. Il suffisait donc d’écarter quelques renvois au programme spécial d’Erfurt, pour faire de mon commentaire à ce programme un commentaire de l’évolution générale des idées socialistes, et pour transformer son caractère plus particulièrement allemand en un caractère international...
La social-démocratie, c'est l'union du mouvement ouvrier et du socialisme. Karl Kautsky.
Ils sont vraiment par trop importuns, nos "menchéviks" ! Je parle des "menchéviks" de Tiflis. Ayant eu vent des divergences dans le parti, les voilà qui vont répétant : qu'on le veuille ou non, partout et toujours nous parlerons de ces divergences ; qu'on le veuille ou non, nous nous en prendrons en toutes circonstances aux "bolchéviks" ! Et ils s'en prennent à nous comme des possédés. A tous les carrefours, entre eux ou devant des étrangers, bref, n'importe où, ils clament la même chose : méfiez-vous de la "majorité", ces gens ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas sûrs ! Non contents de leur champ d'action "habituel", ils ont porté "l'affaire" dans les publications légales et par là, ils ont porté "l'affaire" une fois de plus, montré au monde leur... importunité...
Publié dans Le Socialiste, 3 mai 1905.
Depuis qu’elle existe, la fête de Mai n’a pas encore été célébrée une année dans une situation aussi orageuse, aussi révolutionnaire. La Révolution a éclaté en Russie, s’est emparée des masses et est en marche de façon à ne pouvoir être arrêtée...
Publié dans Le Socialiste, 2 mai 1904.
Plus d’une fête est célébrée par le prolétariat ; mais dans la célébration de toutes, il se rencontre avec d’autres classes, même lorsqu’il s’agit des grandes dates de la Révolution. Même dans l’insurrection de la Commune de Paris, il n’y a pas été le seul participant, d’importantes fractions de la petite bourgeoisie combattaient avec lui, et si dans la commémoration du 18 mars il prend une part de plus en plus prépondérante, elle n’est pourtant pas exclusive...
Jamais il ne fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un logicien plus exact que M. Locke ; cependant il n’était pas grand mathématicien. Il n’avait jamais pu se soumettre à la fatigue des calculs ni à la sécheresse des vérités mathématiques, qui ne présente d’abord rien de sensible à l’esprit ; et personne n’a mieux prouvé que lui qu’on pouvait avoir l’esprit géomètre sans le secours de la géométrie. Avant lui, de grands philosophes avaient décidé positivement ce que c’est que l’âme de l’homme ; mais, puisqu’ils n’en savaient rien du tout, il est bien juste qu’ils aient tous été d’avis différents.
Dans la Grèce, berceau des arts et des erreurs, et où l’on poussa si loin la grandeur et la sottise de l’esprit humain, on raisonnait comme chez nous sur l’âme...
August Bebel : Discours au congrès socialiste international d'Amsterdam (1904)
Le discours qu'a prononcé aujourd'hui notre camarade Jaurès est de nature à éveiller la fausse impression que nous ayons, nous, les démocrates‑socialistes d'Allemagne, soulevé ce débat.
Ni avant ni après Dresde nous n'y avons songé une minute, c'est une partie de nos camarades français qui ont pensé que, notre résolution de Dresde se prêtait excellemment pour devenir fondamentale pour la tactique de la démocratie socialiste dans tous les pays à régime parlementaire...
Citoyennes, citoyens, camarades, Laissez-moi, tout d’abord, remercier Jaurès d’avoir aussi bien posé la question, la seule question pour la solution de laquelle vous êtes réunis ce soir.
Jaurès a dit la vérité au point de vue historique de nos divergences lorsque, allant au-delà de la participation d’un socialiste à un gouvernement bourgeois, il est remonté jusqu’à ce qu’on a appelé l’affaire Dreyfus. Oui, là est le principe, le commencement, la racine d’une divergence qui n’a fait depuis que s’aggraver et s’étendre...
C’est Elm qui a essayé en dernier lieu d’exposer la politique de neutralité des syndicats en dehors de tout parti.
Cette politique doit être : « une politique pratique d’actualité » , « une pure politique d’intérêts, non une politique de parti ».
Voilà qui est net, surtout quand c’est imprimé en gros caractères, mais si l’on y regarde de plus près, on reconnaît que cela prête à tout autant d’ interprétations que la « politique ouvrière »...
Le travail qu’on va lire a paru en une série d’articles dans la Neue Zeit , il y a deux ans, à un moment où l’on discutait avec chaleur en Allemagne la question des rapports entre le parti socialiste et les syndicats. C’est dans tous les pays capitalistes un problème de la plus haute importance que l’établissement de ce modus vivendi , mais la question ne se pose pas de la même façon dans les différents pays, et elle admet les solutions les plus diverses. Il me paraît utile de le constater ici de façon à prévenir tout malentendu.
Car ce que je sais des syndicats français suffit pour me prouver que le problème de la neutralité des syndicats est absolument différent en France et en Allemagne : les arguments présentés pour ou contre la neutralité en Allemagne ne valent donc par nécessairement pour la France...
Avant de clore notre exposé, nous allons encore jeter un coup d’œil sur le comportement des éléments féodaux, de la noblesse et des cours hors de France, qui n'a pas été sans influencer significativement le développement de la Révolution.
Le divorce entre la royauté et la noblesse en France, à la veille de la Révolution, était déjà un phénomène incroyable. Mais il l'est encore plus que ce clivage ait pu encore se manifester dans une monarchie européenne après son déclenchement, et que des intérêts éphémères des plus mesquins aient mis aux prises des éléments dont les intérêts permanents et généraux auraient exigé de façon pressante qu'ils se coalisent. Signalons quelques-unes de ces luttes parmi les plus importantes...
Les paysans se situaient encore une marche en-dessous des artisans non affiliés à une corporation, des prolétaires et tous ceux qui vivaient dans leurs parages.
Citadins, le bouillonnement des idées n'était pas sans influencer dans une certaine mesure ces derniers, qui vivaient par ailleurs entassés dans des localités étroites non loin des centres du pouvoir. Leur concentration et leur intelligence leur donnaient une certaine force de résistance, et la proximité du gouvernement la possibilité d'agir directement pour faire pression sur lui. Si dure que fût l'oppression qui pesait sur eux, pire encore était celle qu'on faisait subir en toute impunité aux paysans, lesquels, isolés, disséminés, loin de toute stimulation intellectuelle, n'étaient pas en capacité de se coaliser contre leurs bourreaux et de faire entendre leurs doléances.
Le Tiers État comprenait également les artisans. L'organisation en corporations était sclérosée depuis longtemps et devenue pour quelques élus le moyen de monopoliser la production artisanale et de faire du titre de maître-artisan un privilège qui favorisait d'autant plus l'exploitation des compagnons et des consommateurs qu'était plus restreint le nombre de ceux auxquels il était attribué. Il était quasiment impossible à un compagnon de s'élever à ce grade s'il n'était pas le fils ou le gendre, ou n'épousait pas la veuve d'un maître-artisan.
Pour les autres, toute une série de conditions rendait la chose non seulement extrêmement difficile, mais généralement impossible à priori. Souvent, la corporation était déclarée fermée, et fixé une fois pour toutes le nombre de maîtres-artisans qu'elle pouvait compter...
Il y a encore une catégorie importante de la bourgeoisie qu'il convient d'évoquer, celle de l'intelligentsia bourgeoise. Le mode de production capitaliste a disjoint les deux fonctions qui étaient réunies dans l'artisanat et les a assignées à deux catégories différentes de travailleurs, les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels. Il a en outre, dans la société où il s'est formé, élargi à l'infini la division du travail, et donné naissance à une série de professions vouées uniquement au travail intellectuel.
Le technicien de formation scientifique ne jouait à vrai dire au 18ème siècle pas encore un grand rôle dans l'industrie. L'application industrielle de la mécanique et de la chimie scientifiques en était à la fin du siècle aux premiers balbutiements. Dans les transports, en revanche, le nouveau mode de production assignait déjà au technicien des tâches importantes : il devait construire des bateaux, des ponts, des routes, des canaux. Tout aussi importante pour le développement de son savoir-faire était l'art de la guerre...
Le Tiers État était aussi profondément divisé que les deux premiers ordres. Il est devenu à la mode aujourd'hui d'appeler Tiers État la classe des capitalistes, le prolétariat étant alors le quatrième ordre (1).
Outre que le prolétariat salarié moderne est une classe et pas un état, une couche sociale que les particularités de sa situation économique, et non des institutions juridiques séparées, distinguent des autres, on ne peut parler d'un quatrième ordre pour la simple raison que le prolétariat existait déjà au sein du Tiers État. Celui-ci comprenait toute la population qui n'appartenait pas aux deux premiers, donc pas seulement les capitalistes, mais aussi les artisans, les paysans et les prolétaires. Il est donc facile d'imaginer l'énorme hétérogénéité que cela pouvait représenter. Nous y voyons à l’œuvre les plus violents antagonismes, les méthodes de lutte et les objectifs les plus divers. Impossible de parler d'une lutte de classe homogène...
La lutte opposant les Parlements défenseurs de la noblesse de robe et l'administration rigoureusement centralisée et despotique de l’État prenait parfois les dimensions d'une lutte de tous les privilégiés contre cette dernière et contre la monarchie absolue, d'une lutte qui ne restait pas dans les limites d'une intrigue de cour ignorée du peuple malgré la brutalité de l'affrontement, mais qui appelait à la rescousse la classe tout entière jusqu'en-dehors de la cour et entraînait la multitude.
Le plus important mouvement de ce type fut la Fronde, que nous avons mentionnée dans le précédent chapitre. Cela eut lieu dans la première moitié du 17ème siècle, la noblesse possédait alors encore énergie et confiance en soi. Un mouvement analogue était en passe de se déclencher dans le dernier quart du 18ème siècle. La Fronde avait débouché sur un renforcement de l'absolutisme. Le mouvement qui démarra en 1787 allait se terminer par la victoire du Tiers État, il allait être le prologue de la grande Révolution...
L'administration d’État occupait une position sui generis, intermédiaire entre les deux premiers ordres et le Tiers État.
Les organes de l'ancienne administration féodale existaient encore en partie, dépouillés de leurs fonctions essentielles, mais pas de leurs revenus. Comme ils faisaient partie des principaux moyens que pouvait utiliser la noblesse féodale pour exploiter l’État à son profit, ils n'avaient pas été supprimés au fur et à mesure qu'il perdaient leur raison d'être. Bien au contraire, comme nous l'avons vu, les charges les plus lucratives et les plus superflues avaient encore été multipliées tout au long du 18ème siècle...
C'est le calendrier qui a suscité l'écriture de la présente étude. Publiée d'abord en 1889 sous la forme d'une série d'articles dans la revue « die Neue Zeit », elle a été reprise en brochure pour le centième anniversaire du début de la Grande Révolution sous le titre « Les antagonismes de classes en 1789 ». L'occasion avait suggéré le titre, mais une fois celle-ci passée, il n'est plus gère adapté à l'objet de cet essai, qui ne se limite pas à l'année 1789, mais couvre toute la durée de la Révolution. Je l'ai donc modifié pour cette réédition sans pour autant rien changer au contenu.
Le but que je poursuivais il y a vingt ans en écrivant ces pages est malheureusement toujours d'actualité : il s'agissait de contrer une interprétation triviale du matérialisme historique, un marxisme vulgaire qui sévissait un peu partout à cette époque...
C'est le 17 juin 1789 que les députés du Tiers État, pressés par l'effervescence révolutionnaire du pays tout entier, se constituèrent en Assemblée Nationale et donnèrent par là-même le coup d'envoi du gigantesque drame social que nous appelons la Grande Révolution « par excellence ».
Les espérances que fit naître cette initiative étaient immenses, mais elles furent encore dépassées par l'enchaînement des événements qui suivirent. L'édifice de l’État féodal, qui paraissait naguère encore si solide, s'effondra comme un château de cartes sous l'assaut des masses. En l'espace de quelques mois seulement furent brisées toutes les entraves qui avaient corseté la France et failli la faire périr étouffée...
Avant d'examiner les antagonismes de classes à l'époque de la grande Révolution, il nous semble utile de jeter un coup d’œil sur la formation politique à l'intérieur de laquelle ils se sont déployés. La forme de l’État détermine la façon dont les différentes classes cherchent à faire prévaloir leurs intérêts, elle détermine la configuration de la lutte des classes.
La forme de l’État français, de 1614 à 1789, c'était la monarchie absolue, donc un type d’État qui, dans des conditions normales, exclut toute lutte de classes intensive, puisqu'il interdit à ses « sujets » toute activité politique, et par conséquent est dans la durée incompatible avec la société d'aujourd'hui. Toute lutte de classes débouche inévitablement sur une lutte politique, toute classe ascendante est donc obligée, si elle n'a pas de droits politiques, de se battre pour les obtenir...
Le Congrès international de 1889 avait décidé une manifestation internationale du monde du travail le 1er Mai 1890. Quand les délégués qui avaient représenté le prolétariat français à ce congrès se réunirent pour organiser cette manifestation ils étaient sceptiques sur le résultat de leurs efforts.
La tâche était d'autant plus difficile que le Parti socialiste français ne disposait d'aucun moyen financier; de plus, les " possibilistes " se déclaraient contre toute manifestation et essayaient de la faire échouer, cependant que de leur côté, les monarchistes et les boulangistes essayaient de participer à la démonstration pour l'utiliser en faveur de leurs fins politiques...
Le matérialisme économique tel que nous l'a enseigné Karl Marx, bannit de l'histoire de l'évolution humaine toute conception idéaliste ; il nous apprend à ne pas rechercher les causes de l'évolution humaine dans l'action d'un être supérieur, placé en dehors et au-dessus du monde, ainsi que le font les déistes, ni dans la réalisation d'une idée préconçue et préexistante ainsi que le font les historiens et les politiciens idéalistes, qui croient que l'évolution humaine a pour but de réaliser un certain idéal de justice, de liberté, d'autonomie etc. [1], mais dans les transformations des milieux dans lesquelles vivent les sociétés humaines, dans leur action sur l'homme et dans la réaction que l'homme exerce sur ces milieux.
L'homme vit dans deux milieux, le milieu cosmique fourni par la nature, et le milieu économique, créé par l'homme...
Publié dans Le Socialiste, 9 décembre 1905.
Ce dont plus d’un, dans nos rangs mêmes, pouvait encore douter il y a un an, est aujourd’hui de la dernière évidence : la Russie est à l’heure qu’il est dans une Révolution qui peut être mise en parallèle, pour la force et pour l’importance, avec les deux plus grandes révolutions que l’histoire ait vues jusqu’à présent, celle d’Angleterre au XVII° et celle de France au XVIII° siècle.
Pour la classe ouvrière dépouillée, par la transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste, de toute propriété sur les moyens de production, et constamment reproduite par le mécanisme du système de production capitaliste dans cet état héréditaire de prolétarisation, l’illusion juridique de la bourgeoisie ne peut suffire à exprimer totalement la situation où elle se trouve.
Tiré de Enquête sur la question sociale en Europe (1897) de Jules Huret.
M. Bebel est l'un des deux principaux chefs du socialisme allemand et le plus populaire; il a presque réussi à faire de ce parti un véritable parti politique, apte à s'emparer du pouvoir, qui, républicain, s'accomoderait de l'Empire; révolutionnaire, s'arrangerait de l'ordre; collectiviste, de la propriété : ce serait en somme l'équivalent du parti radical français, avec un républicanisme plus latent, et des tendances socialistes plus accentuées...